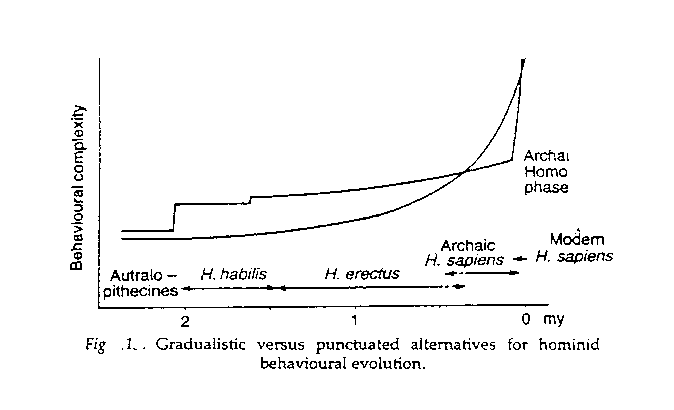Christian Churches of God
[B5]
La Création :
De la Théologie
Anthropomorphique à l’Anthropologie Théomorphique
ou
D’un Dieu fait
à l’image de l’Homme à Un Homme fait à l’image de Dieu
(Édition 1.1
19901201-20000919)
Cet ouvrage vise à examiner le fondement logique de la Création, la
Causalité et les Attributs de Dieu et la place des humains et des fils de
Dieu dans cette Création en harmonie avec le récit de l’Écriture Sainte.
Christian Churches of God
PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
Courriel :
secretary@ccg.org
(Copyright
ã
1990, 2000 Wade Cox)
(Tr. 2014,
2024, rév 2024)
Cette étude peut être copiée et distribuée librement à la condition qu'elle
le soit en son entier, sans modifications ni rayures. On doit y inclure
le nom, l'adresse de l’éditeur et l'avis des droits d'auteur. Aucun
montant ne peut être exigé des récipiendaires des copies distribuées. De
brèves citations peuvent être insérées dans des articles et des revues
critiques sans contrevenir aux droits d'auteur.
Cette étude est disponible
sur les pages du World Wide Web :
http://logon.org et
http:/ccg.org
La
Création [B5]
Table des matières
Préface
1
Causalité et Singularités
1:1
Les Singularités et la Notion de Causalité
1:2
Le Développement de l'Explication Causale
1:2.2
Descartes et la Causalité Postcartésienne
1:3
Les Aspects Métaphysiques de la Science et de la Matière
1:4
Tester les Conceptions de Causalité
1:4.2
L’Idée/Ideatum et l’Existence sans une Cause
1:5.1 Hume
et Leibniz
1:5.2
L’Harmonie de la Positon Humienne
1:6.1 Les
Aspects Insensés de la Causalité Singulariste
1:6.2 La
Causalité Survenante et Intermédiaire
1:7
Les Contre-Arguments
1:7.1
L'Argument de la Possibilité de Lois Indéterministes
1:7.2 La
Conception Singulariste
1:7.3
La Conception Intermédiaire
1:8
La Direction du Temps
1:9
La Transmission Simultanée des Idées
1:10
Les Propriétés Essentielles d'une Définition de Causalité Singulariste
2
La Création et la Création Absolue
2:1.1 La
Création Cyclique et les Attributs de Dieu
2:1.2 Les
Problèmes de Transcendance/Immanence
2:2.1 La
Création Absolue
2:2.2
L’Activisme et la Loi comme un Mécanisme
2:3.1
Ontologie et Illumination
3
La Transcendance et les Fils de Dieu
3:1
La Transcendance et l'Ange de la Rédemption
3:2
Les Elohim, les Étoiles du Matin et les Fils de Dieu
3:2.1 Les
Elohim
3:2.2 Les
Elohim comme une Pluralité
3:2.3 Les
Étoiles du Matin
3:2.4 Les
Chérubins
3:3.1
L'Esprit de l'Homme et l'Ordre Angélique
3:3.2 Les
Doctrines Originales du Millénaire
3:4
Le Logos et la Création
3:4.1
Volonté et Nature
3:4.2 Foi
et Sagesse
3:4.3 Les
Hommes et la Nature Divine
3:5
Les Elohim et le Libre Arbitre
3:6
Le Panthéisme versus le Monothéisme Transcendant
3:6.1 Les
Fils de Dieu et un Argument de Continuité
3:6.2
L'Union de l'Esprit Saint
3:6.3 Satan
et le Panthéisme
4
La Création Matérielle
4:1
La Création de l'Homme
4:1.1 Les
Humanoïdes Pré-adamiques
4:1.2
Explication de la Séquence
4:2
Les Aspects Philosophiques de l'Évolution
4:3
Les Nephilim
4:3.1
Qumran
4:4
Une Harmonie entre des Philosophies Apparemment Contradictoires
4:4.1 Les
Déformations de Nicée et post-Nicée de la Philosophie de la Religion
4:4.2 Une
Explication Alternative
4:5
L'Âme et la Vie après la Mort
4:6
Les Concepts Antérieurs et Ultérieurs des Elohim et de la
Résurrection
4:7
La Mécanique de la Spiritualité Humaine
4:8
Une Tentative d'Explication de l'Esprit
5
Résumé
Bibliographie
Préface
Jusqu'au
XIXe siècle, la science du jour a été enfermée dans la théorie
quasi-religieuse et absurde que la terre était vieille de seulement quelques
milliers d'années, basée sur des reconstructions erronées et illogiques du
scénario biblique. Un grand nombre de ces mythes illogiques subsistent
encore aujourd'hui. Au fur et à mesure que la science a commencé à faire des
estimations, basée sur sa connaissance à l'époque, plusieurs estimations ont
été faites pour l'âge de la terre, et donc le système solaire/soleil. En
1854, Helmholtz a soulevé l’idée d’un âge de 25 millions d'années pour l'âge
du soleil, et Thomson (plus tard Lord Kelvin) a estimé que le chiffre le
plus probable était de 100 millions d'années.
“Même Thomson, nous le savons maintenant, était
plus de dix fois trop modeste dans son évaluation de l'âge du système
solaire.”
(John Gribbin,
In Search of the Big Bang: Quantum Physics and Cosmology, Corgi Books, 1988, p. 160).
Ces calculs sont basés sur des hypothèses
scientifiques sur la quantité d'énergie que le soleil répand et combien de
temps un tel corps pourrait soutenir cette production d'énergie. L'énergie
libérée est en fait environ 4 x 1033 ergs par seconde ou environ
1041 ergs par an (ibid., p. 161). Avec la découverte de la
radioactivité les estimations de Helmholtz et Thomson ont dû être
multipliées par environ 10 à 100 fois afin de produire un modèle correct de
répartition radioactive.
Comme la
compréhension de la mécanique du système solaire s’est accrue, il est devenu
possible de produire des modèles de la structure et de la création possible
de l'univers. Au cours des décennies du 20e siècle, il est devenu à la mode
de rejeter avec mépris les concepts de la Création et l’Activisme Théiste.
Il est également devenu à la mode de rejeter avec encore plus de mépris le
concept des démons ou d’une Armée angélique. C’est devenu presque une
définition acceptée que la causalité fût non-singulariste ou survenante et
que l'univers était matériel. Bien qu'il soit vrai qu'il y a des difficultés
avec les concepts singularistes de causalité et également le postulat de
sous-structures immatérielles à l'univers matériel, il est néanmoins de plus
en plus difficile dans les paradigmes classiques de tenir compte de la
régularité et de l'uniformité de la distribution de l'univers. Au vu des
mesures actuelles du rayonnement de fond dans l'univers et des problèmes de
régularité et d'ordre de la matière qui en découlent, la Théorie du Big Bang
de l'univers est maintenant reconnue d’avoir de sérieux ennuis. Cela ne
signifie pas que nous devrions faire fi des modèles de réaction physique
mais plutôt nous devrions maintenant être en mesure de revoir les paradigmes
dans lesquels ils ont été construits. Dans l’effort du travail sur la
Création et l’Armée, l’ouvrage de certains philosophes et scientifiques
s'est avéré extrêmement utile, en particulier ceux qui traitent des
singularités. Tout récit théiste repose nécessairement sur les prémisses de
Causalité Singulariste, et de celles-ci, les singularités dans la création
physique.
Il est
considéré que l’ouvrage qui a été écrit par Michael Tooley sur la Causalité
Singulariste est d'une grande importance pour les concepts non seulement de
la causalité mais aussi pour l’activisme théiste et, nécessairement, pour
les concepts de l'action humaine. Il est soutenu que la Philosophie de la
Religion a été placée dans une camisole de force historique et causale par
la réécriture de la compréhension des anciens comme un non-sens
mythologique, et les actions de certains philosophes chrétiens ont
possiblement détruit la direction spirituelle et la compréhension de
plusieurs générations d'humains. Cette incohérence a également placé la
religion et la paléoanthropologie en conflit inutile. Il est significatif
que Roger Penrose et Stephen Hawking aient ainsi démontré que les questions
de la relativité générale dans leur forme classique (c'est-à-dire sans tenir
compte des effets quantiques) nécessitent absolument qu'il y avait une
singularité à la naissance de l'univers, un point où le temps a commencé.
(Gribbin, ibid., p. 381). Stephen Hawking a identifié des singularités
mathématiques où non seulement la matière mais aussi l'espace et le temps
peuvent être créés (ou inversement extraits de l'existence pour le
physicien). L'auteur ne prétend pas être un astrophysicien et, par
conséquent, toutes suggestions qui devaient être réalisées en ce qui
concerne les modèles astrophysiques seraient gratuites. Il est à noter dans
son ouvrage
A Brief History of Time: From the Big Bang to the
Black Holes, (Bantam Press, UK, 1988,
p.50) que Hawking a changé d'avis au sujet de la singularité du Big Bang, en
ce que la nécessité d'une telle singularité peut disparaître une fois que
les effets quantiques sont pris en compte. Il a toutefois de la difficulté à
convaincre ses collègues. Alors que la nécessité d’une distribution causale
du Big Bang de l'univers est certainement mise en doute sérieusement, il est
jugé que la nécessité logique des singularités ne peut être surmontée.
Il est
regrettable que le nouvel ouvrage de Roger Penrose soit sorti à l’achèvement
de cet ouvrage, puisque son importance pour la compréhension de la pensée
humaine est très importante. Il semble y avoir une dérive vers l'immanence
structurale, et une forme de monisme logique peut devenir une innovation à
la mode résultant de la nouvelle physique. Cette situation est alarmante
dans ses implications pour le Monothéisme Transcendant.
À partir
de la position de Tooley sur la Causalité Singulariste, on essaie de
développer une structure causale singulariste qui est théiste de manière
cohérente. Les attributs et la nature de Dieu exigent de la structure de la
création un système moral et éthique absolutiste basé sur les relations
théoriques comme des Lois qui ne sont pas désincarnées ou relatives. Il sera
montré que l'existence d'entités spirituelles et la capacité pour le mal
sont logiquement nécessaires à un univers parfaitement harmonieux avec une
capacité absolue, et que l'existence des Anges, des Démons et du Mal n'est
pas seulement compatible avec l'omniscience et l'omnipotence de Dieu, mais
est en fait logiquement nécessaire à la capacité spirituelle absolue. Il est
en outre avancé que la sous-structure de l'univers est nécessairement, avec
les concepts actuels de Théorie de la Matière Noire, un reflet logique de
l'action du spirituel, et se révélera être immatérielle, spirituelle et peu
comprise. Le fait que l'univers ait un but qui n’est qu’à peine compris est
une prémisse des anciens et une prémisse qui est démontrée au fur et à
mesure que la connaissance augmente.
Chapitre 1
Causalité et Singularités
Hypothèses
Semblable
à la position exercée par Tooley, les hypothèses suivantes sont
nécessaires :
1: Les
vues empiristes traditionnelles concernant les concepts qui peuvent être
traités comme analytiquement fondamentaux sont solides et, par conséquent,
le concept de causalité ne peut pas être traité comme analytiquement
fondamental et doit donc être analysé.
2: Sans
se soucier du travail de Wittgenstein sur la nature problématique du langage
privé, un langage privé est considéré comme non problématique dans le but de
causalité.
3: Les
concepts qui impliquent l'attribution de qualités secondaires aux objets
externes peuvent être analysés en termes de concepts qui impliquent
l'attribution des qualia à des expériences.
4:
L’analyse en sens inverse est impossible.
1:1 Les Singularités et la Notion de Causalité
La
plupart des points de vue de la causalité ont été réductionnistes et ont
traité les relations causales comme observables. Ceux-ci ne sont pas
satisfaisants pour les raisons décrites ci-dessous et tout traitement des
relations causales qui espère offrir une conception satisfaisante de la
causalité semblerait être réaliste, traitant des relations causales comme
théoriques. L'hypothèse selon laquelle les relations causales sont
observables est une vue matérialiste qui est assez ancienne. À l'origine,
les théories de la causalité étaient théistes avec des hypothèses que
certaines causes théistes n’étaient pas observables, sauf dans l'effet. Les
premières explications alternatives des actions de la matière étaient
essentiellement animistes, qui supposaient que les structures corporelles
ont agi comme elles l’ont fait en raison de leur nature intrinsèque. Les
corps ont donc agi comme ils l'ont fait parce que c'était la nature de la
structure du corps. Il s'agissait essentiellement d'une perversion des
interprétations théistes primitives de la nature de Dieu. C’est
philosophiquement incohérent car cela alloue une structure essentiellement
indéterminée et logiquement polythéiste de l'univers. Comme on le voit
ci-dessous, même Galilée était réticent à abandonner cette explication
causale animiste en vue du potentiel d’offenser les érudits religieux de
l'époque qui avaient adopté l'explication atomiste corporelle grecque de la
science dans une structure théologique chaldéenne qui allouait une âme
éternelle à des entités vivantes. Cette théologie était la base des
structures animistes des siècles précédents.
Pour être
cohérente une structure causale monothéiste nécessite la singularité de la
causalité comme un exercice de la volonté de l'entité centrale appelée Dieu.
Cette entité logiquement ne peut pas être une pluralité, autrement une
division polythéiste de volontés est introduite ce qui soulève des
objections philosophiques du type de celles que David Armstrong a soulevées
par rapport au Dualisme et qui ne peut logiquement pas être monothéiste.
Toutes les entités qui existent sont donc logiquement subordonnées à la
volonté de la structure causale centrale que nous comprenons comme Dieu et,
en tant que telles, sont des extensions de cette volonté causale singulière.
Il est soutenu que toutes les structures qui imputent la division ou la
pluralité à la divinité ne peuvent pas logiquement être monothéistes. Elles
sont essentiellement polythéistes et créent des divisions et, en tant que
telles, leur existence doit être d'un type transitoire avec un but limité.
Ce point est abordé plus loin.
L'analyse
qui suit de la causalité est préalable à tout examen de la création qui est
déterminée par la nature de l'entité causale singulière appelée dans notre
compréhension Dieu, le Père et Créateur. C'est à cause de la réduction
logique à Dieu que les singularités dans l'origine de l'univers ont été
résistées par la science. De même, c’est venu d'une volonté de limiter les
concepts d'une structure absolutiste que les scientifiques et les
philosophes quand ils embrassent les singularités ont eu un penchant pour
les structures logiques qui rendent la singularité immanente et non
transcendante. Tel était le système de Spinoza, et les derniers travaux sur
le Royaume-Uni par Hawking et al. semblent tenter une explication fondée sur
l'immanence captive. Cette approche est une forme de Monisme plutôt que de
Monothéisme.
Toute
singularité qui est de façon cohérente monothéiste exigerait également que
les relations causales soient théoriques, qu’elles ne soient pas
désincarnées ou relatives, et que cette singularité ne soit pas
indéterminée. L'existence d'une telle singularité exigerait une structure
absolutiste de relations théoriques fixes où ces relations ont été établies
comme des lois concurrentes avec la création des entités réglementées. Une
singularité responsable de la création matérielle doit nécessairement
précéder la création matérielle étant immatérielle en structure et en
substance. Cela doit exiger aussi le fondement immatériel de la création
matérielle, sinon toutes les lois ne seraient pas théoriques, mais
matérielles observables et la structure d'origine une initiation physique ou
matérielle comme une structure immanente de la densité initiale non
compréhensible et nécessairement limitée aux capacités physiques de la
structure matérielle.
Superficiellement, un Monisme matérialiste s’appuyant à un atomisme corporel
a été attrayant depuis que les Grecs l’ont raffiné à partir de la théologie
chaldéenne et indo-aryenne. Cependant, il est gravement incohérent, à la
fois dans son incapacité à purger son schéma des éléments métaphysiques et
dans son incapacité croissante à tenir compte de la distribution ordonnée et
uniforme du système physique au fur et à mesure que la connaissance
augmente.
Il y a eu
quelques hypothèses erronées qui sous-tendent la notion de causalité et
certaines d'entre elles ont été développées pour répondre aux systèmes
animistes et polythéistes qui sont en tension avec la révélation. Les
analyses théologiques d’Aquin et d’autres de première cause contiennent
essentiellement des vues grecques de causalité. Une explication du
développement de l'explication causale et une analyse de la notion de
causalité suivent. De cela, l'importance de la causalité singulariste et les
implications en ce qui concerne la création et l'action humaine deviendront
claires :
1. Il
sera démontré qu’au lieu des approches traditionnelles concernant des
allégations de la progression de l’humain au divin comme une théologie
anthropomorphique, ce qui nécessite l'appropriation d'une âme immortelle
proche de celle de l'esprit de Dieu et tous les anges qu’il pourrait y
avoir, le schéma logiquement cohérent est plutôt une anthropologie
théomorphique et qu'il y a eu un malentendu fondamental de la part de
l'humanité concernant la nature, la réglementation et le but de la création
et le rôle de l'humanité dans cette création.
2. Nous
allons examiner et rejeter le Cartésianisme et, à partir d’un examen du
nephesh, ou de l'esprit de l'homme, montrer comment il est logiquement
nécessaire pour tout esprit ou être d'exister comme des entités au sein de
la structure de Dieu comme des parties de Dieu : ou être détruit. Le concept
de destruction étendue à la doctrine de l'âme est philosophiquement
incommode et polythéiste. Logiquement, la doctrine de l'âme doit être
rejetée en même temps que les concepts athanasiens et matérialistes
traditionnels.
3. En
effet, il sera démontré que la doctrine de l'âme est fondamentalement
polythéiste et contraire à la nature de Dieu et que Dieu est une singularité
qui contrôle.
4. Il
sera également démontré que la spiritualité de l'humanité est ce qu'on peut
appeler à juste titre un théomorphisme non-essentiel, où le divin en nous
est conditionnel et surnaturel plutôt que dérivé de nos natures.
1:2 Le Développement de l'Explication Causale
La Causalité Pré-cartésienne
L'un des
problèmes à une compréhension adéquate de la méthode biblique était le
concept de la causalité tel que compris par les Hébreux et tel que compris
par les Chaldéens et, à partir de là, par les Grecs et les Européens. Les
Chaldéens étaient animistes et donc les concepts de causalité ont été vus en
termes animistes, à savoir que les corps physiques possèdent un esprit qui
régit leur action dans un certain sens déterministe. Les Grecs devaient
hériter de cela et Aristote devait lui donner une expression formelle.
Jennifer Trusted donne une bonne et simple analyse de cela dans son ouvrage
Free
Will and Determinism, (Oxford Opus,
1984, p. 29 et suivantes). Les quatre types de causes sont les suivantes :
1. la
cause matérielle : la matière physique ;
2. la
cause formelle : le plan ou la conception de la matière physique ;
3. la
cause efficiente : la source du mouvement et/ou l'activité de la matière ;
et
4. la
cause finale : le but ou l’intention ultime de provoquer l'événement.
Maintenant, une réduction des formes de pensée loin du Monisme de Parménide
ou du théisme formel vers l'atomisme corporel restreint, qui a eu lieu avec
les Grecs et s’est poursuivi en Europe (aboutissant finalement à la création
du Positivisme et au rejet du Théisme), a eu pour résultat les concepts de
causalité qui se concentrent sur la cause efficiente comme cause dans le
sens moderne et d'autres comme modes d'explication.
Les
concepts de causes tels qu’exposés par Aristote ne sont maintenant acceptés
comme valides que pour les événements qui dépendent des actions humaines (et
peut-être de certaines actions animales). Cela est devenu ainsi parce que
l'animisme a été rejeté comme une vision de la nature. L’animisme grec
latent a affecté la pensée jusqu’à la Renaissance. Les concepts de la
doctrine chaldéenne de l'âme y étaient associés.
“Même Galileo
Galilei (1564-1642), qui est mort quelques années seulement avant Descartes,
n'était pas disposé à rejeter d’emblée le point de vue animiste des corps
célestes” (Trusted p. 30). Les concepts ici sont les
suivants :
“Si l'explication ultime de tout événement est
pensée pour être en termes de but alors il n'y a aucun problème de libre
arbitre, car la cause ultime est la volonté. Il devient insensé de demander
ce qui cause la volonté” (idem). Les pensées hébraïque et chaldéenne
sont donc en litige uniquement quant à l'entité qui veut. Les Hébreux, et en
fait tous les Théistes, soutiennent que c'est l'entité Dieu qui veut. Les
Chaldéens imputent un esprit animiste qui imprègne la matière, d'où dérive
le monisme immanent, et de façon incohérente avec cela accueillent une forme
de panthéisme dans les systèmes babylonien et indo-aryen en général.
1:2.2 Descartes et la Causalité Postcartésienne
René
Descartes (1596-1650) a introduit un nouveau type d'explication selon lequel
“les événements physiques pourraient être entièrement
expliqués en termes d'événements physiques antérieurs fonctionnant selon des
lois fixes ordonnées par Dieu” (ibid. p. 30).
Les explications téléologiques des événements, en particulier des évènements
physiques ordinaires, sont devenues assez ridicules au fur et à mesure que
la pensée devient de plus en plus matérialiste et non-théiste. Cependant,
les explications physiques des actions humaines sont également considérées
comme
“bizarres sinon effectivement ridicules” (ibid., p. 31). Par exemple :
“Pourquoi marchez-vous sur la route ?” Réponse :
“Les impulsions
nerveuses dans mon cerveau activent mes muscles.” Les
explications téléologiques, par exemple
“poster une
lettre”, sont de plus en plus confinées à la volonté
humaine, et les explications immatérielles externes sont considérées comme
sérieusement bizarres, par exemple,
“l’esprit saint m'a poussé à agir”. Ces explications précipitent de plus en plus des
enquêtes et diagnostics psychologiques qui, dans le passé, ont pu être
identifiés plus facilement avec la possession démoniaque. L'explication de
Descartes est mécaniste plutôt qu’animiste.
La
dépendance des événements physiques à l'égard d’événements physiques
antérieurs et le fait que l'événement lui-même soit la cause ou en partie la
cause des événements ultérieurs, tous régis absolument par les lois de la
nature (telles qu’ordonnées par Dieu et qui sont immuables), ont permis de
consacrer la Causalité Survenante. Les lois de Dieu pourraient être
découvertes, mais ce n'était pas à l'homme de connaître son but ultime.
Descartes était correct dans son affirmation que les lois de Dieu étaient
immuables, mais la relégation des concepts de Loi et Causalité seulement
pour l’explication physique observée et le rejet de la révélation comme loi
a entraîné le relativisme. Les concepts de la nature comme un organisme
autorégulateur et le rejet du Théisme ont vu son système adopté par le
Positivisme. La nature est devenue une machine à faire des machines de
capacité absolue, de morale relative, et de but matériel. Pour Descartes
“les lois de la nature étaient comme des lois
humaines en ce qu'elles prescrivaient ce qui se passerait, mais différentes
aux lois humaines en ce qu'elles ne pouvaient pas être violées. De là, tous
les événements physiques ont été déterminés ; ce qui est arrivé est arrivé
inévitablement et nécessairement. Dieu avait programmé la machine cosmique à
la création et elle devait se comporter selon le plan divin préétabli” (ibid.). Ce concept montre un échec de Descartes
d’analyser adéquatement le concept de la nature de Dieu et l'élément du
Libre Arbitre, deux éléments que même Augustin avait différenciés du
Déterminisme et isolés de l'erreur des Stoïciens. La liaison des causes
exclusivement à des événements physiques se traduit par un concept de
Déterminisme qui avait déjà été abordé par Aristote et impliquant les
prémisses et les conclusions suivantes :
Prémisses
1. Tout
événement physique est causé par un événement ou des événements physiques
antérieurs ;
2. Toute
cause fonctionne selon une loi pré-ordonnée de la nature qui produit
nécessairement ses effets ;
3. Toute
action humaine n'est rien d’autre qu’un événement physique ou une série
d'événements physiques.
Conclusions
1. Toute
action humaine est produite par un événement physique antérieur fonctionnant
selon une loi pré-ordonnée de la nature qui produit nécessairement cette
action ;
2. Toutes
les actions humaines sont déterminées et il ne peut y avoir aucune liberté
de choix. (Un corollaire évident est que les êtres humains sont, au moins en
principe, prévisibles.)
Comme
cette séquence constitue un argument valable, l'acceptation des prémisses
implique l'acceptation des conclusions. De cela, l'action humaine est
complètement et absolument déterminée. La vision cartésienne de
l'explication causale était que la cause et l'effet sont liés par la
nécessité logique. La causalité implique également des hypothèses de
préséance temporelle. Donc, pour que C soit la cause de E, il est implicite
que C précède toujours E en relation temporelle. Une question centrale de
causalité est celle de la distinction entre la connexion nécessaire et la
conjonction constante.
Affirmer un lien de causalité entre C et E c’est affirmer que C et E sont
nécessairement liés et ne pouvaient pas se produire séparément. Lorsque C
doit se produire, il est nécessairement le cas que C soit suivi par E. C et
E sont, pour ainsi dire, forgés entre eux par des chaînes de connexion
nécessaire.
(John Hospers An Introduction to Philosophical Analysis, Routledge and Kegan Paul Ltd.
London, 1959, p. 223)
La
conception cartésienne d’un cosmos semblable à une machine n'a pas été mise
en doute par Hume,
“mais il n'a pas mis en doute la doctrine selon
laquelle les événements ont été nécessairement liés de sorte que l'effet a
nécessairement suivi la cause et les lois de la nature représentaient des
vérités logiques.” (Trusted, loc. cit.) Hume a attaqué cette doctrine
comme découlant de l'observation empirique et comme ne nous donnant aucune
justification du tout pour l'utilisation des expressions telles que
“C est nécessairement lié à E.” Il a fait valoir qu'il n'y avait pas de connexion
logique ou nécessaire entre la cause et l'effet de telle sorte que tout
événement donné doit logiquement être suivi par un autre événement
particulier. Le sens de la relation causale consiste à la déclaration d'une
répétition sans exceptions. L'idée que l'effet est forcé de suivre la cause
est jugée
“anthropomorphique à l'origine et est dispensable.”
(Hans
Rucherbach, The Rise of
Scientific Philosophy, Berkeley,
University of California Press, 1951, pp. 157-158 ; ibid., p. 225)
La
Prémisse 2 serait donc modifiée comme suit :
2. Toute
cause fonctionne selon une loi de causalité que nous avons établie et que
nous considérons comme justifiée parce que l'expérience passée a montré une
conjonction constante de la cause avec son effet.
L'argument de Hume affirme que la connaissance des relations causales entre
les événements dépend entièrement de l'expérience passée. C'est à partir de
ce développement que l'affirmation d’Anscombe, selon laquelle le rejet de
relations serait soutenu individuellement par Hume, est faite. Les
observations de Hume étaient importantes pour démontrer que nos motifs de
croire qu'une cause donnée serait suivie par son effet étaient entièrement
fondés sur l'expérience, et non sur un raisonnement déductif logique. Il
résulte de cet argument que l'absence de théisme actif au fil du temps
relègue les explications causales aux archives et par la suite, à la
mythologie. Le résultat de cette explication causale, cependant, supprime
l'inéluctabilité logique dans la succession des événements, mais il n’exclut
pas et ne peut pas exclure la conclusion que les événements physiques sont
déterminés. Hume était donc plus déterministe que Descartes, puisque
Descartes a pris des mesures pour éviter les conséquences de l'argument
déterministe.
Descartes
a modifié la Prémisse 3 selon laquelle ‘toute action humaine n’est rien
d’autre qu’un événement physique’, en ce sens que
l'action humaine a commencé avec une volonté ou choix fait par l'âme ou
l'esprit immatériel. Comme celle-ci était immatérielle, elle ne fait pas
partie du système causal physique et n'est pas soumis aux lois de la nature.
Par conséquent les actes qui ont été initiés par l'esprit (c'est-à-dire les
actions) n'ont pas été déterminés.” (Trusted, op.
cit., p. 35)
Pour
Descartes donc, tous les événements entre les objets non humains physiques
ont été déterminés. Certaines actions humaines (réflexes) appelés par
d'Aquin les actes d'un homme (actus homini) étaient des événements, et les
actes corporels imposés par des forces extérieures étaient des événements
aussi. Seuls les mouvements volontaires initiés par l'esprit étaient des
actions non déterminées mais pouvaient être expliquées téléologiquement.
Ainsi Descartes a développé le concept de corps matériel et d'esprit
immatériel (ou dualisme esprit/corps) où l'essence de l'individu était
l'esprit immatériel. Après la mort, c’est l'esprit qui survit comme un
esprit immatériel. Il a ainsi établi une nette distinction entre les actions
et les événements comme des actes volontaires ou événements déterminés. À
partir de cette distinction et de cette explication, Descartes était en
mesure d’accommoder la Doctrine chaldéenne de l’Âme qu'il avait héritée en
tant que Chrétien Athanasien suite aux développements réalisés par Socrate.
Descartes
était tombé dans le même argument essentiellement polythéiste qui découle de
l'affirmation d'entités dont la volonté n’est pas en accord avec la volonté
de Dieu. Comme on le verra ci-dessous, le mal doit résulter de divisions au
sein de la Divinité ou la famille de Dieu, autrement, il y a une limitation
inévitable et inéluctable de la puissance de Dieu. Dieu n'est plus
omnipotent. Les entités doivent exister dans la volonté de Dieu avec la
liberté de sortir de cette volonté, ce mouvement constituant une rébellion,
ou de rester au sein de la volonté dans l'unité d'esprit et de but. Le
problème fondamental de Descartes, et c’est effectivement le problème de
tous les systèmes basés sur la Théologie chaldéenne impliquant une âme
immortelle, est que la création d'une âme immortelle par Dieu implique
nécessairement la production d'un être imparfait, qui, par sa situation, est
externe à la volonté de Dieu et logiquement polythéiste. L'ontologie
complexe qui est nécessaire pour la production et la destruction de l'âme
(ou dans le Monisme, son absorption) et l'explication de son être est
incohérente comme système philosophique logique. Descartes ne peut pas
éviter les problèmes soulevés dans le cadre général du Problème du Mal dans
ses affirmations de Dualisme Esprit/Corps. Les explications ultérieures des
divisions au sein de la Divinité et du problème du mal sont applicables à la
forme élitiste de Descartes du polythéisme, car elles sont également en
réfutation de la Doctrine de l'Âme en général.
Un examen
des Théories Matérialistes de l'Esprit, ainsi que des problèmes de la
Mécanique Quantique et autres problèmes, transporte l'explication formelle
au-delà des incohérences du Cartésianisme, de la Théologie Chaldéenne et du
Matérialisme Positiviste en général. Il devrait être évident de ce qui
précède que les concepts de causalité sont fondamentaux pour notre notion
des mécanismes régulateurs de l’être comme des lois régissant le
fonctionnement de la structure. Non seulement nos concepts déterminent notre
capacité à agir comme un exercice de notre volonté mais ces concepts
déterminent également s’il y a une tension entre toute structure
singulariste réputée exister et le fonctionnement des entités au sein de
relations théoriques sous une idée de la liberté d'agir à l’intérieur d’eux
(ou à l’extérieur) en contravention avec les relations théoriques. Ces
points de vue des concepts de la capacité d'agir doivent également affecter
n'importe quelle vue de la liberté et du déterminisme au sein de la volonté
de la singularité. Les jugements prennent ainsi place sous l'idée de liberté
que Kant a démontrée, et une sous-structure immatérielle à la matière
implique nécessairement des explications métaphysiques de l'interaction
causale. Le concept de volonté inclus dans l'idée de connexion nécessaire
est aussi une idée de l'effet à produire : mais on arrive à cela en
observant la conjonction constante. La volonté a été définie par Kant comme
le pouvoir de se déterminer à l'action conformément à notre conception de
certaines lois (gr, 427). (H. J. Paton a attiré l'attention sur les
conséquences de cela dans
The Categorical Imperative, Hutchinson de Londres, 4e éd., 1963, p. 208.)
Donc, pour Kant, nos jugements, et non pas seulement les actions dans le
sens ordinaire, s’inscrivent dans le cadre de l'Idée de Liberté.
1:3 Les Aspects Métaphysiques de la Science et de la
Matière
La
science, en tant que produit philosophique de l'atomisme corporel, a
habituellement rejeté les notions de métaphysique et de théisme, en grande
partie parce que les revendications de la théologie chaldéenne au sein d'une
structure pseudo-chrétienne étaient manifestement incohérentes par
l'observation, et que leur reconstruction théologique anthropomorphique
était finalement et manifestement fallacieuse. Toutefois, ce rejet total a
sans doute limité la compréhension en fin de compte de la structure théiste
correcte. La notion de causalité implique des hypothèses concernant
l'observation, mais les notions fondamentales de la structure atomique dans
le paradigme scientifique actuel de la mécanique quantique sont incapables
de vérification scientifique et impliquent nécessairement la spéculation
métaphysique.
Sir Karl
Popper a examiné ce problème dans le cadre de la mécanique de la théorie
quantique (The Logic of Scientific Discovery, Hutchinson, 1986, pp. 215-221). Dans une tentative
d’étudier le comportement des électrons, Heisenberg a examiné la possibilité
de contrôler la trajectoire d'un électron entre deux expériences. À propos
de ces calculs exacts Heisenberg déclare :
“La
question de savoir
si l'on doit attribuer une quelconque réalité
physique à l'histoire passée calculée de l'électron c’est une pure question
de goût” (cité par Popper à la p. 220. La traduction en
anglais de Die Physikalische Prinzipen der Quantantheorie de
Heisenberg, 1930, p. 15 à la p. 20 dit que
“c’est une question
de conviction personnelle”). Si une
déclaration au sujet de la position d'un électron dans les dimensions
atomiques n'est pas vérifiable alors nous ne pouvons pas attribuer un sens à
cette déclaration.
“Il est impossible de parler de sa trajectoire
entre les points où il a été observé.” Même ainsi,
“il est possible de calculer une telle trajectoire
insensée ou métaphysique en termes de la nouvelle formulation” (ibid.). Selon Popper, Heisenberg a échoué à mener
à bien son programme. La théorie n’admet que deux positions, la première ou
la position subjective où la particule a une position exacte et une quantité
de mouvement exacte (et donc aussi une trajectoire exacte) mais il est
impossible pour nous de les mesurer toutes les deux simultanément.
“Si c’est le cas, alors la nature est encore résolue
à cacher certaines magnitudes physiques à nos yeux” (ibid.). (Popper considère que tant la position que
la quantité de mouvement (la trajectoire) sont cachés). Le principe
d'incertitude est donc considéré comme une limitation de notre connaissance
et donc subjectif.
La
deuxième ou position objective affirme qu'il est inadmissible, incorrect ou
métaphysique d’attribuer à la particule quoi que ce soit qui ressemble à une
trajectoire nettement définie. Elle ne possède qu’une position exacte avec
une quantité de mouvement inexacte, ou vice versa. Mais selon Popper, si
nous acceptons cette interprétation alors, à nouveau, la formulation de la
théorie contient des éléments métaphysiques, puisque le
“chemin” est calculable exactement pendant le temps où il
est, en principe, impossible de le tester par l'observation (ibid., p. 221).
Selon Popper
“Heisenberg n’a pas encore accompli la tâche
qu'il s'était imposée : il n'a pas encore purgé la théorie quantique de ses
éléments métaphysiques” (ibid.). C'est ainsi que les relations
causales doivent finalement être théoriques et que certaines magnitudes
physiques restent inconnues.
L'une des
hypothèses plutôt banales de la mécanique quantique est qu'un observateur
divin interférerait avec le fonctionnement du système dans le processus
d'observation. La mécanique quantique a spéculé sur la question des
observateurs pendant un certain temps. Une proposition a été faite par James
Clerk Maxwell en ce qui concerne ce qui est maintenant connu comme le démon
de Maxwell. Le démon préside à une porte séparant deux compartiments, dont
l'un contient du gaz et dont l'autre est vide.
Le démon
observe le système et permet des molécules chaudes ou en mouvement rapide de
passer à travers la porte centrale, transférant ainsi l'énergie. Les
scientifiques n'ont pas réussi à prouver que le démon ne peut pas exister,
mais ils sont également peu disposés à abandonner les lois de la
Thermodynamique. La proposition violerait la deuxième loi de la
Thermodynamique et ainsi les deux positions sont mutuellement exclusives.
Carlton
Caves de l'Université de Californie du Sud a tenté d'utiliser la théorie de
l'information pour montrer comment un démon peut extraire de l'énergie à
partir d'un gaz. Caves utilise un démon théorique appelé un démon
“Unruh” dans ce qu'on
appelle un
“moteur Szilard”. Rolf Landauer
d'IBM à Yorktown Heights, New York, a montré en 1988 que le moteur Szilard
gagne de l’énergie en laissant tomber une cloison dans une boîte après avoir
déterminé de quel côté une molécule se trouve, avec le résultat que
l'interférence avec le flux d'énergie amène le piston opposé au centre et
que la force de recul agissant sur le piston après le retrait de la
cloison transfère une quantité quantifiable d'énergie. Le gain d'énergie,
toutefois, est annulé par l'énergie dépensée par le démon. Caves a amené
cela un peu plus loin en limitant l'activité du démon Unruh au
fonctionnement des banques de boîtes quand et seulement quand la molécule se
trouve du même côté de chacune des dix boîtes de la banque résultant en un
gain net d'énergie. (Voir Physical Review Letters, Vol. 64, p. 2111).
Dans Physical Review Letters, Vol. 65, p. 1387, un séminaire à Santa
Fe a limité les activités du démon Unruh au sein de la deuxième loi de la
Thermodynamique par l'inclusion d'un coût d'effacement supplémentaire qui,
même dans le cadre du schéma le plus efficace réduit le gain d'énergie
maximal possible à zéro.
Les
hypothèses sous-jacentes ici sont que le démon ou l'entité est liée par les
lois de l'atomisme corporel nécessitant des transferts d'énergie nette en
réaction physique. Ceci repose sur une fausse prémisse et sur une hypothèse
non vérifiée qui est liée à une fausse prémisse. Tout d'abord, tout être
omniscient ou toute entité qui a reçu le pouvoir d'agir par un être
omniscient connaîtrait nécessairement les résultats de toute réaction ou
séquence causale mise en mouvement puisque les relations théoriques sont
connues a priori et que les lois concernées ne sont pas désincarnées mais
déterminées et existent logiquement avant la création.
Il n'est
donc pas nécessaire d'observer dans quelque sens technique que ce soit.
Deuxièmement, l'hypothèse que l'entité entraîne des transferts d'énergie
physique est une spéculation anthropomorphique basée sur l'atomisme corporel
qui ne parvient pas à venir à bout de la nature immatérielle de la matière
sous-subatomique. Il n'y a aucune raison de supposer que l'entité qui
observe est logiquement limitée au ou par le support physique qu'elle
observe. Même si tel était le cas, il n'y a aucune raison logique de
supposer que deux entités différentes convertiraient l'énergie exactement de
la même manière ou d'une manière similaire. La physique peut évoquer un
démon hypothétique pour satisfaire la spéculation mécanique quantique, mais
elle rejette immédiatement le postulat d'une telle entité non-physique dans
une ontologie plus compliquée.
Roger
Penrose a postulé dans son ouvrage
The
Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds and the Laws of Physics, Oxford, 1989, que c’est l'influence
gravitationnelle de l'appareil de mesure et non la présence abstraite d'un
observateur qui a un effet sur les états physiques. Au niveau quantique,
la structure atomique de base présente un certain nombre d’états différents
possibles qui sont en quelque sorte
“superposés” les uns aux autres. Le physicien, en mesurant ces
états, démolit en quelque sorte les états superposés en un seul état de
sorte que seule l'une des possibilités semble avoir eu lieu. La physique
quantique est donc non seulement incompatible avec les événements
macroscopiques, mais d’une manière ou d’une autre dépendante de
l'observation humaine, et donc quelque peu anthropomorphique. Penrose
postule que, à un niveau intermédiaire entre les domaines quantique et
classique, les différences entre les états superposés deviennent importantes
de manière gravitationnelle, de sorte qu'ils s'effondrent dans un état
unique, tel que les physiciens peuvent le mesurer. Cette gravité quantique
penrosienne, croit-on, peut aussi contribuer à expliquer ce que l'on appelle
les effets non-locaux dans lesquels les événements survenant dans une région
affectent les événements survenant dans une autre région simultanément.
L'apparition de la non-localité a été tout d’abord indiquée par l'expérience
de Pensée d'Einstein-Podolsky-Rosen. Nous avons vu ailleurs que la
transmission simultanée d'idées est largement observée, à savoir la matière
de Lorentz. La non-localité observable peut être trouvée par exemple en
mesurant la rotation d'un photon émis par une particule de décomposition. Un
photon émis simultanément par la particule dans la direction opposée de la
même façon voit son spin
“fixé” par l'autre mesure, même si les particules peuvent
être à des années-lumière de distance. Il peut y avoir quelques problèmes
avec les propositions de Penrose, mais les implications pour l'esprit humain
méritent un examen plus approfondi, en particulier les concepts selon
lesquels les processus physiologiques sous-jacents à une pensée donnée
peuvent initialement impliquer un certain nombre d'états quantiques
superposés, dont chacun effectue un calcul de toutes sortes. Il suppose que
lorsque la distribution de masse et d'énergie entre les états atteint un
niveau significatif gravitationnellement les états s'effondrent en un seul
état, provoquant des changements non-locaux mesurables et possibles dans la
structure neuronale du cerveau. Cet événement physique est en corrélation
avec un évènement mental, d'où la formulation de la pensée comme la
compréhension, à la différence de l'intelligence artificielle. Ces
propositions méritent un examen plus approfondi en raison de leurs
implications pour la pensée humaine, l'interaction physique, et la notion de
causalité.
1:4 Tester les Conceptions de Causalité
Compte
tenu de ce qui précède, nous devrions tester les conceptions de causalité
pour établir s'il y en a de sérieuses, et si toutes les conceptions sont
sérieuses voir quelles déductions en matière de moralité et de
réglementation peuvent être tirées.
Les Hypothèses de Hume
Depuis
l'époque de Hume, l'opinion philosophique la plus répandue est que pour que
deux événements soient causalement liés, la relation doit être une instance
d'une loi causale, qu’elle soit fondamentale ou dérivée et qu’elle soit
probabiliste ou non probabiliste. Un concept singulariste de causalité a été
rejeté comme étant incohérent en raison de son affirmation selon laquelle
deux événements peuvent être causalement liés contrairement avec ce qui
précède. L'hypothèse selon laquelle les relations causales ne sont pas des
relations théoriques est devenue endémique à la philosophie de la causalité.
G. E. M. Anscombe (dans
“Causalité
et Détermination”, Causation and
Conditionals, Éd. E Sosa, Oxford, Oxford
University Press, 1975, pp. 63-81) a identifié le problème, mais a mal
diagnostiqué l'emplacement et elle semble elle-même partager l'hypothèse. Sa
position semble provenir d'une mauvaise compréhension de l'argument de Hume.
La Professeure Anscombe (de
“Temps,
Commencements et Causes” dans
Rationalism, Empiricism and Idealism, Éd. Anthony
Kenny, Oxford Clarendon, pp. 56-103) note que l'argument de Hume est venu à
être considéré comme s'il s'agissait d'une définition partielle, résultant
dans l'argument selon lequel certains objets ne peuvent pas être reliés
causalement juste parce qu'il y a une nécessité logique de l’un par rapport
à l'autre. Elle soutient que, tandis qu'il aurait rejeté des
contre-exemples, il aurait plaidé contre chacun d’entre eux
particulièrement. Le problème avec les applications de Hume est traité
ailleurs.
1:4.2 L’Idée/Ideatum et l’Existence sans une Cause
Elle fait
la proposition intéressante à la p. 91 quant à la possibilité de l'argument
de l'imagination, la possibilité découlant de la position selon laquelle
“nous pouvons imaginer un début d'existence sans
cause, donc il peut y avoir un début d'existence sans une cause.” Cela semble être plutôt comme accepter une moitié
du Monisme parménidien pour rejeter l'autre moitié nécessaire. Cependant, le
point à mettre en place est essentiellement la supposition qu'une pensée est
considérée comme n’étant
“pas un événement
psychologique, mais comme le contenu d'une proposition, la possession
commune de nombreux esprits.” La notation d’Anscombe des arguments de
Thomas d'Aquin et Hume (p. 92) est la suivante :
Thomas
d'Aquin :
Il est
possible de comprendre les existants sans la relation de fait pour causer ;
par
conséquent, cette relation n'appartient pas au concept des existants ;
par
conséquent, ils peuvent être dépourvus de cette relation.
Hume :
Il est
possible de concevoir un objet venant à l’existence sans qu'il y ait une
cause ;
il est
donc possible d'imaginer un objet venant à l’existence sans qu'il y ait une
cause ;
il est
donc possible pour un objet de venir à l'existence sans cause.
D’après
l'égalité du temps et de l'espace de Hobbes,
“l'objet ne peut
jamais commencer à être en raison d’un manque de quelque chose pour arranger
son commencement”, comme Hume l’a rendu, mais Anscombe cite le
passage correct de
The English
Works of Thomas Hobbes, Vol. 4, p. 276, où Hobbes
introduit la nécessité de l'éternel en l'absence d'une cause particulière
(Anscombe dans Kenny, op. cit., p. 93). Anscombe dit :
“un commencement d'existence implique l'existence de
quelque chose d'autre que ce qui commence à exister, même si l'implication
est satisfaite par le simple processus au sein de cela. Si, en effet, nous
parlons du début de l'existence de l'univers, c'est la seule façon que
l'implication puisse être satisfaite” (ibid., p. 97).
À partir
des grandes lignes d’Anscombe et de Thomas d'Aquin, Hobbes et Hume, les
relations théoriques sont possibles et, à partir de la conséquence externe
de cause première, un concept singulariste de causalité se développe. Il
semble y avoir une admissibilité de la possibilité d'une causalité
singulariste dans l'argumentation ultérieure d’Anscombe qui surmonte la
mauvaise identification de la précédente. L'argument de la préexistence
potentielle d'un élément dans son fait de venir à être permet une préséance
métaphysique. L'absurdité d'un continuum espace-temps comme une proposition
linéaire ne fait que renforcer cette notion de causalité théorique. Le
manque de compréhension des origines n'est pas un défaut de l'objet, mais
simplement de l'observateur.
Selon
Michael Tooley (The
Nature of Causation: A Singularist Account, p. 21,
un document en cours de publication
au moment de la rédaction de cet ouvrage),
pour écarter une conception singulariste l'argument de Hume nécessite une
supplémentation.
Il doit
être prouvé que la causalité doit être réductible à des propriétés et des
relations observables. Les deux possibilités, qu'il s'agisse de traiter
spécifiquement de la causalité ou d'une thèse générale selon laquelle toutes
les propriétés et les relations doivent être soit observables soit
réductibles à des propriétés et relations observables, sont exclues par les
capacités actuelles, comme indiqué ci-dessus par Popper, et la nature
non-physique ou métaphysique de la matière semble certaine. La réduction de
la causalité de ce qui précède est éliminée comme une possibilité, ouvrant
ainsi la possibilité singulariste basée sur les relations théoriques.
Leibniz, l'Harmonie et l'Atomisme Corporel
Hide Ishiguro aborde cette possibilité quand
il traite avec l’ouvrage de Leibniz (“L’Harmonie
Préétablie Versus la Conjonction Constante : Un réexamen de la Distinction
entre le Rationalisme et l'Empirisme” dans
Rationalism, Empiricism and Idealism, Éd Anthony
Kenny, Oxford Clarendon, 1986, pp. 61-85). Leibniz a rejeté la doctrine
philosophique de l'interaction causale.
“Ses désaccords
avec Descartes et avec Newton sur les lois de la dynamique n’ont jamais
concerné la question de savoir s’il existe des lois déclarant
l'interconnexion des choses matérielles. Ils concernaient uniquement la
façon dont les lois doivent être formulées” (ibid., p. 65). Lord Russell a mal compris
Leibniz à cet égard quand il a écrit que, selon Leibniz
“rien n’agit vraiment sur quoi que ce soit d'autre
!” (The
Philosophy of Leibniz, p. 93, et ibid., p. 62).
Ishiguro soutient que Leibniz était préoccupé par le rejet de la théorie
alors en vigueur de l'influx qui, pensait-il, impliquait le détachement des
qualités des substances (et donc le passage dans la Monadologie à 7
GVI p. 607 ; L.p. 643). Le rejet impliquait l'impossibilité du transfert de
la substance matérielle du corps à une qualité immatérielle de l'esprit. Le
système était basé sur un concept de Leibniz selon lequel il y avait des
entités simples ultimes. Maintenant, il semble que cette hypothèse ait été
exploitée par les atomistes corporels et que cette spéculation soit
foncièrement incorrecte, non pas en ce qui concerne l'existence de simples
ultimes, mais en raison d'hypothèses sur leur nature corporelle plutôt que
d'un postulat logique de l'existence de simples immatériels
sous-subatomiques. Anscombe constate que la notion de causalité vient de
celle de dérivation qui peut être immédiatement saisie par la perception. Là
encore, il s'agit d'une erreur d'identification de la nature des relations
causales.
1:5.1 Hume et Leibniz
Or, tant
Leibniz que Hume font valoir que de dire que la cause efficiente est ce qui
produit, c’est utiliser uniquement des synonymes (Leibniz,
New Essays Concerning Human Understanding, II 26,S1 ; et Hume, Treatise, Partie III,
Section 4, p. 157). Alors qu'est-ce que Leibniz et Hume ont établi ? Leibniz
semble faire valoir dans le cadre de la physique limitée de son époque ;
limitée par des présuppositions de l'atomisme corporel, pour une conception
harmonieuse de causalité qui devient incohérente non pas par sa tentative
d’harmonie causale singulariste mais par craintes métaphysiques incorrectes.
1:5.2
La Position de Hume
De même,
Hume a des revendications faites en son nom sur ce que son argumentation
établit, mais il est utile d'établir la position avec précision.
Premièrement, elle montre que la causalité n'est pas directement observable
dans le sens technique du terme et ne peut donc pas être une relation
inanalysable primitive entre les événements. Deuxièmement, compte tenu des
lacunes causales radicales, la causalité ne peut pas être réduite à des
propriétés observables et à des relations entre différentes paires
d'événements. Ainsi, la possibilité demeure que la causalité est tout
simplement une relation observable entre des évènements individuels. La
supplémentation nécessaire à l'argument de Hume pour écarter une conception
singulariste de la causalité de ce qui précède ne semble pas plausible.
L’Harmonie
La
concomitance notée par Ishiguro rend la nature compréhensible même si la
structure métaphysique de la causalité est mal comprise. La doctrine de
l'harmonie préétablie est donc un concept métaphysique qui, comme je l'ai
établi ci-dessous, était la conception originale. La loi, telle qu'elle est
comprise par les patriarches bibliques, était fondée sur un concept d'unité
métaphysique régie par des lois absolues et donc l'inclusion du spirituel
avec les lois physiques dans le Décalogue et leurs interrelations. Ishiguro
note correctement que
“Dieu ne peut pas créer des lois désincarnées.
Les substances et les lois sont fixées en même temps. En créant un univers
régi par la régularité semblable à la loi, Dieu n’exécute pas deux actes
distincts de la création. En établissant les lois, Dieu ne nous donne pas
seulement une façon de décrire les choses par les propriétés relationnelles
extrinsèques ou contingentes” (Ishiguro, p. 72).
Or, la
création de relations théoriques n'est pas limitée logiquement aux
substances matérielles et ainsi une loi non liée à la matière est uniquement
désincarnée dans le sens où elle n'est pas une relation entre les corps
physiques. Les aspects théoriques de la réglementation émanent alors d'une
cause singulariste dans un sens immatériel préliminaire. Le spirituel
immatériel est donc logiquement antérieur à la matière.
1:6.1 Les
Aspects Erronés de la Causalité
Singulariste
Dans
l'explication d'une conception singulariste de la causalité, il est
nécessaire de noter les aspects erronés de la notion.
L’Expérience Immédiate
L'argument en faveur d'une conception singulariste de causalité qui suit de
l'expérience immédiate des relations causales est bancal si l'on part de
différents mondes possibles familiers, comme le note Tooley, qu'il s'agisse
du point de vue de Berkely ou de la perception à partir d'une activité
cérébrale isolée. Il s'ensuit que rien de ce que l’on était conscient dans
l'expérience perceptive serait une cause de quoi que ce soit d'autre.
L'argument est donc mal fondé. Il ne ferait cependant pas obstacle à
l'influence de l'action par l'altération de la perception par l'influence de
l'activité du cerveau, à savoir la stimulation ou le conditionnement. C'est
à partir de ces concepts de la capacité de modifier la perception que le
concept pris comme une hypothèse au début a été fait, à savoir qu’à partir
de l'empirisme une idée ne peut être traitée comme analytiquement
fondamentale que si elle sert à isoler des propriétés ou des relations que
l’on connaît directement, et c'est pour cette raison que la causalité a
besoin d'analyse, ne pouvant pas être traitée comme fondamentale.
L’Observabilité
Nous
avons déjà traité de la nature théorique des relations causales et de
l'affirmation selon laquelle l’argument de l'observabilité des relations
causales n’est pas fondé. La connaissance ainsi obtenue est déductive et la
connaissance préalable est celle d'une généralisation causale qui s'applique
au cas observé. S’il en est ainsi, alors les cas de connaissance perceptive
ordinaire de relations causales ne peuvent pas être utilisés pour démontrer
l'existence d'événements causalement liés qui ne relèvent pas des lois
causales. L'absence de connaissance préalable causale ne peut montrer les
relations causales que lorsque la cause et l'effet présentent une complexité
pertinente, et une telle complexité signifie que l'observation en est une
impliquant un certain nombre de cas de la loi pertinente. Un tel constat
rend probable qu'il existe une loi pertinente. Les observations ne déduisent
les relations causales que si elles déduisent également que l'événement est
un exemple d'une loi causale. Ainsi épistémologiquement une conception
singulariste échoue.
1:6.2
La Causalité Survenante et
Intermédiaire
Michael
Tooley a offert (dans Causation) une discussion d’arguments qui tentent
d'établir un concept singulariste de causalité en rejetant les alternatives.
Il commence par la vue de survenance dominante qui veut que les événements
ne peuvent être reliés de manière causale à moins que la relation ne soit
une instance d'une loi, la relation causale étant logiquement déterminée par
les propriétés non causales des deux événements, et par les relations non
causales entre eux ainsi que par les lois causales qu'il y a dans le monde.
Le point de vue de la survenance soutient :
1. les
relations causales présupposent des lois correspondantes ;
2. les
relations causales sont logiquement survenantes sur les lois causales ainsi
que sur les propriétés non-causales des événements et des relations entre
eux.
Il
s’ensuit que le point de vue de la survenance et la vue singulariste sont
suivies par une position intermédiaire conséquente sur le refus de la
deuxième thèse ci-dessus. La position serait que les relations causales
présupposent les lois causales correspondantes, même si les relations
causales ne sont pas logiquement survenantes sur les lois causales avec les
propriétés non-causales des événements et des relations entre eux.
1:7 Les Contre-Arguments
Les
arguments en faveur d’une conception singulariste qui s’opposent aux vues
survenantes et intermédiaires se divisent en deux parties. Ces arguments
sont au nombre de trois :
1:7.1
L'Argument de la Possibilité de Lois
Indéterministes
qui
implique l'hypothèse que les lois causales indéterminées sont logiquement
possibles.
Réponse A
: Parce que les relations causales se tiennent entre les états de fait et
tandis que les expressions disjonctives peuvent être utilisées pour
sélectionner des états de fait, les états de fait ne peuvent jamais être
disjonctifs dans la nature.
Réponse B
: (voir Tooley, Causation, op. cit, ch. 8) Du point de vue de la
survenance, les relations causales entre les états de fait sont logiquement
survenantes sur les lois causales ainsi que les états de fait non-causals.
Les seuls faits de causalité de base qui doivent être postulés sont ceux qui
correspondent aux lois causales, et ces faits doivent être identifiés avec
certaines relations contingentes entre universaux.
1:7.2
La Conception Singulariste
qui
soutient la nature primaire des relations causales. Les conceptions de
régularité de la nature des lois sont opposées par une forte opposition (par
exemple Fred I. Dretske,
“Lois de la Nature” dans
Philosophy of Science, p. 44, 1977, et David M. Armstrong,
What is a Law of Nature,
Cambridge University Press, 1983), par conséquent une conception singulariste
combinerait cela avec la vue selon laquelle les lois sont les relations
entre les universaux.
Les deux
approches exigent toutefois une conception de la nature des lois et les deux
échouent : de façon survenante en distinguant les lois causales des lois non
causales et de façon singulariste dans l'explication des relations causales
en conjonction avec celle d'une loi pour expliquer ce qu'est une loi
causale.
1:7.3 La
Conception Intermédiaire
De Tooley, Causation, pp. 268-274,
dans la conception intermédiaire, si l'exclusion de la causalité
anomique doit être compréhensible, une conception distincte de la nature des
lois causales est nécessaire. Les alternatives à un concept singulariste de
causalité sont exclues ; dans la vue de la survenance de certains cas
logiquement possibles impliquant des lois causales indéterministes, et le
point de vue intermédiaire est ontologiquement plus impliqué ou moins
économique que le point de vue singulariste. Ces arguments relatifs aux
trois points de vue s'appliquent à l'Argument de la Possibilité de
Répliques Exactes des Situations Causales et aussi à l'Argument
de la Possibilité des Univers Inversés. Dans ce dernier cas, l'Argument
de l'Inversion de la Direction du Temps verra certaines lois exclure
l’inversion et d'autres non.
1:8
La Direction du Temps
Si l'on
peut soutenir l'hypothèse selon laquelle la direction du temps doit être
analysée en termes de la direction de la causalité, alors un contre-exemple
à la vue de la survenance de la causalité peut aussi être soutenu. À partir
d’Einstein, le postulat est fait que l'espace, la matière, le temps,
l'énergie et la gravité sont tous des expressions équivalentes et
interdépendantes d'une seule essence fondamentale. Cette essence, selon
James Jeans, ne peut être décrite dans n’importe quel sens matériel. Cela
impliquerait que la relation de causalité est limitée par son incapacité à
s’appliquer universellement sous des hypothèses de temps inversés. Alors que
nous avons vu que la relation est théorique, ces relations sont dans
certains cas fixes non réversibles indiquant une notion de relations
théoriques fixes. Il est à noter que Stephen Hawking (A Brief History of Time) semble appliquer les lois sous des hypothèses de
temps inversés, faisant des déductions à partir de ces lois en ce qui
concerne les singularités qui peuvent ou ne peuvent pas être valides.
La
notation des résultats de Tsung-Dao Lee et Chen Ning Yang est utile (ibid.,
p. 77 et suiv.). Leurs conclusions que la symétrie des particules et des
antiparticules est telle que parmi les Symétries C, P et T, les interactions
faibles ne respectent pas la Symétrie P, qui suppose que le spin des
particules et des antiparticules est une image miroir. L'hypothèse de
Symétrie P est telle que
“si vous inversez la direction du mouvement de toutes
les particules et antiparticules, le système doit revenir à ce qu'il était
aux temps anciens, en d'autres termes, les lois sont les mêmes dans la
direction avant et arrière du temps” (ibid.).
Chien-Shung Wu aurait prouvé la justesse de leurs prédictions en 1956 en
démontrant que les électrons étaient envoyés plus dans une direction que
l'autre au moyen de l’alignement des noyaux des atomes radioactifs dans un
champ magnétique. Il a également été constaté que les interactions faibles
ne respectent pas la symétrie C de sorte qu'un univers composé
d'antiparticules se comporterait différemment de notre univers. Néanmoins,
il semble que l’interaction faible respectait la symétrie CP combinée.
Cronin et Fitch ont découvert que
“la symétrie CP n’était pas respectée dans la
désintégration de certaines particules appelées mésons K” (ibid.). Hawking dit de cela :
“Cronin et Fitch ont montré que si l’on remplace des
particules par des antiparticules et que l’on prenne l'image miroir, mais
qu’on ne renverse pas la direction du temps, alors l'univers ne se comporte
pas de la même façon. Les lois de la physique, par conséquent, doivent
changer si l'on inverse la direction du temps : elles ne respectent pas la
Symétrie T” (ibid.). L’expansion/contraction de l'univers
exempterait une de ces combinaisons.
L'hypothèse de la mécanique quantique de la structure matérielle de la
prépondérance des quarks est académique et introduit simplement une étape
intermédiaire dans la réduction proposée ici. Il y a donc une directivité
apparente de temps et donc une certaine directivité de la causalité. La
causalité a besoin d'analyse beaucoup plus détaillée et nécessite une
dissertation explicative supplémentaire qui n’est pas proposée dans le
présent document.
1:9 La
Transmission Simultanée des Idées
À la
suite de l’hypothèse de l'atomisme corporel concernant la structure de la
matière et les explications de l'action humaine, il nous reste à affirmer
que les actions physico-chimiques sur le corps sont l'explication causale de
la pensée humaine et de la production d'idées. La transmission simultanée
d'idées, cependant, pose des problèmes métaphysiques graves pour les
théories matérialistes de l'esprit et l’explication causale qui est
survenante physico-chimique et donc non singulariste.
Les
observations de la transmission simultanée d'idées sont trop bien connues
pour être niées et trop récurrentes pour être des coïncidences. Les
matérialistes sont toutefois illogiquement conduits en interne à revendiquer
la coïncidence comme l'alternative, exigeant une explication causale externe
qui implique la suggestion externe et l'influence sur l'esprit humain par
l'implantation de nouvelles idées. L’émergence concomitante de la pensée
indique une externalité immatérielle de connaissances et de puissance
supérieures. Les différences d'observation et de perception des idées
simultanées étaient évidentes, par exemple, dans les théories de
Lorentz/Fitzgerald. La perception des relations et de la causalité est
variable, et la théorie de Lorentz postule que
“les observateurs dans les différents cadres de
référence signaleront des résultats différents pour la mesure de la longueur
d'un même objet dans la direction du mouvement.” (Stanley
Goldberg,
“Comprendre la Relativité” dans
Origin and
Impact of a Scientific Revolution, Oxford Science
Publications, Clarendon, 1984, pp. 124-125). L'explication de Lorentz, selon
laquelle l'objet est coincé dans la direction du mouvement en raison des
interrelations électromagnétiques entre l'objet et l'éther à travers lequel
il se déplace, est accessoire au problème.
Ce qui
est important pour la question qui nous concerne ici, c’est que Lorentz et
Fitzgerald sont venus à la même notion à peu près au même moment dans à peu
près le même contexte. Goldberg dit :
“les idées sont
dans l'air, et souvent plusieurs personnes feront simultanément les mêmes
suggestions sur les phénomènes naturels et vont construire le même genre
d'argument” (loc. cit.). Ce concept a une importance pour
les notions et les perceptions de causalité qui sont directement applicables
à des notions morales et qui contribuent au relativisme dans les concepts
moraux. C’est le reflet de la déclaration d’Anscombe et cela se rapporte
directement à la proposition selon laquelle les idées en tant que
propositions externes permettent l'influence sur l'esprit humain. Par
conséquent, ce ne sont pas toutes les pensées qui sont des événements
psychologiques individuels. De là l'immatériel influence le matériel. Tout
ce qui contrôle cette émanation de la pensée influence l'action humaine,
d'où le concept selon lequel Satan, en tant que Dieu de ce monde, est le
Prince de la Puissance de l'Air (Éphésiens 2:2).
Il est
utile de noter que même dans le domaine physique, la variance se produira
lors de la mesure de masse en raison des différences entre la masse propre
ou au repos et la masse non propre ou en mouvement. La variance se produit
en raison d’un désaccord sur les jugements de la simultanéité (ibid., p.
147). Donc, en un sens, la masse au repos est un invariant au comportement
identique à la notion newtonienne de masse. C’est une simplification
inacceptable que d'utiliser la théorie de la relativité pour soutenir un
point de vue selon lequel
“toutes les choses sont relatives”, même si l'expression
“toutes les choses” se réfère à des
objets en physique (ibid.).
Au sein
de la relativité la théorie est réellement des mesures réelles, mais cela
n'implique pas une variabilité causale conditionnée, mais plutôt à partir
des conclusions sur les changements de vélocité, nous déduisons des
changements dans la masse. C’était en rectifiant les relations théoriques de
masse que le concept d'une loi (dans ce cas-ci, la loi de conservation de la
quantité de mouvement) pourrait être maintenu et ce en l'absence de preuves
empiriques. D’après la théorie de la relativité générale l'effet de masse
doit déformer l'espace classique.
“La théorie de la relativité générale ne tient
pas compte des origines de l'univers, ni de la source de masse. Elle
n'explique pas la nature de l'univers. Ce qui a été généralisé ce sont les
notions de longueur et de temps” (ibid., p. 177).
À partir
de la transmission simultanée d'idées, le déterminisme téléologique comme un
événement physico-chimique du cerveau est difficile à maintenir, admet une
action non-physique, et nécessite une restructuration radicale de la notion
de causalité. La simplification de Jennifer Trusted du déterminisme physique
à la causalité physique directe ou survenante (Free
Will and Responsibility, Oxford Opus 1984, p. 6) montre l'absurdité de
faire reposer une structure sur l'atomisme corporel lorsque la nature de
l'univers est inconnue.
La
structure de l'univers ne peut être déterminée métaphysiquement que par
l'application de la logique et, du détail de causalité présenté ici, il est
soutenu que la causalité singulariste est le récit le plus convaincant et
que la singularité est nécessairement immatérielle et logiquement antérieure
à la matière.
1:10 Les
Propriétés Essentielles d'une Définition de la Causalité Singulariste
Michael
Tooley a produit une déclaration formelle d'une conception singulariste de
causalité qui possède quatre propriétés formelles :
1. elle
est nécessairement antiréflexive ;
2. elle
est nécessairement asymétrique ;
3. elle
est nécessairement transitive ;
4. les
boucles causales sont impossibles.
L’asymétrie peut être supprimée car les Conditions 1 et 3 doivent être
asymétriques et comme telles ne peuvent pas entrer en boucles et
l’anti-réflexivité peut être supprimée au motif que (a) la causalité est un
universel dyadique plutôt qu'une quasi-relation, et (b) toutes relations
authentiques sont nécessairement antiréflexives.
(David Armstrong,
Universals and Scientific Realism, Vol II, Cambridge University Press.
1978. pp. 91-93.)
Tooley a
développé l'approche de David Lewis sur la base de l'approche aux théories
de F. P. Ramsey. (F. P. Ramsey,
Theories,
The Foundations of Mathematics, et se trouve
dans Causation, pp. 13-25) Les définitions et la manipulation de la
causalité de Tooley sont considérées comme étant solides par cet auteur. De
ce qui précède, le concept de causalité singulariste présente un intérêt
particulier pour le Théiste et l'identification de la cause singulariste que
Dieu est inévitable. Le concept de Dieu comme une entité singulière se
trouve dans cette entité biblique appelée Eloah (אלוה) (Allah), le Dieu au singulier connu comme Dieu le
Père. Nous allons maintenant procéder à l'examen des concepts de Dieu au
singulier, Eloah et Dieu au pluriel, Elohim (אלוהים), et à partir de ceux-ci produire un schéma
cohérent de création et définir son but logique.
Il
convient de noter d'emblée que le mot pour Dieu a une forme singulière qui
n'admet aucune pluralité du tout. Cette forme est soit Eloah (ci-dessus)
soit la forme chaldéenne Elahh (voir le Dictionnaire hébreu de Strong (SHD)
426) qui lui correspond. La forme islamique est l'équivalent de ces deux
formes. Les Elohim sont une pluralité qui empêche logiquement et
linguistiquement toute inclusion dans ce terme. L'inclusion d'Eloah (ou
Elahh) dans la pluralité des Elohim n'est en revanche pas exclue mais il
sera démontré que cette inclusion est logiquement nécessaire. Dans Daniel
3:25 la quatrième entité vue dans la fournaise a été décrite comme
“semblable à un fils de Elahh.” L'identification de ce
“Fils” particulier et
de ces
“Fils de Elahh” ou Elohim et
les Bene Elohim subordonnés se révélera être une recherche passionnante.
Chapitre 2
La Création et la Création
Absolue
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est Un. (Deutéronome
6:4)
2:1.1 La
Création Cyclique et les Attributs de Dieu
En
examinant le concept de la création un certain nombre de facteurs doivent
être pris en compte. Principalement, la question du type de création qui est
faite, le système par lequel elle est régie et les lois par lesquelles elle
est réglementée doivent refléter la nature de l'entité qui l'a créée. Il est
constant de voir parmi les philosophes et les théistes que la singularité
appelée Dieu est par nature omnisciente et omnipotente. La signification de
l'omniscience est comprise pour être la connaissance de toutes les vraies
propositions. La connaissance de la vérité et du mensonge, du bien et du mal
est comprise comme des sous-matrices nécessaires à la connaissance de toutes
les vraies propositions. La question de l'omniscience de Dieu, qui implique
une prescience absolue et donc le déterminisme, et l'affirmation selon
laquelle Dieu peut choisir de ne pas tout savoir de l'avenir pour permettre
la liberté humaine de telle sorte que l’omniscience est la capacité ou le
pouvoir de connaître toutes choses, mais qu’elle n'est pas exercée pour
faciliter la liberté, sont abordées ci-après. Les restrictions volontaires
ou involontaires sur l'omniscience sont considérées comme des limitations à
la puissance du Dieu Singulier Eloah ou le Theon (accusatif, ou Ho Theos
avec l'article défini, Le Dieu), de manière à élever nécessairement des
divinités subalternes telles qu’un Elohim ou theos à la centralité de Eloah
ou le Theon, et sont logiquement polythéistes.
La
confusion entre la prescience Divine et le déterminisme est un concept
correctement rejeté par Augustin comme incohérent et son argumentation suit.
Le
concept d'une création changeante ou cyclique soulève une question de la
modification d'un plan qui implique à son tour que Dieu change d'avis ou Son
plan, et de là que Ses pensées ne sont pas omniscientes et que Son plan
n'est pas parfait. Un tel concept est incohérent dans la mesure où le plan
de Dieu peut être parfait et immuable mais la création peut être
progressive. Ce concept est appelé création cyclique. Le concept de la
création cyclique est traité par Augustin dans La Cité de Dieu
(Livre XII, Ch.18, Knowles p. 494). Augustin soutient que Dieu doit être le
même au repos ou au travail, et de là l'action comme par un élément ou
caprice novateur entrant dans Sa nature, qui n'était pas là auparavant, est
exclue. Dieu n'est pas susceptible de changer sous l’effet d’une influence
extérieure. Dieu est actif au repos et au repos dans Son activité (ibid., p.
495). Il peut appliquer à un nouveau travail non pas un nouveau modèle mais
un plan éternel, et ce n'est pas parce qu'Il s'est repenti de son inactivité
précédente qu'Il a commencé à faire quelque chose qu'Il n'avait pas faite
auparavant ; mais en Dieu il n'y a aucune nouvelle décision qui modifie ou
annule une précédente intention ; au contraire, c'est avec un seul et même
dessein éternel et immuable qu'Il a effectué Sa création (ibid., pp. 495-6).
Le
concept d'Augustin de la nature immuable de Dieu et Son plan est
essentiellement cohérent.
De ce
concept d’un dessein éternel et immuable, il s'ensuit que Dieu ne pouvait
pas
“expérimenter” avec des
prototypes tels que la création de l'homme pré-adamique de type de l'homme
de Cro-Magnon ou de Neandertal, et il doit donc en découler une explication
cohérente de leur existence. Cette proposition est traitée ci-après. La
compréhension de Dieu est infinie et Augustin, au chapitre 19, se réfère à
l'affirmation de Platon (Timée, 35f) selon laquelle Dieu a construit
le monde par nombre et utilise Sagesse 11:20 :
“Tu as mis en
ordre toutes choses avec mesure, nombre et poids”
: et de
même Ésaïe 40:26 (LXX) :
“Il a produit le
monde en nombre.” Les affirmations d'Augustin portent sur une
connaissance infinie à partir d’une série infinie (comme aussi
“vos cheveux sont tous comptés” : Matthieu 10:30). Augustin ne savait pas et ne se
hasarderait pas à savoir si
“les âges des
âges” signifiaient que les âges se sont poursuivis avec
une stabilité ininterrompue dans la sagesse de Dieu, comme les causes
efficientes des âges transitoires de l'histoire temporelle. Il semble
laisser sans réponse les concepts de l'être et du temps comme un continuum,
malgré les déclarations bibliques claires sur la temporalité transitoire. La
création des anges frôle cette question (voir le document
Comment Dieu devint une Famille (No. 187) CCG, 1996, 1999).
Augustin
a soutenu que Dieu est éternellement souverain, tout en reconnaissant le
commencement de la création. Le problème qu'il pose alors est le suivant :
“quel était l'éternel sujet de la souveraineté
éternelle de Dieu, si la création n'a pas toujours existé ?” (ibid., p. 490). Augustin touche ici à la question
principale de ce qui a précédé la matière. Il développe la priorité logique
de l'esprit, mais laisse des questions sans réponse telles que : qu’est-ce
que l'esprit ? et comment les entités qui sont spirituelles pouvaient
exister et agir sur la matière ? Ces questions n'ont pas été répondues en
seize cents ans et sont d'une grande importance. Elles sont développées tout
au long de cet ouvrage.
Son
développement de séquence spirituelle et matérielle est le suivant. Augustin
soutient que l'idée d’une création coéternelle avec Dieu est
“un idéal condamné aussi bien par la foi que par une
raison saine.” Ainsi, il est absurde que la création
mortelle ait existé depuis le commencement. Le concept que les anges n'ont
pas été créés dans le temps, mais existaient avant tous les temps, est que
Dieu est souverain sur eux, car
“Il a toujours été souverain, alors on pourrait
me demander si les êtres qui ont été créés pouvaient exister toujours : si
c’est vrai qu’ils ont été faits avant que le temps existe.” La compréhension d'Augustin de la dépendance de la
temporalité matérielle à l’égard de la création matérielle est assez
avancée. Avant la création des étoiles, Augustin suppose que le temps
existait
“dans un mouvement en évolution, dans lequel il y
avait une succession d’avant et d’après, où tout ne pouvait pas être
simultané.” Les mouvements angéliques ont donné naissance à la
notion de temps, par conséquent l’incitant à exister de sorte qu’ils se sont
déplacés dans le temps dès le moment de leur création,
“même ainsi ils ont existé de tout temps, vu que le
temps a commencé quand ils ont commencé. Est-ce que quelqu'un affirmerait
que ce qui a existé de tout temps n'a pas toujours existé ?” (ibid., p. 491). Augustin évite le problème que si
ce qui vient d’être dit s’avère être le cas, alors les anges “doivent être
coéternels avec le Créateur, s’ils ont, comme Lui, toujours existé” (ibid.). Les temps ont donc été créés, mais le
temps a existé de tout temps.
En
réponse, le temps, étant en train de changer et transitoire ne peut pas être
coéternel avec l'éternité immuable (ibid., p. 492. Cf. Livre XI, 6).
L'immortalité des anges n'est pas temporaire ou temporelle, ce n'est pas
dans le passé, comme si elle n'existait plus, ni dans l'avenir, comme si
elle avait encore à venir à l'existence, et pourtant leurs mouvements qui
conditionnent les passages du temps passent de l'avenir dans le passé, et
donc ils ne peuvent pas être coéternels avec le Créateur. Car dans le
mouvement du Créateur, il n'est pas question d'un passé qui n'existe plus ou
un avenir qui est encore à venir. Par conséquent, si Dieu a toujours été
souverain, Il a toujours eu une création soumise à sa souveraineté ; non pas
engendrée par Lui, mais faite par Lui à partir de rien, et non pas
coéternelle avec Lui. Il existait avant Sa création, mais pas dans un temps
antérieur à celle-ci, Il l'a précédée, et non par un intervalle transitoire
de temps, mais dans Sa perpétuité constante (ibid., p. 492 cf. conf.11,
13-16). Au Livre XII, ch.17 Augustin [cite] le grec dans Tite 1:2 et
suivants comme
“avant les temps
éternels” au lieu de
“il y a des âges” pour soutenir que les Apôtres affirmaient que Dieu
a promis la vie éternelle avant l'éternité. Ce n'est pas fondé. [Dieu a
prédestiné la vie éternelle d’exister dans l'armée avant que le temps ne
commence]. Cependant, le concept qu'il avance de la prédestination absolue
dans son éternité suit de sa logique.
Le schéma
d'Augustin réalise la temporalité spirituelle comme coexistant avec la
création des anges [les Fils de Dieu (Job 1:6 ; 2:1 ; 38:4-7)] et donc
l'esprit est
“tombé” dans le sens
hégélien, dans la temporalité spirituelle qui est éternelle et créée ex
nihilo. La création ex nihilo est avancée d’après Le Berger d'Hermas
et est donc fondamentale à l'église primitive). La création matérielle
atteint la temporalité temporelle à sa création. Il s'ensuit qu'un ideatum
du créateur s’accomplit étant de l'action de la création qui ne peut
dépendre directement de l'idée comme un plan éternel prédestiné ou bien la
création séquentielle serait exclue et un être nécessaire et l'immanence
découlerait de l'idée, étant donné que le matériel est créé à partir de
l'invisible ou spirituel (Hébreux 11:3). Essentiellement le schéma
d'Augustin n'est que partiellement cohérent. Dans ses phases initiales, ses
incohérences portent sur la nature de la Divinité et la séquence des
actions humaines, et elles seront traitées plus tard. Son affirmation de la
création ex nihilo est peut-être un artifice pour surmonter les difficultés
néo-platoniciennes, mais il s'agissait d'une doctrine authentique de
l'église primitive comme nous le voyons de Hermas.
2:1.2 Les
Problèmes de Transcendance/Immanence
La
création du spirituel dans le schéma biblique ne déclare pas spécifiquement
la création ex nihilo ; pour nier le monisme néo-platonicien et l'immanence
nécessaire la création ex nihilo est supposée. Spinoza a développé cette
position à partir de Pt.11 Prop.I de L’Éthique. La pensée est un
attribut de Dieu, ou Dieu est une entité pensante, et l'extension est un
attribut de Dieu, ou Dieu est un être étendu (Prop.II). L'idée est de Son
essence, comme toutes les choses qui en découlent nécessairement existent
nécessairement (Prop.III). C'est dans cette proposition que Spinoza
s’attaque directement à la notion de la puissance transcendante de Dieu, par
laquelle Il, étant considéré comme un homme, peut agir comme un potentat
terrestre ayant le pouvoir de détruire toutes les choses. Il considère cette
notion futile et d’après Corollaires 1 et 2 à Prop.XXXII Pt.1 et également
XVI Pt.1 et XXXIV Pt.1, il estime que la puissance de Dieu est son essence
d'agir et il est
“impossible même pour nous de concevoir que Dieu
n’agisse pas puisque c’est concevoir qu’Il n’existe pas” (note de Prop
III). Spinoza ici suppose que parce que les choses existent nécessairement
de la puissance et de la nature de Dieu, et que ces attributs et affections
découlent nécessairement de la nature de Dieu, alors Dieu est une force
immanente active incapable de modifier sa nature et donc non transcendant.
Spinoza
est utile dans l'examen de la nature de Dieu et aussi dans le rejet des
notions anthropomorphiques de Dieu. Le système que Spinoza a proposé dans le
rejet de l'Anthropomorphisme et du Dualisme cartésien, ainsi que sa solution
au problème corps/esprit, l'ont essentiellement conduit à l'immanence
captive.
D’après
la Prop XVIII (Pt. 1), Dieu est la cause intrinsèque ou immanente, et non
pas la cause transitoire ou extérieure de toutes les choses, et d’après les
Prop XXXIII et XXXIV, celles-ci suivent seulement si la possibilité d'un
créateur distinct de sa création est refusée. Pour Spinoza, Dieu est soit
immanent, soit transcendant, et pour qu’il soit transcendant, il doit cesser
d'être immanent.
Maintenant l'objection évidente à cela est que la création de la substance
matérielle comme un mode de l'essence de Dieu n’imprègne pas nécessairement
cette substance matérielle avec tout le pouvoir de l'esprit à partir duquel
la substance matérielle a été créée. L'esprit ou l'essence fondamentale, en
tant que formulation de la structure sous-atomique, ne change à aucun
moment, et la nature immatérielle de l'essence fondamentale de la matière
n’est pas altérée. Ce n’est que dans la destruction des particules atomiques
que nous avons une idée de la libération de la puissance de l'esprit et
c'est ce confinement de l'esprit que Spinoza comprend mal. Il suppose que
l'esprit essentiel de Dieu coule sans altération, obstacle ou entrave dans
l'aspect matériel du corps, et que le corps et l'esprit fonctionnent comme
une extension de l'essence de Dieu comme un mode reçu sans limitation ou
altération dans un certain flux actif qui est captif de façon passive. C'est
la racine de son erreur. Augustin l’a compris en partie bien avant Spinoza.
L'esprit agit sur la théomorphe humaine dans la régularité de la loi. Comme
la division de la Divinité s'est produite alors la structure humaine pouvait
être sollicitée aussi par les divisions polythéistes maléfiques en raison de
leur nature originelle, comme indiqué ci-dessous.
Spinoza
développe le concept de l'inévitabilité de la nature de Dieu, c'est-à-dire
de la Bonté ultime et l'impossibilité que Dieu, par exemple, puisse donner
un ensemble de lois autres que ce qui découle de sa nature. Ce concept est
important pour l'argument sur la création absolue, mais aussi pour la
compréhension de l’activisme théiste sur l'être humain.
En
traitant de l'action humaine, Spinoza a considéré le conflit de la dualité
du modèle cartésien, tel qu'exposé par Descartes et plus tard par
Malebranche, comme une impossibilité logique et qui ne pouvait pas expliquer
suffisamment la personnalité humaine. En outre, il a estimé que concevoir la
pensée et l'extension comme deux substances revient logiquement à exclure la
possibilité d'une interaction causale stricte entre elles. Pour Spinoza,
“l'univers en tant que système de choses étendues et
spatiales et l'univers en tant que système d'idées ou de pensées doivent
être interprétés comme deux aspects d'une réalité unique inclusive, ils
doivent être deux attributs d'une substance unique.” (S. Hampshire,
Spinoza, Londres, 1956, p. 49). La pensée néo-platonicienne de
Spinoza est donc utile dans l'examen du néo-platonisme pré-cartésien
primitif d'Augustin. Spinoza a développé le néo-platonisme plus clairement
que ne l’a fait Augustin et a tenté de surmonter une partie de l'incohérence
entre la pensée néo-platonicienne et la pensée biblique présente dans La
Cité de Dieu. Pour Spinoza, si quelque chose existe, alors Dieu, en tant
que substance infinie, existe nécessairement et comme il est absurde de
supposer que rien n'existe, alors Dieu, en tant que substance infinie,
existe nécessairement. Dans son Explication de la Définition 6 de l’Éthique,
Spinoza affirme que Dieu est
“absolument
infini, et non pas infini en son genre ; car ce qui est infini en son genre
seulement pourrait se voir refuser l'infinité des attributs ; mais à
l'essence de ce qui est absolument infini appartient tout ce qui exprime une
essence et n’implique aucune négation.” (R. Willis,
trad., Vol 2, Ethics, pp. 415, 416).
Spinoza
ici tente de tenir compte de la position de Parménide selon laquelle
l'infini est refusé à l’Unique en ce que s’il était infini alors il aurait
besoin de tout, alors qu'il n’a besoin de rien. Quine (From a
Logical Point of View, p. 129) attire
l'attention sur cette vérité de Parménide quand il fait référence à
l'opposition entre les conceptualistes et les platoniciens, entre
“ceux qui admettent un seul degré d’infinité et ceux
qui admettent une hiérarchie cantorienne d’infinités.” Il semble que Spinoza soit conscient de cela et
qu’il tente un rapprochement de la position de Parménide. Selon Nathan
Rotenstreich (“Le Système et ses Composants” dans Spinoza,
His
Thought and Work, p. 18), la centralité de
la distinction cartésienne est évidente, même si Spinoza incite à une
découverte analytique de Dieu comme cause de Lui-même et tout ce qui découle
causalement de Lui. En outre, en descendant de l'existence de Dieu vers
l’esprit et le corps, Spinoza a transformé le monde de la matière visible
des Principes de Descartes dans le monde émotif cognitif affectif.
De cette
façon, la méthode ou la façon humaine de connaître le monde dans toute sa
diversité est introduite par la distinction et la séparation de l'idée vraie
d'autres perceptions, fictives, fausses ou douteuses. Son insistance sur la
perfection de l'esprit soulève des questions sur la relation de l'esprit et
de la liberté, et entre la perfection et la position libre de l'esprit. La
structure de la réalité comme une totalité a posé la question de la présence
de la variété et de la multiplicité dans l'univers global (ibid.).
Spinoza a
développé son système selon la ligne néo-platonicienne non transcendante
immanente et, par conséquent, le même problème fondamental se pose dans sa
philosophie et laisse un conflit interne entre la position morale et
individuelle et le développement de l'univers dans lequel l'individu est
subsumé. L'opération de création absolue découlant de l'hypothèse de Dieu
comme cause de Lui-même est traitée ci-dessous. Spinoza est incohérent dans
une telle affirmation ; Rotenstreich suit l'erreur.
Cette
question ci-dessus de la subjectivité est liée à l'état ontologique des
choses finies du monde et trouve objection dans les modèles bibliques et
coraniques. Ces conflits devaient émerger dans le panthéiste allemand et les
écoles françaises de libre-pensée, et existaient durant la vie de Spinoza.
Le système de Spinoza n'a pas tenu compte de manière adéquate de ce problème
étant paradigmatique sur son analyse de la situation, mais néanmoins, le
système de Spinoza constituait un nouveau point de départ pour la
philosophie, et donc d'une grande importance. Spinoza a estimé que, d’après
L’Éthique, Pt.1, Prop.1, Dieu est la seule substance et en tant que
tel, Il est logiquement antérieur à Sa nature. À partir de l'existence de
Dieu comme cause de Lui-même, Il est la dérivation des choses infinies dans
les modes infinis. La réduction de Spinoza de deux modes de l'infini pose
une difficulté, mais la déduction est néanmoins nécessaire. L'affirmation de
Spinoza repose sur l'identification erronée d'une distinction conceptuelle
d'un attribut instancié comme une distinction ontologique qui est identifiée
ci-dessous. Cette erreur subsiste largement aujourd'hui.
D’après
L'Éthique, Pt.1, Prop.XXXIII,
“les choses n’auraient pu être produites d’une
autre manière ou dans un autre ordre que celui dans lequel elles ont été
produites", de là la création est une conséquence directe de la substance et
de la nature de Dieu et existe nécessairement à partir de cette nature. Il
s’ensuit que les lois qui régissent l'univers sont fixées par la nature de
Dieu. Dieu, par conséquent, n’aurait pu donner aucune autre loi, par
exemple, que le décalogue, puisque cela découle de Sa nature. Malgré
l’erreur conceptuelle/ontologique de distinction de Spinoza il procède
néanmoins à une évaluation correcte de la création découlant de la nature de
Dieu. La difficulté de l'Immanence excluant la Transcendance découle de la
prémisse ci-dessus. Le point de vue de Dieu, comme une omnipotence
transcendante, punissant la violation de la loi, était soutenu d’empêcher
une fonction comme celle de Spinoza et c’est pour cette raison qu’il a été
excommunié de sa synagogue pour empêcher la persécution de la communauté.
(Voir McKeon, Spinoza,
His Thought and Works, pour plus de détails.)
La distinction entre Eloah et l'Ange de la
Rédemption et la distinction Theon/Theos de Jean était potentiellement
dangereuse comme la controverse arienne/athanasienne l’avait montré, et
l'Inquisition des Croisades Albigeoises avait étouffé toute discussion de ce
genre. Hort a examiné la question des deux Dieux dans Jean 1 dans l’ouvrage
The Words Monogenese Theos in Scripture and
Tradition (publié dans
Two Dissertations, 1876)
2:2.1 La
Création Absolue
David
Werther (“Augustin et la Création Absolue”, Sophia, Avril 1989 pp. 41-51) souligne que,
contrairement à Descartes, qui suivant Guillaume d'Ockham, a préconisé le
volontarisme divin, Leibniz, suivant dans la Tradition d’Augustin, a rejeté
le volontarisme ainsi que toute réclamation selon laquelle les vérités
nécessaires sont distinctes de l'essence divine. Leibniz fait une
distinction entre les vérités contingentes sur la base du principe de la
justesse,
“c'est-à-dire le choix du meilleur possible, tandis
que les vérités nécessaires dépendent uniquement de sa compréhension, dont
elles sont l'objet interne” (Leibniz, Monadology No. 46, tel que
cité par Werther). Leibniz rejette la proposition que puisque les vérités
éternelles dépendent de Dieu, elles sont arbitraires et dépendent de sa
volonté. Werther attire l'attention sur le document traitant de la relation
entre la nécessité et Dieu, rédigé par Thomas V. Morris et Christopher
Menzel, qu'il décrit comme une sorte d'hyper-augustinisme. Il dit :
Comme Augustin et Leibniz, Morris et Menzel nient que les vérités
nécessaires sont distinctes de l'essence divine. Mais contrairement à ces
philosophes, ils affirment que, pourtant, Dieu crée les vérités nécessaires,
et donc son essence. La création divine est absolue. Nous croyons qu'il n’y
a pas de réel problème avec leur implication évidente initiale de
l'activisme, à savoir que Dieu a des propriétés, et qu’il en a certaines à
la fois essentiellement et distinctement, pour l’existence desquelles son
activité éternelle est responsable de manière créative (p. 359 ; ibid., pp.
41-42).
Werther
isole les réponses inadéquates à la vue de la création absolue qu’ils
mettent en avant, ainsi que leur incapacité à envisager une implication
ontologique apparente. Une autre observation importante que Werther fait est
la notation de Morris et Menzel de certaines des relations apparentes entre
le Théisme et le Platonisme de telle sorte que
si l’on adopte la vue platonique affirmant l'existence du
“cadre de la réalité”
(p. 353), l’étiquette de Morris et de Menzel pour le domaine des vérités
nécessaires et des objets nécessairement existants, alors on affirme les
états des affaires telles qu'il n'est pas possible qu'elles soient créées
par Dieu. Si l'on rejette ce point de vue platonicien, alors les
revendications de l'universalité de la création de Dieu semblent être plus
plausibles. Selon eux, Dieu est non seulement responsable de la création des
états contingents des affaires, mais aussi de la création des états
nécessaires des affaires (ibid., p. 42).
Il
poursuit en disant que
“l’activisme théiste”
est le point de vue selon lequel le domaine de la nécessité/le cadre de la
réalité est le produit de l'activité intellective divine. Il devrait être
évident maintenant que le développement de la création absolue et de
l'activisme théiste est une tentative de combiner le platonisme (ou au moins
le platonisme modifié dans lequel les états des affaires peuvent à la fois
avoir l'existence nécessaire et être dépendants) et le théisme dans une
métaphysique cohérente et, ce faisant, fournir une certaine justification à
l'affirmation selon laquelle la portée de la création de Dieu est
universelle (ibid., p. 43).
Augustin
a été l'initiateur de ce processus, mais il était conscient de l'incohérence
de la position potentiellement moniste de la philosophie de Plotin qui peut
être vue comme
“une grande structure hiérarchique, une grande
chaîne de l'être, ou comme un exercice de compréhension introspective de
soi.” (Louth,
The Origin
of the Christian Mystical Tradition, From Plato to Denys, Clarendon Press, Oxford, p. 37) Platon, Philon,
Plotin, Augustin et les écrivains postérieurs sont influencés par les
Mystères. (Voir Cox, Mysticisme, CCG Publishing, 2000)
Dans le
Timée (41c:cf.90A ff), les âmes immortelles sont considérées comme la
création directe du démiurge, tandis que ce qui est mortel est fait par les
dieux inférieurs. Le conflit avec le récit biblique est évident dans les
affirmations d'Augustin sur la création à partir de rien et cette
incohérence est restée, étant reprise plus tard par Abu Yusuf Ya’qub al
Kindi (m.866) qui a de nouveau essayé de concilier le platonisme avec la
création ex nihilo. La tentative, cependant, a été abandonnée et, en
commençant par Abu Bakr ar Razi, un concept gréco-indien syncrétique a été
développé, non seulement par les Frères de Sincérité, mais aussi par
Al Farabi (m.950) et Ibn Sina (m.1037). Leur influence devait affecter
d'Aquin, qui a ensuite développé les formes platoniciennes de l'argument
d'Augustin, développant davantage l'incohérence.
Werther
considère ce qu'il appelle l'objection de démarrage comme
“Morris et Menzel montrent clairement que, même s'ils
affirment une relation de dépendance asymétrique causale entre Dieu et les
propriétés essentielles de Dieu, les dernières étant causalement dépendantes
du premier, ils n'affirment pas que Dieu existe temporellement avant les
propriétés essentielles de Dieu.” Ils rejettent
la simplicité divine et
“continuent à rejeter l'inférence...” que de la nature de Dieu causalement dépendante de
Dieu, et de Dieu dépendant logiquement de sa nature, il s'ensuit que Dieu
dépend causalement de lui-même” (p. 360)” (ibid., p. 44).
Donc à
partir de Spinoza ci-dessus, Dieu est une substance et il est logiquement
antérieur à Sa nature. Mais pouvait-Il créer cette nature ? Dans l'exemple
de Werther, Dieu est l'Omniscience Divine et se créerait donc Lui-même comme
Il est logiquement dépendant sur l’omniscience et les autres attributs
divins essentiels qui composent Sa nature. Maintenant Russell a soulevé une
objection à ce problème, à savoir le problème de la question des lois
naturelles (Russell,
Why I am Not a Christian, p. 5). Il n'aurait pas pu les émettre de Son bon
plaisir, ou bien il y a quelque chose qui n'est pas soumis à la loi. S’il y
avait une raison pour les lois alors Dieu Lui-même serait soumis à la loi,
et par conséquent vous ne recevriez aucun avantage en introduisant Dieu
comme un intermédiaire. Vous avez vraiment une loi à l'extérieur et
antérieure aux décrets divins, et Dieu ne sert pas votre but, parce qu'Il
n'est pas le donneur ultime de la loi. Dieu, par conséquent, doit être le
donneur ultime de la loi pour que le théisme soit cohérent, cependant, le
bien et le mal doivent avoir un sens qui est indépendant du fiat de Dieu,
parce que les fiat de Dieu sont bons et non mauvais indépendamment du simple
fait qu'il les a faits. Russell dit ici que
si vous allez dire cela, vous aurez alors à dire que ce n'est pas
seulement grâce à Dieu que le bien et le mal sont venus à l'existence, mais
qu'ils sont dans leur essence logiquement antérieurs à Dieu. Vous pouvez,
bien sûr, si vous voulez, dire qu'il y avait une divinité supérieure qui
donnait des ordres au Dieu qui a fait ce monde, ou pouvez adopter la ligne
que certains gnostiques ont adoptée : une ligne que j’ai souvent trouvée
très plausible : qu’en fait ce monde que nous connaissons a été fait par le
diable à un moment où Dieu ne regardait pas (ibid. p. 8).
La ligne
que jette Russell concernant la divinité supérieure qui a donné des ordres
au Dieu qui a fait ce monde est en fait l'ontologie biblique correcte, mais
Russell n'avait pas étudié la question sérieusement pour déterminer si la
Théologie Athanasienne était une représentation correcte de la Bible. Il a
supposé qu'elle l’était et a été repoussé par sa structure illogique : comme
un philosophe engagé à la vérité, il ne pouvait pas reconnaître le système
d'Athanase. S’il avait étudié l'ontologie biblique plus profondément, il
aurait pu devenir un Chrétien, mais logiquement pas un Athanasien.
Russell
montre la chaîne de raisonnement qui a conduit à Augustin à prendre la
position trinitaire des Platoniciens avec les adaptations bibliques. Russell
a cependant tort de penser que le bien et le mal sont dans leur essence
logiquement antérieurs à Dieu. Que ce soit par la théorie centrale de la
vérité dans l'empirisme ou par le concept de la centralité du bien ultime
(et ici Augustin développe le mal comme
“apostasie”), il peut être
démontré que ces attributs émanent de la nature même de Dieu et que, par
conséquent, Dieu ne pouvait pas créer quelque chose de contraire à Sa
nature.
Les lois
causales ultérieures sont donc fixées et non matérielles, dépendantes de la
nature de Dieu, qui est immuable, et donc la causalité et la loi sont
immuables. Cette position introduit une notion de causalité non survenante
qui dépend d'une notion d'attributs fixes et d’une causalité singulariste
basée sur des relations théoriques. Les notions de causalité survenante
affectent tous les penseurs ultérieurs. Comme Werther dit :
“mais si Dieu existe, si et seulement si les
propriétés essentielles de Dieu existent, pourquoi penserait-on que les
propriétés essentielles de Dieu sont causalement dépendantes de Dieu ?” Morris et Menzel commentent :
on peut se demander s’il pourrait y avoir une raison pour que le théiste
pense qu'il existe une relation causale coulant dans un sens et pas dans
l'autre entre Dieu et les objets abstraits nécessaires. Mais la réponse à
cette question est, au moins prima facie, simple. Indépendamment de notre
problème, Dieu est considéré comme causalement actif, voire comme l'agent
causal paradigmatique, tandis que ces objets abstraits sont normalement
considérés comme causalement inertes. S'il peut y avoir une relation de
cause à effet entre eux, le théiste jusqu'ici semble avoir une certaine
justification ou argument de la directionnalité qu'il voit. (p. 355).
Mais
Werther affirme à juste titre que, si
“Dieu est
équivalent à la substance divine sans toutes les propriétés, on ne peut plus
prétendre que Dieu est considéré prima facie comme l'agent causal
paradigmatique” (ibid., p. 45). La création absolue ne peut
pas exister au sein de la notion de causalité survenante et de la notion de
causalité singulariste Il n'existerait pas comme une entité survenante du
noyau plus les attributs créés. C'est à partir de ce point de vue que la
tentative de construire une relation de dépendance asymétrique causale entre
Dieu et les propriétés divines essentielles est nécessaire. Comme le dit
Werther,
“La propriété de l'omnipotence est soit
ontologiquement distincte de Dieu, soit elle ne l'est pas. Si c'est le cas,
il semble que Dieu serait impuissant à la créer. Comment Dieu, dépourvu de
pouvoir, pourrait-il éternellement faire exister cette propriété divine ? Si
la toute-puissance divine n'est pas éternellement distincte de Dieu, la
création de Dieu de celle-ci semble être un exemple d’auto création” (ibid., p. 46). Mais ce n'est instancié dans la
substance divine et n'est pas un objet abstrait qui existe indépendamment.
Ainsi, la différence est conceptuelle pas ontologique.
S’il y
avait une distinction ontologique, alors il serait nécessaire d'isoler la
dépendance causale de la puissance de Dieu, et de ce qui précède, elle ne
peut pas être distincte et indépendante de la substance divine. Werther fait
valoir que l’omniscience divine ne peut pas exister non instanciée, mais il
souligne qu’Alvin Plantinga a clairement montré que la simplicité divine est
vulnérable aux arguments reductio (ibid., p. 47). Il affirme que cette
omniscience divine n’est pas identique à Dieu, mais que l’omniscience divine
ne peut pas exister distinctement de Dieu (ibid., p. 48). À partir de
l'analyse ci-dessus de l'inséparabilité de Dieu de ses propriétés
essentielles, les variations sont élaborées sur la base essentiellement sur
les notions de causalité. L'implication de ce qui précède est que c’est
seulement en tant que "Dieu sans propriétés essentielles" que Dieu est
indéterminé et donc librement créatif. Il est, par conséquent, non
compatibiliste sur ce compte. Mais il n'est pas admis que Dieu existait sans
propriétés essentielles, mais plutôt, que l'univers existe à partir d'une
cause singulariste émanant de la nature de Dieu et n'est donc pas survenant.
Il n'est pas, par conséquent, indéterminé. Dans le sens singulariste
théorique, Ses lois sont déterminées de Sa nature ou essence même qui est
immuable. L'univers fonctionne selon des notions théoriques de causalité
singulariste qui sont en mesure de gouverner le matériel et l'immatériel,
alors que les notions matérielles survenantes sont confinées. Dieu ne dépend
donc pas de Ses propriétés et ses propriétés ne dépendent pas de Lui au sein
des notions actuelles de causalité.
2:2.2 L’Activisme
et la Loi comme un Mécanisme
Les
relations de la loi sont exprimées par Spinoza dans L'Éthique Pt.1
Prop.XXXIII ci-dessus, où la création est une conséquence directe de la
substance et de la nature de Dieu et existe nécessairement à partir de cette
nature, d'où les lois qui régissent l'univers sont fixées par la nature de
Dieu. Dieu n’aurait pu donner aucune autre loi que celles qui ont été
données. Mais ce serait, cependant, contraire au monisme immanent de Spinoza
qui est le prolongement logique du néo-platonisme. Augustin, en vue des
contradictions évidentes avec la Bible, a développé les thèmes de la
création ex nihilo dans l'ordre de la Parole engendrée, ensuite du royaume
angélique ou spirituel, et enfin de l'univers matériel temporel, qui
s'accorde avec le récit biblique. Seuls la Trinité et le concept de l'âme
sont incohérents.
2:3:1
Ontologie et Illumination
Les
ontologistes dans la tradition augustinienne affirment que si les vérités
nécessaires sont des constituants de la nature divine, alors comprendre ces
vérités donne une connaissance directe de la nature divine.
(F Copleston,
A History of Philosophy, Vol 2,
la Philosophie Médiévale, Partie 1,
“Augustin
à Bonaventure”, Garden City, New York,
Image Books 1963 p. 75-77 ; et Werther ibid., p. 50).
Cette
position est contraire à la compréhension biblique où
“mes pensées ne sont pas vos pensées” (Ésaïe 55:8), sauf quand les individus, après le
baptême et la réception de l'Esprit, peuvent atteindre ou tendre à la
perfection, mais pas une quelque proximité de la nature divine sauf par la
croissance de l'Esprit. L'union avec l'Unique développée ici est la
Conjonction théologique chaldéenne qui est décrite dans Mysticisme de
Cox. La théorie d'Augustin de l’illumination est conçue pour bloquer les
objections ontologiques. L’illumination pour Augustin n'implique pas une
vision directe des Idées divines.
Ainsi
Dieu est l'origine causale d'un corps de vérités mathématiques et morales
communes à l'esprit de beaucoup d'hommes. Est-ce à dire que, lorsque nous
savons, nous voyons les Idées divines ? Augustin ne semble pas le croire.
L’illumination n'implique pas une vision directe des Idées divines. Si
c'était le cas, la vision de Dieu, garante des âmes bienheureuses, serait
également à la disposition du voyageur encore à l'état terrestre. D'une
certaine manière Dieu inculque des notions sur l'esprit humain sans se
révéler Lui-même directement.
(Julius R
Weinberg,
A Short History of Medieval Philosophy, Princeton
University Press, Princeton, New Jersey 1964, p. 41 ; et ibid. p. 50).
L'impression de l'esprit sur l'esprit humain est
développée ci-dessous.
Malgré le
fait qu’Augustin ait saisi l'interaction en partie il a mal compris et mal
interprété le schéma ou l'ontologie. Il y a peu de doute dans les écrits
augustiniens que le Théisme d'Augustin n'était pas le théisme biblique, mais
le syncrétisme néo-platonicien. À partir de ces prémisses contradictoires,
la création absolue et l'activisme théiste tels qu’attribués à Augustin et
développés par Thomas d'Aquin semblent incohérents. L'incohérence a ensuite
conduit à la Distinction cartésienne qui a été fondamentale pour la
compréhension moderne. Elle est essentiellement incohérente et doit être
rejetée. Spinoza a vu cela, mais en rejetant la centralité de la Distinction
cartésienne dans l'explication de l'action humaine, il a été confiné au
monisme immanent à cause d'une distinction conceptuelle qu’il a supposé à
tort d’être ontologique. Sa contribution au rejet de l'explication
cartésienne est importante cependant, et les modèles d'Augustin et Spinoza
contiennent à la fois une vérité utile et une grave erreur.
De ce qui
précède, l'isolement de séquences correctes dans la création et la nature de
Dieu est utile dans l'examen de la structure de la Divinité et le but de la
création. En rejetant le Cartésianisme nous pouvons passer à un système
cohérent théomorphique qui identifie correctement l'action et le potentiel
humain.
Chapitre 3
La Transcendance
et les Fils de Dieu
3.1 La
Transcendance et l'Ange de la Rédemption
Le concept de la transcendance est réalisable à
partir de l’initiation séquentielle de l'idée à l’ideatum par un processus
qui ne peut être assimilé qu’avec le concept d’exprimer l'idée dans
l'existence, de là, Ho Legon (O Legon)
ou "Le Dieu qui Parle," mais dans ce cas-ci comme le Logos, et pour cette
raison l'expression "La Parole" a été utilisée en français. La temporalité
authentique peut se produire seulement comme l'esprit qui est "parlé" dans
l’être matériel, et de là, tombe dans le temps comme temporalité authentique
dans le sens que Heidegger aborde dans
Être et Temps. Le concept d'une vérité non prononcée de l'être par
conséquent doit précéder la temporalité ou l’être matériel. Cette forme
antérieure a été vue par les Indo-Aryens comme une structure logiquement
immanente, et cette erreur conceptuelle a conduit à leur position moniste.
Le concept dans lequel Heidegger veut que nous retournions à la vérité
cachée non prononcée de l'Être dans la Pensée grecque est probablement
développé à partir de la position primitive de Platon dans
Le
Phèdre (247D) qui a été
développée plus tard par Proclus dans son
Commentaire sur le Parménide de Platon
(Livre VI, Morrow et Dillon, Princeton, 1987, p. 589). Dans ses écrits,
Augustin a semblé accommoder un concept biblique valide de la création à
cette forme de pensée.
Cet ouvrage tente d’esquisser la séquence de la
création dans le cadre du récit biblique en tenant compte de la pensée
d’Augustin qui n’a pas atteint son développement complet.
L’intervalle dans le temps comme un concept entre le
commencement de la création matérielle et la création de l'homme est
seulement relative pour l'homme et est sans pertinence dans le schéma de la
création. Les commentaires d’Augustin sur la création récente de l'homme
(Livre XII, ch. 13, ibid., p. 486) sont valides. Le scénario de création de
six mille ans semble avoir été une aberration beaucoup plus tardive de la
théologie, sans doute résultant d'une confusion des six mille ans
sotériologiques avec la création de la terre.
Augustin, dans le Livre XI, chap. 9 (ibid., p. 440),
soutient que le mal n'est pas une substance positive.
“On a donné à la perte du bien le nom de mal.” Cette perte est comme le
fait d’être tombé en disgrâce du seul bon,
“qui est un et immuable, et
c’est Dieu.” (Livre XI, Ch. 10, ibid., p. 440). "Par ce Bon,
toutes choses ont été créées, mais elles ne sont pas un, et pour cette
raison, elles sont variables. Elles sont, dis-je, créées, c'est-à-dire,
elles sont faites, et non pas engendrées. Car ce qui est engendré par le
seul Bon est de lui-même également un : identique en nature avec son
géniteur : et ces deux, le procréateur et l'engendré que nous appelons le
Père et le fils ; et ces deux, avec leur esprit sont un Dieu.” etc. Augustin tombe ici
dans l'incohérence causée par le premier système trinitaire postulé par
Tertullien et tiré de la théologie chaldéenne telle que développée par les
platoniciens (cf. Cox,
La Première Théologie de la Divinité (No. 127), CCG, 1995, 2000).
Le concept d’engendré et non de fait, comme
réplication ou division, par opposition à créé, implique que, bien que
l'entité crée à partir de rien une substance matérielle, ou l'esprit
angélique, ou l'esprit, à partir duquel la matière est produite, la Divinité
est divisée. La division de l'esprit en une dualité et de là une trinité
dans laquelle l'esprit se trouve alors à part de la substance primaire, et
ainsi la réplication secondaire qu’elle a produite, est incohérente. Dieu
est un esprit (Jean 4:24) étant adoré en esprit et en vérité. L'esprit de
vérité émane de lui (Jean 14:17, 15:26), et Il est le Père des esprits
(Hébreux 12:9). Les prémisses métaphysiques erronées sur lesquelles Augustin
a construit son édifice philosophique sont décrites ci-dessous,
particulièrement dans la logique du (soi-disant) débat athanasien/arien.
L’Esprit Saint (ou l’Esprit de Vérité) est une émanation de la puissance de
Dieu qui agit en tant que le facteur animant distinctif dans l’intellect
humain par lequel l'homme atteint la perfection. Sans cela, l'homme est créé
dans l'esprit de l'homme qui est déclaré comme l'image de Dieu. Ce concept
de l'image de Dieu n'est pas comme un principe anthropomorphique, mais
plutôt comme une agence qui anime. Le nephesh ou le souffle, l'esprit de
l'homme est incomplet, coupé de Dieu et retourne à la poussière n’ayant
aucune vie après la mort dans le modèle biblique.
Le concept qu’Augustin développe est celui de la
doctrine chaldéenne de l'âme et non pas une dépendance totale à la première
résurrection spirituelle au retour du Christ et à la résurrection physique
millénaire postérieure. Le concept est non-biblique. On pourrait dire :
“et alors” ; cependant, le récit biblique est un schéma
philosophique cohérent, tant réciproque que dans le développement dans toute
son étendue. Tout système prétendant en tirer l’autorité doit s'accorder
avec lui. Indépendamment de l'argument relatif à son inspiration divine,
cette approche est saine. L'argument selon lequel Dieu doit se révéler est
traité ailleurs.
En raison probablement des susdites considérations
métaphysiques, il est soutenu que, puisqu’aucun homme n'a jamais vu Dieu à
aucun moment (Jean 1:18) Christ était Celui qui L’a déclaré. En tant que le
Logos ou Theos, il était l'Elohim et El du Testament. Ce personnage a été
tenu pour avoir été le visage de Dieu, et Jean Le considère pour être
l'instrument de la création en tant que le Logos, traduit de manière
simpliste comme la Parole. Cela permet un aspect de transcendance sur le
monisme autrement immanent conséquent à une création non-intermédiaire,
comme développée par les néo-platoniciens et qui a été par la suite
formalisée par Spinoza. Mais l'isolement de l'esprit comme une entité
séparée est absurde quand clairement l'esprit est une force qui est une
émanation de la puissance de Dieu et est le mécanisme par lequel Dieu
construit son temple (Actes 7:48 ff ; 17:24), et devient tout en tous
(1Corinthiens 15:28 ; Éphésiens 4:6). L'esprit a ressuscité Christ d'entre
les morts et anime le corps des Élus (Rom. 8:11).
L'affirmation de la Clause Filioque de l'émanation
de l'esprit du Père et du Fils semble être un principe augustinien.
Bibliquement, la démarche est que Christ n'est pas synonyme de Dieu, comme
le dit Paul : "vous êtes à Christ et Christ est à Dieu." (1Cor. 3:23).
L'esprit est le mécanisme par lequel Dieu révèle des choses à l'homme (1Cor.
2:10). Cet esprit est tout à fait séparé de l'esprit de l'homme (verset 11)
et est tout à fait séparé de la sagesse et de la compréhension humaine.
Ainsi, l'union avec l'Unique dans le sens platonicien enseigné par le
Mysticisme est non-biblique.
La réconciliation évoquée par Paul à 2Corinthiens
5:16-21 dit que, désormais, nous ne le (Christ) connaissons plus de cette
manière (v.16), mais sommes réconciliés avec Dieu par Christ. Ce commentaire
illustre le concept du Mal comme étant en déchéance, et le rôle de Christ
dans la réconciliation à l'unité de Dieu. Les traditions athanasiennes
débutant aux quatrième et cinquième siècles sont par conséquent allées à
l'encontre du concept de l'unité et de l'intégrité de la loi et de la vérité
puisque cela émane de la nature même de Dieu. Ainsi, Augustin et les
premiers Pères de l'Église ont ouvert la voie au relativisme moral, et ce,
non pas par volonté, mais plutôt par héritage puisque les Conciles du
quatrième siècle d’Elvira à Nicée, Laodicée et Constantinople avaient
commencé à changer la loi biblique.
Le concept que la loi pourrait être changée
nécessite une restructuration radicale de la notion de causalité. Paul, à
Galates 3:19-20, dit que la loi a été promulguée par des anges dans la main
d'un médiateur.
“Or, un médiateur n'est pas un médiateur d'un seul,
mais Dieu est un.” La loi était le pédagogue pour amener les élus à
Christ.
“Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Car vous
êtes tous des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ.” (Gal. 3:25-26). Le concept de revêtir Christ (v. 27) ne nécessite pas un
esprit qui émane de Christ, mais plutôt comme Christ le déclare à Jean 14:10
il était dans le Père et le Père en lui.
“Je ne parle pas de
moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.” La notion véhiculée dans la Clause Filioque postérieure de Toledo est par
conséquent défectueuse. Augustin semble avoir mal compris la notion de
l'interaction de causalité, et bien qu’il ait placé la nature comme une
structure sollicitée par la volonté de l'esprit à la fois bonne et mauvaise,
il semble ne pas avoir compris la position entièrement, ni l’a expliquée
correctement due à l'incohérence qu’il a héritée.
La vue d’Augustin était une première tentative à
établir des relations immatérielles de causalités tout en conservant les
notions de variabilité morale ou de liberté de volonté. La théologie
philosophique moderne se réfère sans cesse à ses écrits pour l'autorité,
reprenant de ce fait les incohérences. Augustin semble recourir à la loi
mais cependant sur une base incohérente. Il affirme clairement au Livre XIX,
Chapitre 23 dans la réfutation de Porphyre que
“le Dieu des Hébreux a donné
à son peuple hébreu la Loi, écrite en hébreu, une Loi qui n'est pas obscure
et inconnue, mais à ce jour de grand renom parmi toutes les nations.” (Knowles, ibid., p. 889).
3:2
Les Elohim, les Étoiles du Matin et les Fils de Dieu
3:2.1
Les Elohim
C'est le concept de l’ordonnance de la loi telle que
donnée par
"Le
Dieu des Hébreux" et le commentaire de Paul
à Galates 3:19-20 selon lequel la loi a été promulguée par des anges dans la
main d'un médiateur, qui montrent une difficulté conceptuelle fondamentale.
Nous avons vu que Dieu ne peut pas créer des lois
désincarnées, de sorte que l’ordonnance de la loi implique un contrôle
spirituel ou matériel, et implique la créativité. Mais l’ordination ou la
création de la loi était faite par des anges, ce qui nécessite qu'ils
doivent avoir possédé une délégation de pouvoir conséquente à la nature de
Dieu, qu'ils possédaient et qui a été dirigée vers la création matérielle.
Cette délégation étant logiquement antérieure à la création, le Médiateur
(ou Intermédiaire) est donc aussi créateur. La loi a donc été placée dans la
main du Médiateur, afin de permettre la création, en conformité avec le plan
de l'Eloah.
La Version RSV de la Bible dit au verset 20 :
“Or un intermédiaire implique plus d'un, or Dieu est un.” La pluralité de l’ordre angélique est vue par Paul comme une multiplicité
réunie en un, comme Dieu. Cette pluralité et union a fait l'objet de
confusion dans l'Église Chrétienne primitive dû à l'incompréhension totale
de la Nature de la Divinité en raison du Système chaldéen triune qui
limitait la Divinité à trois éléments. Ce système a tenté d'infliger ses
limites conceptuelles sur le schéma biblique, et y est parvenu.
3:2.2
Les Elohim comme une Pluralité
L'Ange de YHVH ou Yahovah fait partie de cette
pluralité et cela se reflète dans la déclaration au Psaume 82:1 (LSG) :
“Dieu (Elohim) se tient dans le conseil divin ; au milieu des dieux (Elohim)
il juge,”
et au verset 6, il est écrit :
“J'ai dit :
‘Vous êtes des Dieux (Elohim), vous êtes tous des
fils du Très-Haut ; cependant, vous mourrez comme des hommes et tomberez
comme n’importe quel prince.’”
Christ dit dans Jean 10:34-36 au
sujet de ce passage :
N'est-il pas écrit dans votre
loi, dis-je, vous êtes des dieux ? Si elle a appelé dieux ceux à qui la
parole de Dieu a été adressée (et l'Écriture ne peut être anéantie), celui
que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dîtes : tu
blasphèmes parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu.
Les Elohim ce n'est donc pas Père et Fils, et non
pas une trinité, mais un conseil d’entités possédant la nature de Dieu le
Père et en union totale avec Lui, et duquel la loi émane par l’intermédiaire
d'un médiateur. L'usage du grec ici dans le Nouveau Testament est
intéressant en ce que le mot utilisé est (θεος)
Theos ou Dieu, et est ici évidemment pluriel, provenant des Elohim
du Psaume 82:1 et de l'utilisation. De Jean 1:18, Le Seul Né (Monogenese)
Theos est sans équivoque subordonné au
(ton) Theon que nul homme n'a
vu. L’Elohim de cette planète est oint par Dieu, comme Dieu, possédant la
plénitude de la Divinité. Psaume 45:6-7 (RSV) stipule que :
Ton trône divin [ou ton trône
est un trône de Dieu [voir la note h] dure pour toujours et à jamais,
Ton sceptre royal est un
sceptre d'équité,
Tu aimes la justice et tu hais
la méchanceté,
C'est pourquoi Dieu, ton Dieu,
t'a oint d'une huile de joie au-dessus de vos semblables.
Cette entité ou Elohim a été identifiée dans Hébreux
1:8-9, où le mot collègues se traduit camarades. Dans Hébreux
1:10, le Fils est identifié en tant que fondateur de la terre et des (ses)
cieux au commencement. De Hébreux 1:11-12, cette entité les roulera et les
changera à mesure qu'ils vieillissent, mais l'entité elle-même est éternelle
et immuable. Le Psaume 8 et l’épître aux Hébreux identifient le Messie comme
étant fait pour un peu de temps inférieur aux elohim, traduit anges dans les
textes français tant dans l’AT que le NT et aussi dans la Septante (LXX).
L’épître aux Hébreux semble faire une distinction
conceptuelle entre les esprits destinés à servir et la notion des Fils de
Dieu. Le commentaire “Tu es mon
Fils, aujourd'hui je t'ai engendré”
du Psaume 2:7, et celui d’Elohim à David concernant Salomon (à 2Samuel 7:14)
: “Je serai pour lui un père et
il sera pour moi un fils”, visait
à isoler le destin des élus en tant que les Fils de Dieu. Hébreux 1:6 dit :
“Mais quand il introduit de
nouveau le premier-né dans le monde, il dit :
“Que tous les Anges de Dieu
l'adorent ;’” cependant, il
s'agit d'une erreur de traduction du Psaume 97:7 qui dit
“adorez-le vous tous les Dieux”,
où Dieux est traduit de Elohim. Les Elohim ici sont appelés Anges de
l’Armée. L'autre référence à cette citation se trouve à Deutéronome 32:43 où
le mot serviteur est utilisé et le concept semble avoir été développé
dans la version Septante. Les Anges, dans Hébreux 1:7, sont ceux dans Psaume
104:4 évoqués par le terme commun Malak (מַלְאָך) qui est le même que celui
utilisé pour l'Ange de la Rédemption à Genèse 48:16, qui est
identifié ici comme l’Elohim, le Dieu d'Abraham, d’Isaac et de Jacob. Tous
ces mots sont traduits comme anges du mot grec (αγγελος)
ou
aggelos (angelos) un messager, d'où un ange. La difficulté réside
dans le manque de mots en grec pour transmettre un certain nombre de
significations. Le fait qu'il y ait des degrés de messagers semble
incontestable. Que l'Ange de la Rédemption, l'un des Elohim, ait obtenu la
prééminence suite à l'incarnation semble indéniable d’après le passage dans
l’épître aux Hébreux.
Toutefois, cela n’obscurcit pas ou ne diminue pas la structure antérieure de
l'ordre de la création et les pouvoirs de l’Armée. Hébreux 1:2 déclare que
l'incarnation [Christ] est nommée
héritier de toutes choses, et était le médiateur par lequel Dieu a fait
les mondes, bien que le mot ici devrait être âges, et non pas mondes.
Ce concept est traité plus loin dans la discussion sur la Création.
Le
passage est probablement une référence à l'enseignement mithriaque selon
lequel l’Aion est la “sève de la
vie”, d'où une durée de vie ou
époque comme le mot grec aion est utilisé et dans le sens juif désigne une
période messianique (voir la Concordance de Strong).
Il
semble que le concept de l'âge soit lié à des périodes et à la durée de
transit du soleil. L'âge actuel implique le transit de l'est à l'ouest, et
le Psaume 82:5 dit : “tous les
fondements de la terre sont ébranlés.”
(LSG). (W. F. Dankenbring, Beyond
Starwars, Tindale, 1978, p. 37 développe ce concept).
Aion est ici traduit à tort comme mondes, mais apparaît plus correctement
dans d'autres passages. Une statue de l’aion à tête de lion se trouve dans
le musée du Vatican. (Une photo et des notations figurent dans l’ouvrage
The Dragon: Nature of Spirit, Spirit of Nature de Francis
Huxley, Collier, New York, 1979, pp. 90-91.) Ésaïe 24:1-6 montre que la
terre est dévastée (KJV), ce qui a été rendu dans des œuvres ultérieures
comme “sa surface informe”. Ce changement de l'âge en inversant le monde et, de là, le
transit du soleil, peut avoir une grande importance dans le contrôle de la
planète.
Ce
concept du médiateur en tant que créateur est parfois confus, parce que
l'illusion a été créée que Dieu le Père ou Eloah, était Celui qui a parlé
aux prophètes. Le problème se produit en raison de la distinction
conceptuelle du Logos, pas encore fait chair dans l'unité avec la Divinité,
et les références post-incarnation au Fils à la différence de cette facette
de l’Elohim appelé le Logos (traduit comme la Parole). Ce concept d’Elohim
est le plus gros problème auquel l'Église chrétienne a dû faire face, et il
n'est pas bien compris, même aujourd'hui.
3:2.3 Les
Étoiles du Matin
Le
concept de l'Étoile du Matin se retrouve dans un certain nombre de livres de
la Bible. Dans le Livre de l'Apocalypse, le concept de l’Étoile de l’Aurore
ou du Matin de
(πρωϊνός)
proinos
ou
(ὄρθρος)
orthrinos
(également liée à l'aurore et comme une épithète de Vénus) est appliqué
spécifiquement dans Apocalypse 22:16 à Jésus-Christ. L'Étoile du Matin est
évidemment un rang de domination sur les nations de la planète comme dans
Apocalypse 2:26-28. Christ promet à ceux de l'Église de Thyatire qui
vaincront qu'il leur donnera l'Étoile du Matin. Ils auront autorité sur les
nations, et ils régneront avec une verge de fer, comme Christ lui-même a
reçu le pouvoir de son Père. Pierre a également évoqué cet aspect de Christ
dans 2Pierre 1:16-19, où l'Étoile du Matin (RSV) ou Étoile du Jour (Moffatt)
se lève dans les cœurs des élus.
Le
concept de l'Étoile du Matin a créé une certaine confusion car, étant un
rang, il est appliqué au chef spirituel et en exercice de la planète. Le
rang a ainsi été détenu par Satan, comme l'Étoile du Matin, ou le Dieu de
cette planète, jusqu'à l'âge messianique à venir. Satan est appelé dans
Ésaïe 14:12-15 (RSV) ainsi :
Te voilà tombé du ciel, Ô Étoile du Jour ;
Fils de l'Aurore !
Te voilà abattu à terre, Toi qui as abaissé
les nations !
Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel
;
Au-dessus des étoiles de Dieu, je placerai
mon trône en haut ;
Je m'assiérai sur la montagne de
l'assemblée à l’extrême nord ;
Je monterai sur le sommet des nues,
Je serai semblable au Très-Haut !
Mais tu as été précipité au shéol, dans les
profondeurs de la fosse.
Le
mot pour aurore est ici schachar comme la première lumière ou lumière
du matin et se traduit comme tel par la Bible version NKJV, etc. La Bible
version NKJV traduit le porteur de lumière, (l'Étoile du Jour ci-dessus)
comme le Lucifer ou le porteur de lumière.
Cette
section décrit la rébellion dans les cieux et est mentionnée par Christ dans
ce contexte à Luc 10:18, où il dit : “Je
voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.”
Dans Apocalypse, la rébellion a impliqué un tiers de l'armée des cieux,
mentionné ici comme des étoiles. Dans Apocalypse 12:7-9, nous voyons :
Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et
ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur
place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9 Et il fut précipité, le
grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui.
Il
convient de noter que le terme Satan est dérivé du verbe hébreu accuser [ou
attaquer SHD 7853
שׁטן
ou STN), d'où l'accusateur des frères.
Le
concept de l'étoile du matin se tenant dans la bouche du dragon se trouve
dans le Sanscrit, et Huxley note que le dragon était connu, dans son état
indifférencié au début de l'être et du non-être, comme
Tad Ekam ou “Celui-là”.
Le
soleil est donc l’enfant dragon et par la suite le tueur de dragon.
Symbolisé comme le Garuda, il était l'intermédiaire avec les cieux (ibid.,
p. 66). (Ces concepts indiens sont traités dans Le Problème du Mal.) Avant
cette guerre et la chute du ciel, Satan était autorisé à accéder au trône de
Dieu. Le livre de Job montre que les Bene Elohim, ou les Fils de Dieu, se
présentèrent devant l'Éternel, et que Satan est venu avec eux (Job 1:6). À
partir du verset 7, nous voyons qu'à cette époque, il avait aussi la liberté
ou la domination sur la terre, comme il l'avait à l'époque de Christ, et à
partir de la Révélation, l’a encore jusqu'au retour du Messie, comme la
nouvelle Étoile du Matin, ou dirigeant planétaire. Il y avait cependant plus
de deux entités qui ont porté cette épithète, puisque de Job 38:4, nous
savons que lors de la création de la planète, les Étoiles du Matin ont été
rassemblées et ont chanté ensemble, et tous les Fils de Dieu ont poussé des
cris de joie.
Maintenant cette situation a deux conséquences très graves par extension
logique.
Premièrement : étant le rang de dirigeant planétaire et, à partir d'Ésaïe
14, étant à ce stade attribué à Satan, il est évident qu'il y avait d’autres
Étoiles du Matin, ce qui implique l'existence d'autres systèmes planétaires
et l'inclusion avec les Fils de Dieu, tout en les distinguant, implique
également que les systèmes étendus étaient de degré et de rang.
Deuxièmement : cette affirmation porte en elle l'implication que l'extension
de l'esprit de Dieu était relative. Nous avons vu la distinction entre
Eloah, le Dieu singulier ou Dieu le Père, et le Dieu ou Elohim étendu, qui
constituait une pluralité en tant que Conseil des Dieux. Ceux-ci semblent
correspondre aux Étoiles du Matin. Les Bene Elohim ou Fils de Dieu sont
subordonnés.
Nous
pouvons maintenant poser quelques questions au sujet des affirmations du
Monisme, dès le début, avec celle de Parménide, où il ne peut y avoir ni
plus ni moins de l'unique, et c’est, comme James le dirait, “du prochain au
néant prochain”. Manifestement, le concept ici embrassé est celui d'une
multiplicité d'entités spirituelles, avec la capacité de trans-matière dans
l'union par extension de l'esprit comme les Elohim. À partir de l'exemple de
Christ, ici c'est une union avec l’Eloah comme un corps unifié, et pour
lequel l’Elohim intermédiaire parle. Les Elohim ont une union et une
communication métaphysiques ou spirituelles, qui à ce jour ont été mal
comprises. C'est de cette union que Dieu est Un. Temporairement Dieu n'est
pas “tout en tous”. Cette situation s'est produite en raison de la rébellion
et sera corrigée avec l'avènement de la nouvelle Étoile du Matin, Le Messie.
3:2.4 Les
Chérubins
Le
terme “Fils de Dieu” est, à partir de ce qui précède, un ordre d'êtres, un
rang, qui sont des adeptes du Très-Haut dans une certaine forme d'union
spirituelle. Ces Fils du Dieu Très-Haut sont tous Elohim (du Psaume 82:1) à
des degrés divers. Le Conseil des Elohim est le conseil de jugement, et
l’Elohim, ou nouvelle Étoile du Matin de la planète Terre, a pris sa place
parmi les Elohim. Le conseil semble donc être le conseil des commandants de
planètes ou de systèmes appelés Étoiles du Matin. Les Étoiles du Matin
semblent avoir reçu les fonctions de chérubins. Avant sa chute, l'Étoile du
Matin actuelle, Azazel ou Lucifer, était l'un des chérubins protecteurs. Il
ressort de 2Samuel 22:11, Psaume 18:10 et Ézéchiel chapitres 1, 9 et 10 que
l’Éternel monte sur quatre chérubins. Le concept d'avoir des commandants
planétaires comme transporteurs spatiaux est pour ne pas dire intéressant et
le concept est donc probablement allégorique, indiquant l'autorité
investie : l'Ange de la Rédemption portait aussi le nom de l'Éternel en tant
que El et Elohim et a été appelé YHVH ou Yahovah à la différence de YHVH ou
Yahovah des Armées ou Eloah. Ce concept pré-cartésien est peut-être le plus
déroutant aux penseurs non-hébreux (le reste du monde). En portant les noms
de Dieu, le HaShem, l'entité portait également l'autorité. C'est la
caractéristique principale du Messie.
Après
le concept de la chute de l'homme, où les hommes avaient atteint la
connaissance du bien et du mal, l’Elohim dit : “Voici, l'homme est devenu
comme l'un de nous, sachant le bien du mal.” Ici, l’Elohim a été traduit par
l’Éternel Dieu, et ces formes sont clairement erronées. Le problème
fondamental est que les textes ont été traduits par des érudits imprégnés de
la théologie athanasienne et chaldéenne, et ils ont toujours obscurci la
structure métaphysique par des idées fausses et des interprétations
erronées. Le mot God (Dieu en anglais), en tant que terme vient de l'anglo
saxon “Good” (bon) et il est singulier seulement dans le sens de la
centralité de la bonté ultime. Le(s) Elohim a (ont) placé des chérubins à
l'est du Jardin à partir de ce moment-là, pour empêcher l'homme de manger de
l'arbre de la vie et obtenir la vie éternelle. L'homme n'a donc pas une vie
spirituelle éternelle. L'homme a été créé à l'image des Elohim par les
Elohim à partir de la matière, et l'homme n'est donc pas un esprit. Tout au
long de l'histoire de la création, la création est faite par les Elohim,
parlant au pluriel. Ce n'est qu'à Genèse 6:5 qu’est mentionné YHVH
(transmettant le singulier) comme observant la méchanceté de l'homme.
Des
tâches ont été attribuées aux chérubins du conseil autour du trône de Dieu
et nous savons à partir de la représentation biblique qu'il y avait au moins
deux chérubins protecteurs, et probablement quatre, comme nous le voyons
d'Ézéchiel. Ces figures ont un symbolisme composite et là où ce symbolisme
composite est différencié, elles sont notées comme des séraphins avec 6
ailes (Ésaïe 6:2,6). Ces créatures servent le trône de Dieu (l’Eloah), ou
Ancien des Jours qui “a créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles
existent et qu'elles ont été créées” (Apoc. 4:11). L'Ancien des Jours est le
créateur, et les Elohim, à partir de cela, ont créé par la volonté de
l'Eloah (ou l’Éternel) et en accord avec Son dessein. Nous n'allons pas
spéculer ici sur le rôle des séraphins désignés pour servir, ni sur la
nature corporative de la symbolique des chérubins (voir les documents
La Signification de la Vision d'Ézéchiel (No. 108)
et
Commentaire sur Zacharie (No. 297)).
Le terme utilisé dans Apocalypse chapitres 4 et 5
pour désigner les vingt-quatre vieillards est presbuteros, ce qui
signifie sénior ou aîné, et qui, selon la Concordance de Strong, est utilisé
pour désigner une figure du conseil céleste (voir Greek Dictionary, p. 60).
C'est le conseil divin des Elohim. Christ est loué par eux, car il a racheté
les hommes des nations à Dieu par le sacrifice de l'Agneau, pour en faire
des rois et des sacrificateurs pour leur Dieu
[Pantokratõr] Theos le Tout-Puissant, c’est-à-dire
ton Theon, pour régner sur la
terre. (À la fois ici et ci-dessus, l'article défini et le terme pour Dieu
sont dans un sens distributif et peuvent être au singulier ou au pluriel.
S’ils sont au singulier, avec le terme additionnel, le Tout-Puissant, ils
signifieraient le Dieu Très-Haut, c’est-à-dire Le Dieu). Le terme Theos peut
être ainsi hiérarchique comme l’est Elohim avec le Plus Élevé des Elohim, ou
Theos comme Eloah (Ho Theos ou l’accusatif Theon) [Bien que le trône soit un
trône partagé]. En raison de ses implications, ce verset est mal traduit de
manière flagrante dans certaines Bibles, (par exemple Knox, KJV, NKJV). Il
est presque aussi bon que l'anglais le permettra dans les versions RSV, NIV,
New English, Jerusalem et Moffatt. Le comité American Standard Version
Committee a corrigé l'erreur de traduction de la KJV dans sa version de
1901.
À partir d’Apocalypse 21, le centre du
gouvernement doit se déplacer sur la terre. Lorsque les chérubins
apparaissent, ils portent la Gloire de YHVH et Son éclat, et le bruit de
leurs ailes est comme la voix de l'El et la Gloire de l’Elohim est au-dessus
d’eux. Dans Ézéchiel 10:20, ils soutiennent l’Elohim, et c’était l'Elohim
qu’il a vu près du fleuve Kebar. L'Esprit parle à partir d'eux. Ézéchiel
déclare que l'Esprit de YHVH lui a parlé, lui transmettant un message de la
part d'Adonaï, ici utilisé dans le sens de
“mon Seigneur”.
YHVH est le porte-parole ou la médiation des Elohim, symboliquement soutenu
par les chérubins comme éléments de la force de l'Elohim. YHVH, à partir
d'Ézéchiel 11, se désigne comme l'Elohim d'Israël, et aux versets 7-21,
renvoie curieusement à YHVH l'Éternel sous la forme d'adresse respectueuse
utilisée par ses subordonnés, par exemple, par Abraham, en se référant à
lui, c'est-à-dire comme Jehovih. L'utilisation de [Adonaï et Jéhovah] ici
comme déférence montre que nous sommes abordés par l'Ange de YHVH, de
l'Éternel ou d’Eloah ; par l’Elohim médiateur qui porte son nom comme YHVH.
Ce concept est des plus importants puisque la métaphysique en dépend, de
même que la compréhension de la nature de la Divinité, la séquence de la
création ainsi qu’une explication adéquate de son objet.
La distinction entre les entités qui portent
le Tétragramme YHVH est faite explicitement par Michée 5:2-4 :
Et toi, Bethléhem Ephrata,
petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui
dominera sur Israël, et dont l’origine remonte aux temps anciens, aux jours
de l’éternité. 3 C’est pourquoi il les livrera jusqu’au temps où
enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra
auprès des enfants d’Israël. 4 Il se présentera, et il gouvernera
avec la force de [Ya]hovah [YHVH], avec la majesté du nom de [Ya]hovah, son
Dieu : Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu’aux
extrémités de la terre.
Ici, le concept hébreu de l'entité, qui était
tenue par Michée d’avoir eu la préexistence depuis
“les temps anciens” :
ce qui, de ce qui précède, en toute logique était le commencement du temps
commençant par la création des Elohim. Cette entité a porté le Tétragramme
YHVH, mais cependant YHVH était aussi son Dieu, rappelant le concept de
“par conséquent Elohim, ton
Elohim t'a oint”.
Conceptuellement le nom portait l'autorité, d'où la pratique d'appeler les
magistrats “Elohim”,
qui perdure aujourd'hui dans la terminologie
“your worship”
en anglais [lit. votre adoration], [l’équivalent en français serait
“le Vénérable”].
Il y a une distinction claire entre l’Elohim
YHVH et YHVH des Armées. Zacharie 2:5-13 fait cette distinction où YHVH dit
qu'il vient pour résider à Jérusalem et que, lorsque cela se produit,
“vous saurez que Yahovah (YHVH)
des armées m'a envoyé.” Cette
entité était clairement subordonnée à YHVH des Armées, et le YHVH ici est
cette entité du Psaume 18:28 qui est “mon
rocher”.
Dans le Psaume 18:31, il est “notre
Elohim”, et Eloah est le YHVH,
Yehovih (SHD 3069) ou YHVH des Armées. YHVH l’Elohim d'Israël est une entité
séparée et distincte de YHVH des Armées, l’Eloah, ou Dieu le Père et
Créateur. L'incarnation était tenue d’être YHVH et l'Elohim d'Israël, mais
subordonné à son Elohim, qui était Eloah. Les deux entités existaient
seulement à partir de la création des Elohim, comme des entités distinctes :
le Logos ou l'Expression Divine, un attribut de Dieu, faisant ou créant la
réplication du Logos en tant que l’Elohim. L’Elohim de cette planète est le
Grand Prêtre ou Médiateur.
D’après les Psaumes, le YHVH d'Israël est un
grand roi au-dessus de tous les Elohim (Psaume 95:3), redoutable par-dessus
tous les autres Elohim (Psaume 95:4), et est l'Elohim des Elohim (Psaume
136:2). Les Elohim, par conséquent, ont des degrés de rang, certains étant
subordonnés aux autres et tous subordonnés à Eloah. L'Elohim d'Israël était
ce Rocher qui était Christ, mais il n'était pas et ne pouvait pas être Eloah
ou YHVH des Armées. Tous les Elohim étaient autrefois à l’intérieur de la
volonté d'Eloah, mais les Elohim rebelles se sont placés en dehors de Sa
volonté et de la structure des Elohim. Ils sont, cependant, restés Elohim
comme des Elohim déchus et sont appelés Elohim tout au long de l'Ancien
Testament. Les Elohim déchus se différencient des images taillées qui
“ne sont pas des Elohim”
(2Rois 19:18, Jér. 2:11).
La prononciation correcte de YHVH a été
délibérément occultée, et nous avons vu plus haut qu'il y avait une forme de
déférence utilisée par l'Ange de YHVH, lorsqu'il se réfère au plus élevé
YHVH ou YHVH des Armées. La forme de déférence a été obtenue en changeant la
dernière voyelle de a à i. La reconstruction de la prononciation correcte du
terme peut être établie à partir des formes utilisées au temple à
Éléphantine, où la forme a été raccourcie plutôt que modifiée. La traduction
du papyrus d'Éléphantine est contenue dans l’ouvrage de James B. Pritchard :
The Ancient Near East, vol. 1, p. 279. Le nom est rendu YAHO et les
formes sont donc YAHOVAH des Armées ou YAHOVAH (prononcé YAHOWAH comme un W
silencieux) ou lors de l'utilisation de l'adresse de déférence, il est
YAHOVIH [ou YEHOVIH (SHD 3069)].
Les Elohim étaient une reproduction de l'image
d'Eloah, comme l'Homme a été fait à l'image des Elohim. Christ était
“l'image du Dieu invisible, le
premier-né de toute la création.”
C'est ainsi que la création a commencé avec les Elohim dans l'Ange de la
Rédemption et de ses collègues ou camarades, à partir de laquelle a commencé
le temps. Ces concepts sont abordés ci-dessous et ont une incidence sur les
concepts et la structure de l'explication causale car ils ont été
imparfaitement compris.
3:3.1
L'Esprit de l'Homme et l'Ordre Angélique
Après avoir examiné la structure de la
Divinité, il est évident qu’il s’agit d'une hiérarchie unifiée d’êtres,
provenant d'une singularité centrale à l’intérieur de laquelle volonté la
structure agit. Lorsque des entités agissent de manière contraire à la
volonté d'Eloah, elles sont décrétées pour être en rébellion et donc
polythéistes. De telles entités doivent donc être détruites, ayant une
existence et un but limités. L'exigence de ces entités d’être spirituelles
est dictée par la procédure logique et la limitation physique. La
sous-structure de la matière semble être immatérielle, contribuant ainsi à
la notion d'une intelligence immatérielle régulant la structure matérielle.
Pour décider de la nature de l'être humain et
sa relation à la sphère immatérielle ou spirituelle, il est nécessaire
d'examiner ce qui est connu de l’entité humaine ; ce qui est tenu pour être
sa structure et son but dans la révélation et quels accords et tensions
existent entre les considérations philosophiques et la révélation. Il est
également important d'examiner si l'argument en faveur de l'invraisemblance
de l'âme démontre aussi l'invraisemblance d'un Dieu spirituel.
Il est soutenu que la position adoptée par de
nombreux philosophes désireux de rejeter la doctrine de l'âme non seulement
n’est pas en conflit avec la révélation mais au contraire est logiquement
correcte et, en fait, conforme à la séquence entière de la révélation.
Il est préférable que la
structure et la nature de la Divinité et sa relation avec l'homme et son
destin soient laissées à l'analyse détaillée de la dispute
athanasienne/arienne, parce que dans cette section, on peut voir exactement
quelle est la relation et la structure relative de la Divinité. On peut
également voir comment les erreurs fondamentales de la logique et de
l'exégèse ont été faites, lesquelles ont complètement déformé la
compréhension de ces seize cents dernières années.
Les arguments en faveur de l'invraisemblance
de l'âme sont déterminés par les exigences d'un Dieu omniscient et
omnipotent. Loin d'exiger le rejet d'un Dieu spirituel, le rejet de la
doctrine de l'âme est nécessaire parce qu’une divinité omnipotente et
omnisciente ne créerait pas une série d'entités qui seraient imparfaites, à
des degrés divers de mal ou de rébellion contre la loi et la volonté de
Dieu, et qui ne nécessiteraient pas une ontologie relativement plus
compliquée et une destruction dans l'exécution du plan qu'Il avait mis en
mouvement. Un Dieu spirituel devrait logiquement limiter un tel être
imparfait à une structure facilement aliénable, qui conviendrait
parfaitement à un processus d'apprentissage transitoire, et qui
n’impliquerait aucune cruauté ou punition à long terme pour une faiblesse
inhérente au système, dans le cadre du processus d'enseignement.
La base pour les actions et les événements des
entités humaines sont explicables dans un seul contexte. Nous avons vu les
premières explications de causalité et de l'action humaine sur la base de
l'Animisme, puis alors du Platonisme à la Distinction Cartésienne, et
pourquoi une telle explication est fausse.
La distinction entre les actions ou les
événements volontaires ou déterminés est complexe, et nous devons maintenant
commencer par examiner l'explication biblique et le concept de l'homme en
tant qu’image de Dieu.
Le récit biblique limite l'application de la
distinction entre les actions et les événements comme des actes volontaires
ou des événements déterminés, tel qu’indiqué précédemment, au processus
rationnel ; l'esprit de l'homme n'est qu'une image des Elohim et non un
esprit immortel. Le nephesh ou l'esprit de l'homme meurt avec le corps.
L’Elohim a dit : “Faisons l'homme
à notre image” (Genèse 1:26).
Alors Elohim créa l'homme à son image, à l'image d'Elohim il le créa (Gen.
1:27). Il a été imaginé que l'anthropomorphisme est le concept ici, mais
cela peut être métaphorique et beaucoup plus compliqué. Le Coran nie
explicitement l'anthropomorphisme, et Moore se réfère à cette controverse
dans
The History of Religions,
Vol. 2, p. 424.
Alors que la Bible utilise
un langage anthropomorphique distinctement dans sa représentation d'un Dieu
personnel transcendant, le concept ici de l'image de Dieu peut se référer
aux mécanismes du processus d'animation, compte tenu des interdictions de
Exode 20:4 et la nature spirituelle de Dieu (c.-à-d. Dieu est un esprit et
le Père des esprits). L'image des Elohim peut être le concept de la
rationalité qui anime, qui motive et lie les Elohim, ce qui permet
l'implantation de l'Esprit de Dieu pour atteindre l'unité et la perfection
en tant que Fils de Dieu.
Le dictionnaire
Interpreter’s Dictionary of the Bible
(vol. 2, Abingdon, 1980, pp. 682 et suiv.) dans son article
“Image of
God”
déclare à propos de la référence de l’Ancien
Testament : “La référence de base est à la ressemblance concrète, mais il
faut reconnaître à l'auteur une certaine intention quant à l'idée
abstraite.” Il poursuit en disant que dans le Nouveau Testament, “L'image de
Dieu est quelque chose qui (dans tous les cas sauf deux), n'appartient pas à
l'homme. Elle est identifiée avec Christ, l'image étant désormais le parfait
prototype. Grâce à sa relation avec Christ, le croyant est transformé en la
même image, l'image étant désormais le parfait reflet du prototype.”
Dans Genèse 1:26, image
[tselem SHD 6754] et
ressemblance (demuwth SHD
1823] sont utilisés mais dans Genèse 1:27, sur l'exécution, seul image
est utilisé. Genèse 5:1 utilise ressemblance (qui est parfois
considéré comme un lustre rédactionnel) et Genèse 9:6 utilise image.
Selon le dictionnaire Interpreter’s Dictionary :
Pour compliquer
l'interprétation, l'utilisation des prépositions qui vont avec les noms
n'est pas cohérente (ibid., p. 683). Dans (Genèse) 5:1 [demuwth] ressemblance a la préposition qui va avec [tselem]
image dans 1:26-27, alors que dans 5:3 les prépositions sont inversées. Cela
se produit aussi puisque les mots concernant la ressemblance entre Adam et
Seth sont interchangeables, bien que dans quelque 45 Manuscrits la lecture
soit en harmonie avec 1:26.
Étant donné que
l'utilisation de [tselem]
image a une souplesse de sens, si
elle provient de la même racine, alors le concept pourrait bien se rapporter
non pas particulièrement à la ressemblance physique, mais au facteur
rationnel qui anime, lequel active les Elohim et les Fils de Dieu. Xénophane
de Kolophôn (Frag. 17) suppose que les bovins, les lions et les chevaux,
s’ils le pouvaient, rendraient les dieux à leur propre ressemblance. Ce ne
serait pas d'une proposition rationnelle, mais plutôt de l'idée qu'ils se
sentiraient nettement plus à l'aise avec eux.
Une entité spirituelle qui
est invisible et peut se matérialiser sous la forme d’un homme avec ses
attributs physiques et sous la forme d’un serpent ne serait pas logiquement
limitée dans les formes de sa matérialisation, en particulier si dans
l’hypothèse que la matière est composée de simples immatériels ultimes.
C'est la mauvaise application de cette logique qui se cache derrière
l’animisme babylonien et en fait de tout animisme. La Bible est très
spécifique dans l'affirmation que tous les Elohim et Fils de Dieu ont pu se
matérialiser et prendre une forme humaine absolue. L'Armée Déchue semble
avoir possédé cette capacité, et si elle ne possède plus maintenant la
capacité, cela ne peut être dû qu’à une limitation supplémentaire qui leur
est imposée par Eloah et non totalement expliquée.
Le commentaire de Christ,
c'est que, à la résurrection, (les morts) ne se marient pas et ne sont pas
donnés en mariage, mais sont comme des anges dans le ciel (voir aussi Marc
12:25). En plus de ce commentaire à Luc 20:35, au v. 36, les ressuscités
dignes de ce monde ne peuvent plus mourir, parce qu'ils seront semblables
aux Anges. Le mot pour Ange est ici … isaggelos, qui est un dérivé de
… aggelos et … isos, ce qui signifie
semblable,
de la nature ou
égal à, donc similaire ou
égal aux (comme un ordre d’)
anges.
L'hypothèse selon laquelle
le ressuscité sera supérieur à l'angélique est dérivé du passage à
1Corinthiens 6:3 où Paul dit, “ne savez-vous pas que nous jugerons les anges
?” Toutefois, il se réfère à l'armée déchue ici, qui n'a pas gardé son
premier état, à cause de la rébellion. La prémisse semble reposer sur
l'hypothèse que Christ était les prémices des élus, et qu’il a été rendu un
peu inférieur aux anges par l'incarnation, puis élevé au-dessus de ses
camarades, ce qui implique qu’il en sera de même pour les élus. Mais il se
peut que cela ne soit pas du tout le cas, puisque les élus seront Fils de
Dieu, ce qui, comme nous l'avons vu, est le rang [grade] général de l'ordre
angélique. Il est plus probable que les élus soient le remplacement de
l’Armée perdue. Les rangs de la Première Résurrection sont de préséance dans
les Elohim, et les élus de la Première Résurrection sont des enseignants en
tant que des rois et des prêtres pour la rédemption générale de la
population mondiale à la Deuxième Résurrection.
Augustin d'Hippone ne
comprenait pas ce point et, afin d'établir la Doctrine de l'Âme chaldéenne,
il a été contraint de refuser le règne Millénaire de Christ. Il a placé la
Première Résurrection comme celle de l'esprit à la mort et la Deuxième,
comme celle du corps physique le jour du jugement. Il a vu le Chiliade comme
une erreur de l'église primitive. Il était tout à fait incorrect dans cette
position et, par son erreur, a sérieusement affecté le Christianisme.
Dans la
Cité de Dieu, Livre XXII Chapitres
4 et 5, il affirme l'ascension au ciel d'un corps matériel de Christ après
la résurrection. La doctrine de l'âme à la résurrection est décrite par lui
au Livre XX Chapitre 6 (les citations sont ici de la traduction de
Bettenson, Penguin Books, 1987, pp. 903-917f). Par son erreur, il développe
le concept selon lequel “toute personne qui ne souhaite pas être condamnée
dans la deuxième résurrection doit se lever à la première” (p. 905). Il
soutient que tous ceux qui ne se lèvent pas à la première résurrection
souffriront la seconde mort. La doctrine de l'âme l'a conduit à cette erreur
et aux absurdités logiques et non-bibliques qu'il développe à partir de
celle-ci. Par son raisonnement, l'ensemble du monde préchrétien et non
chrétien (ou en fait non-athanasien) est condamné [étant] sans connaissance.
Au chapitre 7 (ibid., p. 906), il montre une certaine familiarité avec la
doctrine Millénaire de l'Église primitive, mais ne la réfute pas, alléguant
qu'elle était trop longue, et procède plutôt à une situation absurde basée
sur la théologie chaldéenne et l’allégorisation des mots spécifiques de
l'Apôtre Jean. L'absurdité s'étend à travers les chapitres 7 et 8.
À partir du chapitre 9, il
réduit le concept du règne Millénaire à la période qui suit la première
venue de Christ (p. 914). Une telle manipulation du récit est rendue
nécessaire en raison de l'absurdité de la doctrine de l'Âme et du
Trinitarisme en général. Elle a détruit la cohérence métaphysique de
l'Église athanasienne pendant seize cents ans, et c'est pourquoi, jusqu’à ce
jour, les Trinitaires confessent la doctrine comme un “mystère”, ou plus
exactement un “mystère strict”, en ce qu'elle est inexplicable dans tout
système de la logique. Ainsi, il résulte de ce qui précède une tension entre
la philosophie et le soi-disant Christianisme orthodoxe. Beaucoup de
philosophes souhaitent rejeter la doctrine de l'Âme comme incohérente, mais
le système athanasien insiste sur le maintien de l'incohérence. Toutefois,
lorsque le récit original est examiné, une structure non-âme est évidente,
ce qui est en contradiction avec le système athanasien. Cette structure
non-âme rencontre le critère de cohérence du philosophe et est donc en
harmonie avec les attentes raisonnables et logiques de la philosophie. La
tension n'est donc pas entre la révélation et la philosophie, mais plutôt
entre le Trinitarisme athanasien d'une part, et à la fois la révélation et
la philosophie d’autre part.
3:3.2
Les Doctrines Originales du Millénaire
L'origine de l'introduction
de l'incohérence dans la philosophie et la doctrine de l’église primitive se
trouve à la fin du deuxième et début du troisième siècle.
Les doctrines millénaristes
originales de l'Église primitive ont reçu des titres par les auteurs
postérieurs et le Millénarisme ou Chiliasme (provenant de chiliade, aussi un
terme pour mille) est venu à être appelé Pré-millénarisme. La doctrine
originale du règne millénaire de Christ sur la terre était, cependant, plus
ou moins conservée par divers premiers auteurs chrétiens, comme Apollinaire,
Commodien, Hippolyte, Irénée, Justin Martyr, Lactance, Méthode (qui a vu le
millénaire comme un jour de jugement), Montanus, Nepos, pseudo-Barnabé,
Tertullien et Victorinus. La théorie de la 70e semaine retardée,
qui relie Daniel 9:25 à Christ, a été introduite pour la première fois par
Hippolyte. Les excès des enseignements de Lactance lui ont valu le terme de
Chiliasme et le Chiliasme a été considéré comme aberrant. Certains écrits
sont devenus plutôt charnels, avec des emprunts auprès de sources non
bibliques.
Il a été laissé aux
Athanasiens, cependant, de développer pleinement la doctrine de l'âme et de
réfuter la doctrine du règne terrestre à partir de Jérusalem, enseignant que
le millénarisme était une preuve de l'influence étrusque et persane sur
l'église primitive. Origène et Dynonisius d'Alexandrie (mort en l’an 265) se
sont opposés au millénarisme chiliastique excessif, et, par conséquent, le
livre de l'Apocalypse est venu à être omis du Canon par le Concile de
Laodicée (vers l’an 366).
Cyrille de Jérusalem (mort
en 368) et Grégoire de Nazianze (mort en 389) excluent l'Apocalypse ou la
Révélation de leurs catalogues des livres du Nouveau Testament, Jean
Chrysostome (mort en 407) ne l’a citée nulle part. Athanase l’a incluse dans
son énumération, les Conciles d'Hippone (393) et de Carthage (397) l'ont
déclarée canonique (voir les détails de l'histoire dans
A General Survey of the History of Canon of the New Testament de
l’Évêque B.F. Westcott, 1875, chapitre 20).
Lors de la réintroduction de
l'Apocalypse dans le Canon, il est devenu nécessaire de réajuster son
interprétation pour tenir compte de la doctrine de l'âme, puisque c'est dans
ce livre, au chapitre 20, que le règne terrestre de mille ans de Christ,
avec deux résurrections séparées, est explicitement et inévitablement
déclaré. En conséquence, il a été laissé à Augustin de juxtaposer la
doctrine athanasienne afin de tenir compte de cet enseignement sur une base
un tant soit peu cohérente. Sa reconstruction, à ce jour, constitue encore
la base de la majorité de l'enseignement chrétien et est responsable de
l'incohérence logique.
La théorie augustinienne de
la spiritualisation du Millénaire est basée sur la théorie de la
récapitulation avancée par Tichonius, selon laquelle la Révélation se répète
sous les symboles des sept sceaux, trompettes et coupes, une position qui
est absurde. L'idée du Millénaire comme étant le règne terrestre de l'église
a également été introduite par Tichonius, et semble avoir été utilisée par
Eusèbe pour persuader Constantin. La structure entière semble avoir été
construite pour apaiser la vanité romaine politique.
Jérôme a fait valoir que le
Millenium était céleste, non pas terrestre, et semble avoir donné à Augustin
la fondation qu'il recherchait pour la reconstruction. Le concept a été
poursuivi jusqu’à la conclusion non biblique que le règne eschatologique de
Christ dans les derniers jours n'est pas terrestre, mais céleste, et que
Satan parcourra une terre désolée pendant 1000 ans. Ce concept n'a aucun
fondement logique, contestant l’omnipotence de Dieu, et introduit la
doctrine de l'âme sous une autre forme dans le Christianisme. Une variante
de cette aberration se trouve dans la théorie du ravissement/enlèvement, qui
est contraire à l'exposition biblique et est logiquement erronée, comme en
témoigne le développement de cet ouvrage. Voir le document
Le Millenium et le Ravissement/Enlèvement (No. 095).
3:4 Le
Logos et la Création
3:4.1
Volonté et Nature
“Au commencement
était la Parole [Logos], et la Parole [Logos] était avec Dieu et la Parole
était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été
fait n’a été fait sans elle.” (Jean 1:1-3)
Il est l'image
du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été
créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a
été créé par lui et pour lui (Col. 1:15-16, LSG).
Il convient de noter que
Jean 1:1 présente un problème de traduction. Il y a deux mots pour Dieu
impliqués et une inversion. Le texte devrait se lire comme suit : “Au
commencement était le Logos et le Logos était avec Theon et Theos était le
Logos.” Pour justifier l’inversion de “et le Logos était Dieu”, Alfred
Marshall dit dans son RSV Interlinear (qui s'accorde avec le Receptus) dans
la note de bas de page, “Mais notez que le sujet a l'article et que le
prédicat ne l'a pas, d'où traduire ‘La Parole était Dieu’.” Faire cela est
un artifice athanasien pour établir le système trinitaire. Jean faisait
clairement référence à deux entités distinctes, le Theon et Theos, car au
verset 18, il dit :
[Theon
oudeis eõraken
põpote
monogenes]
Dieu [Theon] nul
homme n'a vu jamais ; (le) seul engendré [en fait le seul né]
[Theos
o õn
eis
ton kolpon
tou patros, ekeinos
ezhghsato].
Dieu [Theos] le
(un) être dans le sein du Père, celui-là a déclaré [? lui].
D'affirmer que la différence
est seulement grammaticale rend la structure incohérente et contraire à la
structure hébraïque étant expliquée. L'ajout de “lui” dans ce passage est
inapproprié puisque Jean semble utiliser le concept bien connu des Grecs du
“Ho Legon”. Il identifie Christ comme le “Dieu qui parle”. Jean utilise
aussi clairement les concepts de l'Ancien Testament du Dieu Unique, Eloah,
comme le Theon et du subalterne comme Theos ou Elohim.
Les Athanasiens ont dû
inventer ce passage pour appuyer la doctrine de la Trinité, et, finalement,
les Athanasiens européens (contestés par Erasmus) devaient insérer le faux
texte dans 1Jean 5:7 dans le Textus Receptus, afin de réorganiser la
Christologie.
Jean et Paul attribuent la
création au Logos. Le concept ici est l'Expression Divine. En outre,
2Corinthiens 4:4 identifie Christ comme l'Image de Dieu. Apocalypse 4:11,
cependant, déclare à propos de Dieu que
“Tu as créé toutes choses, et c'est par Ta
volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées”.
Le concept ici a conduit la
majorité des sectes chrétiennes dans l'erreur et a précipité le conflit
majeur entre les deux factions, qui ont été nommées d’après leurs
porte-parole, au moment de l'éclatement de la controverse sur une grande
échelle en 318 [EC], à travers la perturbation générale de Nicée, en 325, le
synode supplémentaire d'Antioche en 341, et enfin au Concile de
Constantinople en 381, où les Athanasiens ont pris le contrôle, assistés par
l’espagnol de naissance Théodose. Par la suite, le différend a été réglé par
la force des armes entre les nations, se terminant en Espagne en 586 et en
Thuringe en 742 EC avec les conversions de Boniface. Les deux parties
étaient la faction athanasienne, qui a émergé postérieurement comme la
faction orthodoxe ou catholique, et la faction unitarienne, appelée faction
arienne ou eusébienne, nommées aussi d’après leurs principaux porte-parole.
Si ce différend avait été
bien compris et correctement réglé à ce moment-là, le Christianisme aurait
pris un cours très différent avec une structure philosophique beaucoup plus
cohérente. Les sciences humaines et la paléoanthropologie auraient été mieux
comprises et probablement progressées plus pacifiquement, évitant à la fois
les Âges Sombres
(Dark Ages) et les Inquisitions et
peut-être une Troisième Guerre Mondiale à venir. Examinons le différend.
Les protagonistes étaient
Alexandre et Athanase, les évêques d'Alexandrie respectivement de 312-328 et
328-373, pour les Athanasiens, et Arius (256-336), Astérius le Sophiste
(mort vers 341), et Eusèbe de Nicomédie (mort vers 342), pour les Ariens ou
Eusébiens.
Malheureusement, avec la
défaite des Ariens en Espagne, l'histoire a été écrite par les Athanasiens,
et un rapport complet, précis et impartial est pratiquement impossible.
Cependant, Robert C. Gregg et Dennis E. Groh ont écrit un ouvrage utile
intitulé Early Arianism: A View of Salvation (Fortress Press,
Philadelphia, 1981). À partir de cet ouvrage, nous pouvons établir une
partie de la métaphysique, et il deviendra évident que les deux factions
étaient dans l’erreur.
Les reconstructions de la
Thalia d'Arius s'appuient sur les écrits de leurs adversaires et donc ont
été à tort simplistes. Les arguments se centrent, comme les Athanasiens
l'ont vu, autour de ce qui suit :
Le salut, pour
l'orthodoxie, est effectué par l'identité essentielle du Fils avec le Père :
ce qui lie Dieu et le Christ à la création c’est l’assomption de la nature
divine de la chair ; le Salut pour l'Arianisme est effectué par l'identité
du Fils avec les créatures : ce qui lie Christ et les créatures à Dieu,
c’est la conformité de la volonté. (Gregg et Groh p. 8).
Les Athanasiens, en
acceptant la définition biologique de fils ont développé un lien ontologique
entre le Fils et Dieu qui a permis à Christ d'être le Logos et la Sagesse
proprement dits de Dieu, et qui ont investi le Fils de l'omniscience divine
(ibid., p. 9).
Les Unitariens maintenant
appelés Ariens plaçaient et utilisaient un sens étendu de la filiation dans
les Écritures par lesquelles Dieu a dit "d'adopter des fils" parmi ses
créatures. Fils en ce sens est une périphrase pour croyant et
le terme a ce sens dans les textes ariens de preuve comme Deutéronome 14:1
et Jean 1:12. Par conséquent, toutes propriétés ou pouvoirs qui peuvent être
réclamés pour le Fils dans les Écritures sont lus dans ce sens élargi, selon
lequel le fils gagne ceux-ci par l’adoption en tant que croyant, et ce point
est poussé par les Ariens pour inclure même les réalités clés :
Et Christ n'est
pas vrai Dieu, mais par la participation ... même il a été fait Dieu .... Le
Fils ne connaît pas exactement le Père, ni le Logos ne voit-il le Père
parfaitement, et ni ne perçoit-il, ni le Logos ne comprend-il exactement le
Père, car il n'est pas le seul et véritable Logos de (du) Père, mais par un
nom seul, il est appelé Logos et Sophia, et par la grâce est appelé Fils et
Puissance. (ibid., p.9)
Alors, ici la relation
ontologique entre le Père et le Fils est brisée dans l'Arianisme comme les
Athanasiens le voient, de sorte qu’aucune connaissance ou perception
naturelle entre le Père et le Fils, voire entre n’importe quel père et son
fils, peut être présupposée ou construite. Le fils est une créature. Comme
pour toutes les autres créatures, aucune analogia entis
directe ne peut exister entre le créateur souverainement libre dont
le modus operandi est par sa volonté et les créatures qui
existent selon son gré (idem).
Ainsi, il est estimé que
l'argumentation de Eusèbe de Nicomédie nie que la nature de Dieu peut être
déduite de ses effets, que ce soit à partir de fils rebelles (Ésaïe 1:2),
des créatures frivoles (Deutéronome 32:18) ou des gouttes de rosée (Job
38:28).
Pour les Athanasiens, la
position est simplement posée par Alexandre comme :
Il faut voir que
la filiation de notre Sauveur n’a pas de communauté avec la filiation du
reste [des personnes] (ibid. p.8).
Cette position découle du
commentaire
“le seul Fils engendré de Dieu” (Jean 3:16,18). Le mot est ici ... monogenes, qui
signifie
“seul-né”,
et il y a une différence subtile et distincte. Ceci
est fondamental pour les propositions métaphysiques évoquées ci-dessus où
les Ariens ont compris le concept que
“vous devez être
né de nouveau”.
Les Athanasiens
ont vu que les Ariens considéraient les croyants pour être des fils. Le
processus de l'engendrement se faisait par le baptême et l'imposition des
mains pour recevoir l’Esprit Saint après la repentance. Pour cette raison,
le baptême n'a pas été conféré avant l'âge adulte et Augustin lui-même a
respecté cette pratique (voir l'article
“Augustine” Catholic Encyclopaedia, 1907).
L'introduction du baptême des enfants a été considérée comme absurde dans ce
schéma. Les Fils de Dieu célestes étaient engendrés et les élus étaient
engendrés de l'esprit. Christ était le seul Fils de Dieu né. L'erreur de
traduction est un obscurcissement.
Le concept engendré
vient de ... gennao, né ou conçu, utilisé dans Actes 13:33 et Hébreux
1:5:
“Mon fils ce jour je ‘t’ai amené à la naissance’,” et Philémon 10 où se rapportant à Onésime il est
traduit
“que j’engendrai (ai engendré), tandis que j’étais
dans les chaînes.” Le terme anagennao ou né de
nouveau/régénéré est utilisé dans 1Pierre 1:3 où Dieu le père
“nous a régénérés [= engendrés] de nouveau pour une
espérance vivante”, et dans 1Pierre 1:23 comme
“né de nouveau”.
En tant que premier-né d'entre les morts (Apoc.
1:5), Christ était le ... prõtotokos, littéralement le premier-né.
Cependant, il est traduit à Romains 8:29 comme le
“premier-né entre plusieurs frères.” Ce concept de naissance est celui de l'extension de
l'Esprit, et a été évité par les Athanasiens afin d'établir la doctrine de
l'âme et le concept d'une Divinité triune éternellement existante, une
position qui est limitée et qui n’est manifestement pas le concept.
Les Ariens ont correctement
supposé que si Christ ne connaît pas toutes choses, alors il ne pouvait pas
être le Logos proprement dit de Dieu. Le fait qu'il ne savait clairement pas
tout est attesté du commentaire à Marc 13:32 concernant le jour et l'heure
de son retour, où
“nul ne le sait, ni les anges ni le fils.”
Christ n'est donc pas
omniscient. Les Athanasiens devaient également nier le fait et attacher une
signification allégorique, comme lorsqu’il a posé une question rhétorique en
pleine connaissance de la réponse (par exemple, qui les hommes disent-ils
qu'il est ; Matt. 16:13 et où Lazare était ; Jean 11:34). Cependant, cette
option n'est pas ouverte à Athanase concernant le commentaire ci-dessus sur
le retour, car si en fait il était trompeur alors également Christ ne peut
pas être Dieu, puisque, en tant que le Logos, il aurait voulu mentir et donc
commis un péché.
Cette perception relative a
été déclarée par Arius comme suit :
Permettez-moi de
dire clairement comment l'invisible est vu par le Fils ; par la puissance
par laquelle Dieu [ho Theos] est capable de voir, dans sa propre
mesure le Fils se soumet [upomenei] pour voir le Père comme il se
doit." (ibid. p.10)
Les Athanasiens attribuent
un concept d'Irénée à Arius. Dieu est invisible et personne n'a jamais vu
Dieu à aucun moment (Jean 1:18). Le Fils était celui qui l'a déclaré. Le
fils était donc cette entité appelée l'Ange de la Rédemption ou YHVH de
l'Ancien Testament. D’après Exode 33:20, personne ne verra même cette entité
et vivra quand il
“a proclamé le nom de l'Éternel devant eux.” (v. 19) De cela l’incarnation impliquait une
modification de cet aspect et entraîne une manifestation relative de
l'esprit.
D’après Irénée : Être
dépendant de la volonté de Dieu, c’est avoir une connaissance proportionnée
de lui, dans la mesure où il veut, et c'est exactement la position exprimée
par Christ. Ce n'était pas à Christ d'attribuer des positions à sa droite ou
à sa gauche, mais elles ont été préparées par le Père (Matthieu 20:23).
Christ a été directement subordonné à la volonté du Père. De Jean 4:34 et
3:68 ;
“Ma
nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé”,
et
“Car
je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui
qui m'a envoyé.”
De Luc 22:42, Christ avait
aussi une volonté, mais l’a subordonnée au Père. Par conséquent, par choix
il subordonne sa volonté en exerçant son libre arbitre.
Le Seul et même esprit opère
toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut
(1Corinthiens 12:11). Gregg et Groh disent de ce concept (à la page 11) :
Ce qu’Arius a
apparemment à l'esprit fonctionne un peu en parallèle à un ancien système
anthropologique chrétien de la créature sous l'Esprit de Dieu (en effet
celui qui participe à l'esprit) qui ne reçoit pas la connaissance de Dieu
tel qu'il est en lui-même (Irénée dit
“sa grandeur”
et “sa gloire ineffable”)
et dont la capacité de voir dépend de l’autorévélation disposée du Père
(Arius : “par la puissance que Dieu voit”
; Irénée : “Dieu donne même cela aux hommes
qui l'aiment, c'est-à-dire voir Dieu”).
Le fait que le Fils avait
une expérience limitée ou proportionnelle du Père semble avoir indiqué à
Arius que Christ, comme toutes les autres créatures, a été moulé dans le
rôle d’un serviteur obéissant vivant par la foi en son Père.
Les théories de la liaison
platonique avec l'Unique se sont opposées à une révélation théophanique
conditionnelle à l'obéissance. C'est pour cette raison que le schéma des
premiers Chrétiens a été abandonné, et non pas pour un quelconque diktat du
récit biblique ou de la logique.
3:4.2
Foi et Sagesse
Athanase a bien démontré que
le terme fidèle a son sens accepté (d’obéissant), et qu’inversement,
de Dieu à l'homme, il porte le concept de loyauté. Hébreux 3:2a déclare que
Christ était "fidèle à celui qui l'a fait". Le mot fait ici est ... poieo,
qui signifie fabriquer ou faire, et a une large application. La traduction
“établi” est une
construction évidente pour éviter la notion que le fils a été fait. Le sens
original était certainement fait et est conservé dans le débat enregistré
par Athanase dans la seconde "Allocution". Gregg et Groh notent qu’Arius a
utilisé le mot fidèle pour qualifier ce verbe fait qui est
littéralement fidèle à celui qui l’a fait (ibid., p. 11). Tous les
Athanasiens depuis, Catholiques et Protestants, ignorent le concept fait, le
traduisant plus récemment comme établi.
Athanase est cité comme
disant :
“‘Qui
est fidèle à celui qui l'a fait’ n'implique
pas la ressemblance [tenomoioteta] à d'autres hommes, ni que,
croyant, il soit devenu bien agréable." Que le fils divin ait été une créature
'fidèle', c'est-à-dire qu'il a exercé la foi (fidélité de croyance) en son
créateur, était totalement répugnant à Athanase (ibid.).
Pour les Athanasiens :
Si le texte de
l’épitre aux Hébreux devait être compris, il ne pourrait pas être pris pour
se référer à 'l’essence de la parole' mais devait être une référence à
l'incarnation de la Parole. Rien ne pouvait être plus éloigné de l'image
arienne du Christ (ibid., p. 12)
De là, le débat s’est
polarisé, chaque groupe expliquant la doctrine à partir de ses propres
présuppositions. Les Ariens ont expliqué le salut et le Christ en tirant les
liens les plus étroits possibles entre lui et l'humanité. Athanase et
Alexandre ont placé Christ aussi loin que possible de toutes les autres
créatures.
Les Athanasiens avaient
adopté une incohérence du Platonisme philosophique et l'ont appliqué à la
doctrine chrétienne. Ils n'ont en outre pas compris que l'essence divine,
“le Logos”,
était jadis centralement un attribut de Dieu, et que
l'entité Jésus-Christ n’existait pas. C'est à partir de Son Omniscience
qu'Eloah a voulu créer et à partir de Son Omnipotence qu'Il a parlé. Il a
parlé en utilisant Son essence divine, le Logos, et à partir de la
réplication ou de l'établissement du Logos en tant qu’entité distincte, Il a
commencé à créer comme un exercice de Sa volonté, d’où Apocalypse 4:11.
De l'union de l'esprit
émanant de Dieu, la communication du plan, et de là la connaissance, a été
diffusée et dévoilée. Le Logos a donc commencé la création avec la
connaissance proportionnelle à la volonté de Dieu. De cette émanation du
logos comme une entité la création de l'ordre spirituel a commencé. Comme il
s’est propagé à partir de la centralité d’Eloah, il s'ensuit que les ordres
les plus élevés de l'esprit étaient logiquement antérieurs aux simples
ultimes à partir desquels la création matérielle a été effectuée.
Maintenant, si ce processus
était diffus, il s'ensuit que le Logos, en tant que le Médiateur des Elohim,
était leur initiateur comme une fonction simultanée, puisqu’Eloah (d’après
les arguments d’Augustin ci-dessus) existait dans Sa perpétuité constante,
et c'est à partir du mouvement des Elohim que les temps ont commencé.
La position d'Athanase a
souligné la similitude ontologique entre le Père et le Fils. La divinité
essentielle du sauveur a assuré ce qu’il connaît et ce qu’il voit :
Rien du
Logos divin ou de la Sophia ne pourrait être perdu dans le processus du Fils
devenant incarné, parce que la nature divine, par définition, n’admet aucun
gain ou perte (ibid., p.13)
Lorsque les Ariens ont
plaidé pour un rédempteur qui a exercé la foi, Athanase a répliqué avec une
affirmation de l'immuabilité essentielle du Fils (en utilisant [analloiõtos]
et son verbe pour interpréter et contrôler le [pistos] d’Hébreux
3:2) :
Ainsi,
raisonnablement, l'apôtre, discourant au sujet de la présence corporelle de
la Parole, dit : un 'apôtre et fidèle à celui qui l'a fait', précisant que
même en devenant homme, 'Jésus Christ', 'le même hier, et aujourd'hui, et
pour toujours' (Hébreux 13:8) est immuable [hanalloiotos]. (ibid., p.
13)
Son immuabilité, pour
l’orthodoxe, l’a enlevé ontologiquement du domaine de choix moral et éthique
:
Si on permettait
au rédempteur de choisir entre deux options, ils ont imaginé, comment
quiconque pourrait être certain qu'il avait fait correctement le bon choix
face aux stratagèmes du diable et aux limitations de la vie humaine. Par
conséquent, dès le début de la polémique arienne, les Évêques alexandrins
ont pris l’immuabilité du Fils comme planche fixe dans leur plate-forme
contre Arius. (ibid., p. 13)
Cet argument est logiquement
absurde puisque cela implique nécessairement une limitation de l'Omniscience
qui va à l'encontre de leurs prémisses initiales et se répercute sur
d'autres domaines tels que la relativité de la nature divine.
Les Ariens ont inversement
souligné le choix moral libre du Fils et c'est la position qui découle de
l'exégèse scripturale. La position d'Arius sur le Logos a été rédigée dans
le Thalia comme suit :
Celui qui est
sans commencement [anarcos] a fait [etheke] le fils comme
commencement des créatures [tõn genetõn] (cf. Proverbes 8:22a). Et
après l’avoir fait il [l'] a fait progresser [etheke] comme un fils [eis
uion] pour lui-même. (ibid., p. 23)
Cette section dans Proverbes
se rapporte à la Sagesse où l’on peut lire au verset 22 :
“Le Seigneur m'a créé au commencement de son œuvre,
le premier de ses actes anciens”. Avant la
création du monde, la sagesse a été créée et était auprès de l'Éternel
“comme un maître d'œuvre et je faisais chaque jour
ses délices, me réjouissant toujours devant lui” (verset 30).
Le concept se réfère
ostensiblement à la Sagesse, mais Arius estime que ce passage doit se
référer au Logos et au Sans-Commencement. La raison est simple. La Sagesse
est un attribut subsidiaire de Dieu découlant de l'Omniscience. Si cela doit
être pris comme la création d'un attribut de Dieu, alors voici un exemple
d'autocréation, établissant ainsi la création absolue. Plus important
encore, cela affirme la création d'un attribut qui doit être instancié dans
l'Essence Divine si l’on ne veut pas qu’une série d'absurdités ontologiques
s’ensuivent. Dieu ne serait pas immuable, ni n’aurait-il procédé d'un plan
éternel, ou bien il s'agit d'un plan formé sans sagesse.
Le commentaire au verset 35
aurait évidemment été la clé pour Arius.
“Car celui qui me
trouve a trouvé la vie”, et obtient la faveur de YHVH. De ce fait, le Logos,
comme la personnification de la sagesse, a été le début de la création. La
sagesse est traditionnellement mentionnée dans la forme féminine dans le
monde antique. Son application dans Proverbes au féminin vise à établir
l'équilibre parfait entre la Sagesse et la Foi, entre l'homme et la femme,
demeurant dans le Logos et démontrant l'asexualité des Fils de Dieu.
3:4.3 Les Hommes et la Nature Divine
Le commentaire dans 2Pierre
1:4 des hommes devenant participants de la nature divine n'a pas été compris
par Athanase dans l'intention initiale. D’après Jean 1:12, “mais à tous ceux
qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir
Fils de Dieu.”
Arius avait compris que
l'homme, par la perfection et en participant à la nature divine, deviendrait
Dieu. Les Ariens/Eusébiens ont vu à partir des paroles de Dieu
“j'ai engendré et suscité des fils” qu'il y avait de multiples fils. Les Athanasiens
ont furieusement rétorqué comme Alexandre le souligne,
“et ils se sont rebellés contre moi”. Les rébellions ont eu lieu au ciel et sur la
terre.
Le destin de l'homme de
devenir des Fils de Dieu, en remplacement de l'armée déchue (ou un
complément, car ils n'ont pas encore été jugés), avait été partiellement
compris tout juste plus de cent ans auparavant par Irénée, qui savait que
les croyants ont été identifiés comme [theoi], et ceci est dérivé de
l’exégèse de l’Ancien et du Nouveau Testament. Irénée dit ceci :
Il n'y en a
aucun autre appelé Dieu par les écritures excepté le Père de tous et le
Fils, et ceux qui possèdent l'adoption. (ibid., p. 68)
Les Ariens ont vu que Jean
17:11
“qu'ils soient un comme nous sommes un” signifiait que l'unité que Christ partageait avec
Dieu était l'unité que les élus partageaient avec Dieu. L’homme a besoin de
l'esprit d'adoption pour atteindre la vie éternelle car à aucune entité ne
serait permise la vie éternelle sauf ceux en union avec Dieu en tant que
Fils de Dieu.
Pour les Athanasiens c'était
scandaleux car ils ne comprenaient pas le concept des Fils de Dieu. Ils
avaient adopté la doctrine de l'âme des Mystères et donc croyaient qu'ils
étaient éternels, vivant après la mort comme des esprits. Ils avaient
également rigidifié la Divinité dans une Trinité qui avait une relation
ontologique existante éternelle du Père et du Fils, une relation qu’Arius
considérait à juste titre comme absurde.
L'Essence Divine ou Logos
était, en outre, réduit à une personne, et l'Église primitive a considéré
absurde de prétendre qu'il n'était pas humain. Comme Christ croissait en
sagesse et en stature (Luc 2:52), il n'aurait pas pu être une manifestation
complète de l'essence divine. En outre, si l'esprit était une entité
distincte alors Christ, d’après Luc 1:35, ne pouvait pas être le Fils de
Dieu, mais était le Fils de l'Esprit Saint. Si Christ était la totalité de
l'essence alors il ne pouvait pas être séparé de l'esprit en tant que fils.
Le Logos, donc, faisait
également partie de l'essence divine émanant d’Eloah. Comme Christ était le
Logos ou essence divine, il s'ensuit que Christ était père de lui-même si
l'essence n'était pas en mesure de différenciation. L'ontologie doit donc
être que l'esprit émane de Dieu le Père ou Eloah. Il a créé et animé le
domaine spirituel et est capable de créer et d'animer les entités humaines.
Il procède à animer ces entités conformément à la volonté et la nature
d’Eloah. Il anime les Elohim en tant que fils de Dieu. Nous sommes appelés à
devenir des Elohim (Zacharie 12:8 ; Jean 10:34-35) et l'Écriture ne peut
être anéantie.
La structure sotériologique
athanasienne ou orthodoxe est aussi fondamentalement absurde dans la
séquence de l'âme - corps - âme - corps ressuscité - destruction ou âme.
Cela impute logiquement des motifs à Dieu qui attaquent sa nature. Les
incohérences émergent des arguments précédents et successifs.
3:5
Les Elohim et le Libre Arbitre
Si les Elohim en tant que
des êtres spirituels possèdent la nature de Dieu, et si l'argument avancé
par Athanase est cohérent (que la nature divine n'admet aucun gain ou
perte), il s'ensuit que Satan, comme une Étoile du Matin des Elohim, ne
pouvait pas pécher. Cette position est absurde. Augustin a tenté de résoudre
le problème en affirmant la création ex nihilo de sorte que seulement
quelque chose créé à partir de rien pouvait pécher en s’éloignant de Dieu.
Mais cela ne résout pas l'essence qui anime. Dieu ne peut pas pécher parce
qu'il ne veut pas pécher car c’est contraire à sa nature.
L'essence divine, en tant
que Logos, est un aspect de l'esprit de Dieu et, comme tel, transmet
nécessairement une connaissance du Bien et du Mal, sinon Dieu ne serait pas
Omniscient et donc serait également amoral. La Création et la Loi seraient
donc arbitraires, et ceci est absurde (de Russell ci-dessus).
La loi n'est pas
désincarnée, mais logiquement antérieure à la création de l'entité, dont les
concepts découlent de la nature de Dieu. Le Logos avait le libre arbitre de
pécher, mais n’a simplement pas voulu le faire tout juste comme Eloah ne
veut pas pécher et les Étoiles du Matin ne veulent pas pécher. Christ n'est
donc pas une créature gratifiée mais un coexistant humain et spirituel. Il a
grandi en sagesse et en stature et est mort parce qu'il s'est vidé de sa
spiritualité à ce moment-là.
Le concept d'effacer le
péché spirituel par le sacrifice sans péché était un accomplissement de la
prophétie, ou en d'autres termes, du plan de la rédemption. La vue
sotériologique de l'expulsion du mal apparaît ci-dessous.
Initialement Azazel par
orgueil a voulu pécher et se révolta contre le Très-Haut, tentant d'usurper
sa fonction. La Bible déclare que, par la subtilité, il a trompé un tiers de
l’armée et a déclenché une guerre dans les cieux qui persiste encore. Il est
cependant actuellement limité à cette planète et, d’après l'Apocalypse, il
cessera de régner au retour du Messie. Les traditions d'une bataille astrale
sont très répandues dans l'histoire. Elles se produisent dans Juges 5:20
; Ésaïe 14:12 ; Daniel 8:10 ; dans Sénèque, Consolatio ad Marcium
26:6 ; Hercules Furens 944-52; Nonnus, Dionysiaca 38,347-409, et dans
les Oracles Sibyllins 5:212.
Pourquoi alors Azazel ou
Satan est-il autorisé à influencer l'humanité ? Comment expliquons-nous le
mal ? Est-ce que Dieu le permet ou n'est-il pas omnipotent ? N'avait-il pas
prévu cela ou n'est-il pas omniscient ?
3:6 Le Panthéisme versus le Monothéisme Transcendant
3:6.1
Les Fils de Dieu et un Argument de Continuité
Harnack, dans son Histoire
des Dogmes (tr. anglaise Vol IV), au début de son chapitre sur l'Arianisme,
a posé ces questions sur la Philosophie de cette religion :
Est-ce que le
Divin qui est apparu sur la terre et qui a fait sentir sa présence
activement est identique au Divin suprême qui gouverne le ciel et la terre ?
Est-ce que le Divin qui est apparu sur la terre est entré dans une union
étroite et permanente avec la nature humaine, de sorte qu'il l’a
effectivement transfiguré et soulevé au plan de l'éternel ?
Foakes-Jackson, dans son
article sur l'Arianisme (E.R.E., Vol. 1, p .786), attire l'attention sur ces
points de Harnack et déclare :
“L'Arianisme a
déclaré que Dieu est inconnaissable et que le Fils complètement détaché de
Lui”. Il déclare aussi :
Si Jésus-Christ
a existé de toute éternité, et est à la Tête d'un Royaume qui n'aura pas de
fin, si en effet il doit être adoré comme Dieu, alors la doctrine de Nicée
est vraie, et il est de même substance que le Père. (ibid.)
Ces commentaires de ce qui
précède sont des fausses déclarations qui pourraient au mieux n’être que
partiellement vraies.
Les commentaires sur la
philosophie arienne ont été faits par les historiens athanasiens et sont
souvent tout simplement faux. Ceux de Bright (DCB i 197) cités par
Foakes-Jackson sont faux. Il dit :
En 360 après
J.-C., le Parti Arien "se trouvait dans une position trop clairement
artificielle pour être permanente" et à la mort de Constance le 3 nov. 361,
a révélé sa faiblesse inhérente. Rome et l'Occident sont immédiatement
retournés à l'adhésion à la foi de Nicée, comme si le conseil de Rimini ne
s’était jamais assemblé. (ibid., p. 780)
Le fait est que les
Athanasiens n’ont jamais eu le contrôle de Rome sur aucune base permanente
jusqu'à ce qu'ils prennent le contrôle au Concile de Constantinople en 381
[EC] avec le soutien militaire de Théodose lui-même, le premier empereur
athanasien.
Les Lombards étaient
entièrement Unitariens (appelés Ariens) jusqu'à la fin du sixième siècle
“et même à l’époque de saint Grégoire le Grand,
Autharis, leur roi, interdisait à tous ses Lombards de donner à leurs
enfants le baptême catholique.” Ce n’est qu’à sa mort que son épouse, née
catholique, qui est restée la reine des Lombards, lors de son remariage au
Duc Agilulf, a réussi à introduire le Catholicisme (ibid., p. 784).
La question, bien qu’elle en
soit une de logique erronée au sein du clergé, était simple dans l'esprit
des laïcs : le Monothéisme versus le Polythéisme. Selon Grégoire de Tours
(IX 15) les Wisigoths ont été soumis à une dispute arrangée entre les
concepts en 587 [EC], organisée par Reccared le fils de Léovigild qui s'est
déclaré catholique après ce différend lors de son ascension. Il a dirigé le
Célèbre Troisième Concile de Tolède en 589 [EC]
“au cours duquel
67 évêques et seulement cinq nobles étaient présents.” (ibid.)
Vingt-trois anathèmes ont
été prononcés contre l'Arianisme. Présentant un intérêt pour l'argumentation
ci-dessus, on peut citer : le troisième, qui déclare la procession du
Saint-Esprit du Père et du Fils, le septième, contre ceux qui soutiennent
que le fils est ignorant de quoi que ce soit, et le neuvième, contre le fait
de déclarer que le fils dans sa Divinité n’était jamais visible. Le seizième
condamnait le Synode arien de Tolède de 581 [EC] (ibid.)
Les septième et neuvième
anathèmes étaient nécessaires pour contrebalancer la logique erronée des
trinitaires.
Le septième devait
contrebalancer la déclaration de Christ lui-même qu'il ne savait pas quand
il reviendrait, une question que seul Eloah (Ho Theos ; ou ton Theon) le
Père savait. Ainsi Christ n'était pas omniscient et logiquement ne pouvait
pas être Dieu, mais était plutôt une entité subordonnée portant le nom de
Dieu comme Theos et Logos, comme il a porté le titre Elohim et YHVH en tant
que l'Ange de la Rédemption dans l'Ancien Testament.
Le neuvième était nécessaire
car l'entité de l'Ancien Testament était un Elohim qui est devenu visible et
a lutté avec Jacob, appelant du nom d'Israël. Jacob a nommé le lieu Peniel,
“car, dit-il, j'ai vu Dieu (Elohim) face à face et
mon âme a été sauvée.”
Cet Elohim est cependant
clairement identifié comme l'Ange de la Rédemption ou l'Ange de YHVH,
portant le nom de YHVH ou Elohim comme une entité subalterne. Jean dit
clairement au chapitre 1:18 qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu (Theon), mais
que Theos l’a déclaré. À partir de ces points, la Christologie athanasienne
de la Trinité ne pouvait logiquement pas se tenir debout, et tout
universitaire avec une connaissance de l'Ancien et du Nouveau Testament en
hébreu et en grec, comme ils étaient alors écrits (ainsi qu’en latin et
gothique), aurait vu l’absurdité de sa position.
Le fait qu'ils ont
effectivement exposé l'illogisme de la position athanasienne est attesté par
la nécessité des anathèmes. La structure entière du Trinitarisme athanasien
repose sur une absurdité logique impliquant de fausses prémisses et des
erreurs de traduction.
À partir du Concile et des
points ci-dessus, il est évident que l'Unitarisme (soi-disant l'Arianisme)
était une force très importante. Ils n’ont été vraiment convertis que par
les conquêtes des Francs saliens qui systématiquement ont étouffé le débat.
Par la force, ils ont converti les Goths, les Vandales, les Hérules, les
Teutons, les Burgondes et les Lombards sur une base progressive. Les
Britanniques ont été convertis en vertu d'un accord conclu à Whitby en 664
[EC] sous la menace de la force des Anglo-Saxons, après la conversion de ces
derniers en 597 [EC]. (Stephen Neill, Anglicanism, Pelican, London,
1965) (cf. aussi Cox,
Les Guerres Unitariennes/Trinitaires (No. 268), CCG, 1998,2000).
La controverse a été
observée en termes simples par ces tribus, telle qu’énoncée par l'un des
Rois ariens, Gundobald le Burgonde, qui a refusé
“d'adorer trois Dieux” (ibid., p.
782). Cette définition essentielle était la racine du problème et la faction
athanasienne était si pressée par le rejet des laïcs qu'ils ont été forcés
de modifier les notions de la Divinité. Foakes-Jackson a admis l'erreur de
ses notions antérieures (exprimées dans
Cambridge
Theological Essays, p. 500) sur l'infériorité
de la Théologie Arienne des
“Barbares”. Il a affirmé plus tard que
“l’Arianisme des Wisigoths, Lombards, Vandales, etc.
n'était rien d’autre qu’une phase dans la lutte ecclésiastique entre les
conceptions teutonne et romaine du Christianisme.” (ibid., p.
783).
Bethune-Baker devait dire
des modifications requises aux notions athanasiennes de la Divinité :
D’ici le 4ème
siècle, il devenait évident que la seule solution du problème se trouvait
dans une distinction à l'intérieur de l'unité divine ; Il était nécessaire
de réviser l'idée de la personnalité divine et de reconnaître non pas trois
personnes, mais trois aspects éternels du Divin. (Chr Docto, p. 157)
(Cela a été fait en faisant une distinction entre ousia et
upostasis) (ibid., p. 780)
Les questions philosophiques
qui se posent ici sont importantes. Le concept de la dualité et de la
trinité soulève des questions et des distinctions entre le monothéisme, le
polythéisme, et le monisme. Elles peuvent être traitées en examinant
certaines prémisses des Sorites, et en les réarrangeant sous la forme d’un
argument de continuité. L'article de M. F. Burnyeat intitulé
“Dieux et Tas” dans
Language & Logos: Studies in Ancient Greek
Philosophy (éd. par Malcolm Schofield
et Martha Nussbaum, Cambridge University Press, 1983) est utile pour
examiner la question.
En examinant un panthéon,
nous nous heurtons à la structure antérieure stoïcienne sorite dont les
Athanasiens et les Ariens étaient conscients. En répondant à combien de
Dieux sont requis pour faire un panthéon, nous voyons que d’après
Diogène Laërce :
Il est faux que
deux, c’est peu, et que trois, ça ne l’est pas également. Il est faux que
ces derniers sont peu et que quatre, ça ne l’est pas également (et ainsi
jusqu'à dix mille). Mais deux, c’est peu. Donc dix mille, ça l’est aussi.
(DL, VII 82).
Les arguments, comme
Burnyeat le souligne, sont que les prémisses intermédiaires sont exposées
non pas comme une série de conditionnels,
“qui est la
pratique habituelle ancienne, mais comme une série de conjonctions niées de
la forme ‘pas l’un ou l’autre p et pas q’” (Burnyeat, p.
321).
Le premier indémontrable
stoïcien (Modus Ponens), par l'application répétée, refonte l'argument en un
argument qui peut être analysé par l'application répétée du troisième
indémontrable plus la double négation. Burnyeat affirme que
“pour l'instant, il préconise plutôt l'interprétation
de Philon du Conditionnel, selon laquelle ‘si p alors q’ est vrai si et
seulement si ce n'est pas le cas que ‘p’ est vrai et ‘q’ est faux ; dans nos
termes, il nous dit de prendre les prémisses comme des implications
matérielles.” Sans l'intuitionnisme moderne, l'argument
peut être simpliste.
Les arguments dualistes et
trinitaires reposaient sur la prémisse que deux Dieux c’est peu pour un
panthéon, ce qui est une notion implicitement quantitative. Burnyeat affirme
que le Stoïcien, dans ce contexte, n'était pas plus avancé que l'Empirique.
Il prétend toutefois que
La différence
entre le Stoïcien et l'Empirique est que le premier nie ce que le dernier
permet, à savoir que l'analyse quantitative de ces notions fournit un
support conceptuel pour les prémisses du Sorite. Telle est l’affirmation
simplifiée par le rejet du Conditionnel de Sunartesis en faveur de celui de
Philon. Ou pour le dire autrement, le Stoïcien n’admet pas que trois c’est
peu parce que deux c’est peu. (ibid., p. 323)
[La lecture dite Sunartesis
(connexion ou cohésion) du conditionnel, selon laquelle ‘si p alors q’ est
vrai si et seulement si ‘p’ et ‘pas q’ sont incompatibles, est dérivée de
Cic.Fat. 11-16, tel que discuté par Burnyeat, op. cit.]
Par conséquent, la logique
stoïcienne n'accepte pas qu'il y ait des pressions conceptuelles ou
sémantiques sur nous pour accepter les prémisses d'un Sorite, refusant
“pour les cas mêmes où l'idée est la plus
convaincante, en raison de la nature manifestement quantitative des
prédicats impliqués.” (ibid., p. 324).
Du livre de Chrysippe (D. L.
VII 192, 197),
“Les Arguments Sorites contre
les Mots,” il semble que
“au moins
quelques arguments sorites sont considérés comme attaquant la langue ; en
termes modernes, ils visent à montrer que certains prédicats sont
incohérents.” (ibid.) En outre,
Dans la mesure
où l'on en juge par la définition de F, il ne peut y avoir de F. Par
conséquent, dans la mesure où Chrysippe est un critique des Sorites, dans
cette mesure il défend notre langue contre les Sorites, dans cette mesure,
il défend notre langue contre l’intention d’Eublides.
Dans la mesure où il
réussit, il n'y a rien de mal avec le Panthéon prédicat (dans ce cas), et il
serait faux de prétendre une validité conceptuelle pour les prémisses
proposées plus tôt.
Cicéron a attaqué cette
forme de Logique Stoïcienne, en disant :
“La nature des
choses ne nous a donné aucune connaissance des limites de sorte que nous
puissions déterminer en tout cas jusqu'où il faut aller, nous ne pouvons en
aucun cas dire combien il faut ajouter ou retrancher pour que nous puissions
répondre avec certitude.” (Acad. 11 92).
Il résulte de l'argument de
la continuité résultant d'un réajustement de la prémisse sorite que si le
Fils est admis comme Dieu absolu identique au Père, alors il n'y a aucune
raison logique valable pour ne pas supposer que les Étoiles du Matin et tous
les élus sont également de manière admissible inclus dans le terme ‘Dieu’
sans être conceptuellement panthéistes ou polythéistes. Les implications de
Logique Stoïcienne étaient évidentes à Arius et Athanase et la controverse
tournait souvent autour de la réfutation de certaines prémisses ou de
l’adoption des positions accusatives. En ce sens, Cicéron a utilisé la
Logique pour la retourner contre elle-même et démontrer l'incapacité de
notre raison de montrer ce qui est vrai et ce qui est faux (Acad. 11
93 init ; cf. 95 init ; suivant Burnyeat p. 325).
La fixation des frontières
est problématique dans le cas du Panthéon. Burnyeat utilise l’argument du
2ème siècle [AEC] sur les Dieux, mis en avant par l’académicien Carnéade
sous forme de Sorites (Soritikos),
“Ainsi Sextus Empiricus l’introduit (M IX 182 ;
Sorites 190) et Sextus fait appel à l'ami et successeur éventuel de
Carnéade, Clitomaque.” (ibid., p. 326)
L'argument cité de Sextus
est comme suit :
Si Zeus est un
Dieu, Poséidon est aussi un Dieu : Frères, trois étions nous, tous les
enfants de Cronos et de Rhéa, Zeus, Moi-même et Hadès, le troisième ayant
les Ombres pour son royaume. Toutes choses ont été partagées en trois, et
chacun a eu sa part de gloire. De sorte que si Zeus est un Dieu, Poséidon
aussi, étant son frère, sera un Dieu. Et si Poséidon est un Dieu, Achelus
aussi sera un Dieu, et si Achelus, Neilos, et si Neilos, chaque rivière
aussi, et si chaque rivière, les cours d’eau également seront des Dieux, et
si les cours d'eau, les forêts : mais les forêts ne sont pas des Dieux,
alors Zeus n’est pas non plus un Dieu. Mais s'il y avait eu des Dieux, Zeus
aurait été un Dieu. Par conséquent, il n'y a pas de Dieux. En outre, si le
soleil est Dieu, le jour sera également Dieu, car le jour n'est rien d'autre
que le soleil au-dessus de la terre. Et si le jour est Dieu, le mois aussi
sera Dieu. Et si le mois est Dieu, l'année aussi sera Dieu, car l'année est
un composite constitué de mois, car c’est un composite constitué de jours.
Mais ce n'est
pas <vrai>, alors la supposition originale ne l’est pas non plus. Et puis
ils disent, il est absurde de déclarer que le jour est Dieu, mais pas
l'aube, le midi et le soir. (M ix 182-4, tr Bury de Burnyeat, op. cit.).
Burnyeat souligne que les
conditionnels dans les arguments d’Eubulide s'accumulent automatiquement,
l'un après l'autre, en vertu du principe général. Carnéade semble construire
pas à pas son argumentation et Cicéron mélange les conditionnels et les
questions, démontrant la technique probable, mais Burnyeat soutient que
Sextus nous montre comment tout cela s'additionne. Les conditionnels
successifs ne découlent pas d'un principe général unique, mais de motifs
justificatifs que Carnéade devait fournir, et la justification dite ou
suggérée varie dans l'argument.
Pourquoi Poséidon est-il un
dieu si Zeus est un dieu ? Parce que nous avons dans l'autorité inattaquable
d'Homère qu'ils sont frères. Pourquoi Acheloüs est-il un dieu si Poséidon
l’est ? Parce qu'ils sont tous les deux des masses d'eau. (Poséidon la mer ;
Acheloüs un grand fleuve en Étolie). Pourquoi le Nil est-il un dieu si
Acheloüs l’est ? Parce qu'ils sont tous les deux des fleuves, et ainsi de
suite. Les principes généraux sont indiqués ou implicites. Chaque rivière
est un dieu, tous les enfants de Cronos et de Rhéa sont des Dieux. Mais pas
un seul principe nous permet d'aller jusqu'au bout de l'argumentation.
(ibid., p. 228)
Burnyeat donne ici
l'analogie la plus utile.
Si X mérite un
traitement T et que Y ne diffère pas sensiblement de X dans les
caractéristiques pertinentes pour mériter T, alors Y mérite T.
Il ne
pense pas que ce
soit une objection à cette formulation qu'il puisse y avoir une série de
chevauchement des caractéristiques, F1, F2, Fn tels que (i) si on nous
demande pourquoi X mérite T (pourquoi X est un dieu, une personne, un
indigent) la première chose que l'on peut mentionner est F1 (X est un fils
de Cronos et de Rhéa), mais (ii) ce qui persuade quelqu’un que Y mérite
aussi T est une ressemblance entre X et Y à l'égard de F2 (ibid., pp.
328-9).
Pour Burnyeat, les deuxième
et troisième réflexions comptent autant, et parfois plus, que les premières.
“Il est illusoire de penser qu'on puisse dire
d'emblée exactement pourquoi X mérite T, et il peut être illusoire de croire
qu'on puisse jamais le dire avec certitude. Car il se peut que ce qui frappe
quelqu’un à propos de X et encore à propos de Y, comme pertinent pour qu’il
mérite T, soit quelque chose qui subit un changement quand quelqu'un
présente un nouveau cas à côté de l’ancien” (ibid.).
À partir de là, nous pouvons
maintenant examiner la nature de la Divinité biblique et la validité du
Panthéisme ou du Polythéisme. D'après notre analyse précédente, il est
évident que la structure de l'esprit est une Divinité étendue composée de
divinités subordonnées à la volonté d'Eloah. La position a été atteinte où
l'on doit être contraint de rejeter l’explication athanasienne de la Trinité
et la structure de l'esprit en faveur d'une explication où les deuxième,
troisième, quatrième et entités suivantes sont limitées en puissance et
connaissance ; donc non seulement il n'y a rien en principe qui s’oppose à
ce que la Divinité soit étendue pour inclure les Elohim et, par adoption,
les humains, mais nous sommes logiquement contraints par la structure et le
récit de suivre une telle approche cohérente. Les différends
athanasiens/ariens sont fondamentaux pour une bonne compréhension de cette
position triune.
3:6.2
L'Union de l'Esprit Saint
À partir des commentaires de
Foakes-Jackson sur l'Arianisme ci-dessus au début de 3:6.1, on peut voir que
les perceptions des groupes ariens et athanasiens étaient erronées. Les
Ariens, si Foakes-Jackson doit être accepté, commettent une erreur dans
l'affirmation que le fils était complètement détaché d’Eloah, le Père, et
les Athanasiens commettent une erreur dans leur interprétation erronée de la
structure ontologique de la Divinité et sa limitation au système triune.
Nous avons vu que deux ou
plusieurs entités peuvent exister sans assumer les caractéristiques d'une
structure quantitative, c'est à dire un Panthéon, et de même que de
Multiples Déités sont Panthéistes/Polythéistes.
La différence réside dans la
structure de l'analyse de Burnyeat. Dieu est Un, l'existence de plusieurs
entités est assurée du facteur qualitatif, Dieux nominaux, en étant d'une
même substance avec l'entité centrale Dieu, c'est à dire étant de même
substance que le Père. Pour Christ, il s’agissait d'une complexité non
accordée à l'homme jusqu'à la Pentecôte et alors seulement sur une base
relative, bien que Melchisédek fût un fac-similé ou une copie du Fils de
Dieu (de [aphõmoiõmenos] ; Hébreux 7:3).
(Voir
The New Thayer’s Greek-English Lexicon, entrée 871, pp. 89-90.) (cf. Cox,
Melchisédek (No. 128), CCG, 1995, 1998).
La perfection voit Dieu
comme
“tout en tous”, et l'espèce
humaine a progressé en vertu de l'essence de Dieu, appelée l’Esprit Saint,
dans une famille de Fils de Dieu, avec l’Armée Céleste, où la structure
multiple existe comme une structure unique
“étant en forme
de Dieu, mais ne cherchant pas à saisir l'égalité avec Dieu” (Voir
Expositor’s
Greek Tesatament). L’Elohim du groupe
d'origine humaine des Bene Elohim est Christ comme le ... kurios ou
contrôleur, le chef ou roi (traduit par Seigneur) ou le ... despotes,
le dirigeant absolu.
Le concept des esprits
individuels qui ne sont pas en unité sous la volonté d'une seule entité doit
finalement être polythéiste. La doctrine de l'âme doit donc être une
doctrine du polythéisme, car elle permet une structure éternelle de l'esprit
qui n’est pas en union avec le noyau et qui a été créée ex nihilo, n’étant
pas en possession de la nature de Dieu. C'est ainsi que deux ou plusieurs
entités qui possèdent des volontés non subordonnées doivent être panthéistes
(comme Monisme illusoire) ou polythéistes.
La structure originelle des
Fils de Dieu a permis l'exercice de la volonté. Azazel et une partie de
l’armée ont choisi d'exercer ce pouvoir en s'élevant au-dessus de la volonté
du Très-Haut, établissant une structure qui doit finalement et logiquement
être source de division et donc polythéiste. Le fait qu'ils avaient ce
pouvoir était un prolongement nécessaire de la connaissance du bien et du
mal inhérente à l'essence divine. La destruction des esprits semble plutôt
davantage impliquée que la simple mort d'une structure matérielle. La
résurrection humaine n'est pas la réunification d'une essence spirituelle et
physique, mais plutôt la restauration d'un ideatum de l'idée dans l'esprit
de Dieu. La doctrine de l'âme n'est pas nécessaire, et ontologiquement elle
et le Dualisme Cartésien doivent être soit polythéistes soit un monisme
illusoire.
Comme expliqué précédemment,
le Dualisme Cartésien prévoit la création d'une âme individuelle, qui a la
capacité des extrêmes du bien et du mal jusqu’au niveau du mal impénitent.
La création d'une entité éternelle, qui soit logiquement polythéiste en
étant inextricablement externe à la volonté de Dieu, est philosophiquement
peu pratique. Cela conteste en outre la nature de Dieu en créant une
structure plus complexe nécessitant un processus plus complexe de
destruction.
Si l'âme éternelle peut être
traitée à l'état spirituel final, alors l'état intermédiaire est une
absurdité logique et Dieu est de nouveau attaqué. Si la structure de l'âme
coexiste avec le mal, alors la structure du mal est incohérente et attaque
nécessairement l’omnipotence de Dieu, en ce que les divisions au sein de la
structure de la Divinité et de la Famille de Dieu sont intégrées, instituant
une division et un conflit qui sont logiquement opposés à l’unité.
La poursuite de l’existence
de l'Armée Déchue plaide contre un tel concept de l'âme en vue de tout ce
qui est contenu ici. Azazel et l'armée déchue n'ont pas perdu leur entité
d'être quand ils ont choisi de se rebeller, mais ils ont été limités en
puissance. À partir de la proposition d'Einstein selon laquelle l'espace, le
temps, la gravité, la matière et l'énergie sont des expressions équivalentes
d'une seule essence fondamentale, il s'ensuit que la réduction de la
puissance dans tous les aspects de l'énergie ou de la région implique
nécessairement une réduction du temps. Limiter le temps d'Azazel limite
nécessairement son pouvoir.
3:6.3
Satan et le Panthéisme
La question qui est
métaphysiquement la plus déroutante pour l'espèce humaine est : pourquoi
Azazel et l'armée déchue n’ont-ils pas été détruits avant la création de la
nouvelle armée de remplacement ? Nous savons par la Bible qu’Azazel a été
jugé. Dans Jean 16:1-11, Christ dit que le Consolateur viendra et convaincra
le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
“Le jugement, parce que le prince de ce monde a été
jugé.” (v.11)
Le Consolateur ne parle pas
de lui-même mais relaie les concepts de la Divinité. Le concept de
“prend de ce qui est à moi (Christ) et il vous
l’annoncera” indique la division ou la canalisation de
contrôle. Il apparaît donc que l'esprit est une entité de diffusion qui lie
les Bene Elohim à leur Elohim ou Étoile du Matin et de là, à Eloah ou Dieu
le Père.
L'Armée Déchue n’est pas
encore jugée, mais doit être jugée par les élus en tant que leurs
contemporains, i.e. les Fils de Dieu, mais dans leur cas, ceux d'origine
terrestre. (Dans 1Corinthiens 6:2-3 les saints jugeront le monde et les
anges, se référant ici à l'armée déchue).
Si Satan a été jugé et le
jugement de l’armée est réservé, il s'ensuit qu'il n'y a pas eu de
condamnation. Il en résulte en outre que la miséricorde à la repentance doit
également pouvoir être étendue à l’armée. Le problème du mal est complexe et
est traité plus complètement dans Le Problème du Mal. La raison de permettre
l'existence du mal est cependant relativement plus simple et pourrait être
énoncée comme suit.
Si une capacité de libre
arbitre existe, alors la capacité de pécher existe aussi. Si une entité
exerçant un tel libre arbitre le fait par la volonté et veut pécher,
l'entité alors se détache de la famille de Dieu ou de l'Union de l'Esprit.
Comme les volontés opposées constituent par conséquent un panthéon d'entités
polythéistes et entraînent la perturbation du fonctionnement ordonné
induisant le chaos, alors les entités perturbatrices doivent être éliminées,
faute de quoi la réalisation d'un plan parfait éternel par un Dieu
omniscient et omnipotent est contestée. Dieu n’est donc, par le Polythéisme,
ni omnipotent ni omniscient et ne peut donc pas permettre des structures
poly/panthéistes.
La permission à court terme
d'une structure rebelle et donc poly/panthéiste doit être de telle sorte
qu’un exemple ou processus de croissance dans le plan immuable à long terme
de Dieu puisse être donné.
La rébellion doit donc avoir
été attendue et autorisée. L'espèce humaine doit nécessairement avoir été
exposée aux effets de la rébellion, sinon celle-ci ne deviendrait qu’un
mythe de l’armée pré-adamique, d'où l’Armée adamique serait ouverte aux
mêmes tentations mais, sans la connaissance des conséquences, pècherait
probablement.
De même, ceux qui sont
justes à leurs propres yeux, comme Job l’était, seraient plus enclin à
l'orgueil et l'élévation de soi à la position du Très-Haut, non contents de
rester Elohim ou des Fils de Dieu. L’Armée ne pouvait voir l'ampleur des
maux du système de concurrence, si elle n’en voyait pas l'effet sur les
créatures.
L’interférence avec la
création et les résultats de la guerre ont donné lieu à ce que la terre
devienne sans forme et vide, i.e. devienne tohuw et bohuw.
Mais Ésaïe dit que le
Seigneur n'a pas créé la terre en vain. Jérémie dit que la terre redeviendra
sans forme et vide, (ou dévastée et déserte), i.e. ... tohuw et ...
bohuw (Jérémie 4:23). Le concept est déserté et vide ou
désolé/chaotique. Pourtant, Jérémie dit que le Seigneur ne fera pas une
entière destruction la prochaine fois (4:27).
Les habitants de la planète
se détruiront presque sous la domination de Satan, et Dieu permettra cette
destruction comme un processus d'apprentissage. Selon le récit biblique,
aucune chair ne serait laissée en vie s'Il n’intervenait pas, mais Il va le
faire
“pour l'amour des élus”,
en d'autres termes, pour accomplir Son dessein et
Son plan comme un processus d'unification de la famille de Dieu.
Après cela, les rebelles et
impénitents seront jugés et détruits. Le schéma biblique est tout à fait
différent de tout ce qui est compris par n’importe lequel système sur la
planète à cette date.
La structure ontologique et
philosophique est totalement incomprise et a été totalement syncrétisée par
les sectes chrétiennes traditionnelles. Les systèmes animistes religieux
primitifs qui découlent de la religion chaldéenne et plus tard du Chamanisme
animiste ont créé une séquence de structures polythéiste/panthéiste, moniste
et pseudo-monothéiste qui sont aussi incohérentes.
Chapitre 4
La Création Matérielle
4:1 La Création
de l'Homme
Une des plus grandes responsabilités à l’argument de la création est
celle des soi-disant fondamentalistes bibliques qui affirment rigidement et
dogmatiquement une création en l’année 4004 avant J.-C. (basée sur la
reconstruction d’Ussher de la chronologie
‘reçue’) ou à une date à peu près similaire en dépit de toutes les preuves
contraires et indépendamment des mots et de la logique du récit de la
Genèse.
Les dates à partir d'Adam menant jusqu’à l’ère Chrétienne varient entre
la chronologie juive de 3483 années, étant la plus courte, à la chronologie
étendue construite par la direction d'Alphonso de Castille à 6984 années
(voir le Dictionnaire
ASV Bible Dictionary. p.18). Voici un tableau de la période allant d'Adam au déluge provenant
des quatre sources anciennes :
ÂGE À LA
NAISSANCE DU FILS AÎNÉ
|
|
HÉBREU
|
LXX
|
SAMARITAINE
|
JOSEPHUS
|
|
ADAM
|
130
|
230
|
130
|
230
|
|
SETH
|
105
|
205
|
105
|
205
|
|
ENOSCH
|
90
|
190
|
90
|
190
|
|
KÉNAN
|
70
|
170
|
70
|
170
|
|
MAHALALEEL
|
65
|
165
|
65
|
165
|
|
JÉRED
|
162
|
162
|
62
|
162
|
|
HÉNOC
|
65
|
165
|
65
|
165
|
|
METUSCHÉLAH
|
187
|
167
|
67
|
187
|
|
LÉMEC
|
182
|
188
|
53
|
182
|
|
NOÉ (au Déluge)
|
600
|
600
|
600
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
DÉLUGE (Anno Mundi)
|
1656
|
2242
|
1307
|
2256
|
Quel que soit le laps de temps correct, aucun
récit de chronologie ne rend compte de l'existence des plus anciennes
espèces humaines démontrées par la technologie actuelle, et c'est une
question que la théologie philosophique ne peut pas éviter.
Qu'il y eût une création pré-adamique paraît indéniable. L'affirmation,
cependant, que cela est contraire à la narration biblique ne résiste pas à
l'examen. Une des erreurs les plus fondamentales des théologiens était celle
de Genèse chapitre 1, versets 1-2 :
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe
et vide ; et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu
se mouvait (ou planait) sur la face de l'eau. (Version
American Standard Version de la Bible).
Le terme
"était informe et vide" ne désigne pas une condition de la création, mais plutôt un état de
destruction. La terre est devenue
tohuw et bohuw, ou dévastée et
chaotique ; elle n'a pas été créée de cette façon (cf. Ésaïe 45:18).
Les créationnistes sans réelle compréhension, par conséquent, ont
commencé l'horloge de la terre à partir de 4004 [AEC], contrairement à tous
les éléments de preuve qu'ils possédaient déjà à l'époque. Autrement dit, la
terre a existé depuis plusieurs millions d'années. Les dinosaures ont vécu
dans une relative stabilité pendant 135 à 165 millions d’années avant de
disparaître soudainement. Les primates sont apparus sur la planète il y a
plusieurs millions d’années et, il y a environ 12 millions d’années, ils ont
pratiquement disparu avec seulement quelques survivants. Il y a relativement
peu de temps, une toute nouvelle série d'espèces de primates est apparue,
apparemment sans lien avec l'ancienne. Plus récemment, des espèces
humanoïdes sont apparues et ont disparu au milieu de la destruction massive
des espèces de la planète. Dans tout le nord de la Russie et de l'Alaska des
fosses de mammouths, de bisons et des espèces éteintes d'herbivores et de
carnivores sont communes. Les catastrophistes tels que Velikovsky et
Dankenbring affirment que le monde a été renversé pour provoquer des
catastrophes sur des périodes successives. La Bible elle-même affirme que le
monde a été bouleversé et que ceci a plus tard été rendu comme une
déformation de sa surface (voir ci-dessus).
Quels que soient les avantages et les inconvénients de ces arguments,
nous sommes plus préoccupés par les explications d'une telle existence et de
ces modifications qui sont conformes à la raison ou qui ne sont pas
clairement absurdes.
Le récit de la Genèse est une histoire de recréation, pas l'histoire de
la création entière. L'écart entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2 est des millions
et des millions d'années. L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux,
car il y avait eu une destruction de proportions énormes.
À partir des récits géologiques, nous nous retrouvons avec un certain
nombre de questions :
1. Si Dieu est immuable et crée à partir d'un plan immuable et éternel,
alors soit il ;
a : a planifié les destructions sur une base répétitive ; soit
b : Son Elohim délégué, ou Étoile du Matin de la terre, a créé et détruit
contrairement à Son plan ; soit
c : Son Étoile du Matin oint de la Terre a interféré avec la création
forçant la création répétitive.
2. Comme les créations concernent plus d'une forme d'humanoïde, c'est-à-dire
le Neandertal, le Cro-Magnon, et nous-mêmes, les explications doivent
impliquer une source créatrice externe à Dieu. À partir des arguments sur le
lien de causalité et la création, Dieu crée à partir d'une conception
immuable et éternelle, et de là Il ne peut pas expérimenter. Si Dieu
expérimentait alors il n'y a aucune raison de supposer que les espèces ne
peuvent pas être éliminées par accident, fantaisie ou caprice parce qu’elles
sont défectueuses comme les espèces précédentes semblent l’avoir été. Du
fait de Son omnipotence et omniscience, Il ne ferait pas un produit
défectueux.
3. De par Son omniscience, Il aurait connu le résultat de chaque
événement et l'ingérence dans chaque action. Il est par conséquent soit non
omniscient soit non omnipotent, ou bien Il a permis l'action pour un autre
but de Son plan.
Mais on a rendu témoignage en disant :
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?
Ou le fils de l'homme pour que tu le visites ?
Tu l'as fait un peu inférieur aux anges
Tu l’as couronné de gloire et d'honneur
Et tu l’as établi sur les œuvres de tes mains.
(Hébreux 2:6-7)
L'auteur de l’épître aux Hébreux citait Psaume 8:4 et suivants où les
choses mises sous Son assujettissement sont les créatures de la terre, la
mer et l'air : en d'autres termes, cette planète ; et d’après Hébreux 2:5,
nous voyons que la terre n'a pas été créée pour que les anges la dirigent,
mais plutôt l'homme sous le Fils de l'Homme en tant que [les] Fils de Dieu.
Le mot traduit par anges à Hébreux 2:6 est le mot grec standard
("((,8@H) aggelos, ou ange pour
messager de Dieu. Ce mot cependant traduit le mot hébreu dans le Psaume 8:5
pour Dieux, les Elohim. Selon Clément d'Alexandrie (Eusebius, Hist.VI.14.4),
Paul a écrit [l’épître aux] Hébreux en hébreu et Luc l’a traduit en grec.
Bien qu’Origène affirme que les idées sont Pauliniennes, l'expression et le
style proviennent de quelqu'un d'autre. "Celui qui a réellement écrit la
lettre est connu de Dieu seul."
(Eusebius Hist. VI.25). Tertullien (De Pudicitia 20) préconise
Barnabas comme l'auteur. Ceci est mentionné par le Dictionnaire
The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol. 2, p. 572, qui stipule qu'il existe un
commun accord que Paul n'a pas écrit l'Épître et que [l’épître aux] Hébreux
n'a été acceptée dans la Bible qu’après qu'Athanase l'a mentionnée dans sa
39ème lettre d’Easter/Pâques et son acceptation par Augustin.
[L’épître aux] Hébreux a cependant été considérée comme Paulinienne jusqu'à
la Réforme quand elle a été contestée par Erasmus. Le Concile de Trente (8
Avril 1546) a décidé qu’elle était Paulinienne, mais a admis que Paul puisse
ne pas avoir donné sa forme définitive.
Le concept des Elohim ne pouvait pas être transmis dans le grec en
utilisant le Theos sans qu’on ait recours à une explication fastidieuse du
concept. Si Clément est correct et que Luc l’a traduite en grec, il a
évidemment opté pour le mot messager plutôt que de tenter de transmettre le
concept des Elohim, puisque la distinction détaillée de la pensée panthéiste
aurait été nécessaire. Le concept ici est que les Elohim sont une pluralité
de qui les anges sont un terme équivalent dans leurs ordres supérieurs.
Puisque Elohim était le créateur, alors il s’ensuit que les entités de cet
ordre ont des pouvoirs limités ou délégués de création.
4:1.1 Les
Humanoïdes Pré-adamiques
David Pilbeam, dans son article
"Human Origins and
Evolution" (Origines de l'Homme et
l'Évolution) dans Origins, The Darwin
College Lectures (Éd. par AC Fabian, Cambridge, 1988, p.111) dit à
propos du développement humain, en commençant par l'Homo Erectus, la
première espèce d'hominidés à atteindre une large distribution en dehors de
l'Afrique :
H. Erectus et ses industries ont duré de plus de 1,5 millions d’années de
cela à moins de 0,5 millions d’années de cela sans beaucoup de changement,
ce qui implique un certain degré de stabilité comportementale qui a surpris
les paléoanthropologues lorsqu'ils en ont pris conscience pour la première
fois. Il y a environ 0,3 millions d’années, les hominidés dotés d’un cerveau
un peu plus grand (1100-1300 cm3) et d’un crâne légèrement de forme
différente ont commencé à apparaître : ce qu’on appelle les Homo Sapiens
archaïques ; dans l'ensemble, ils étaient encore très similaires aux
H.Erectus. Pour les distinguer de nous, les Homo Sapiens Modernes, le
modificateur archaïque est ajouté. Les sapiens archaïques les plus connus
sont venus d'Europe et d'Asie de l'Ouest : l'homme de Neandertal.
Cependant, malgré leur étiquette de sapiens, malgré les tentatives de les
"blanchir", je ne pense pas qu'ils devraient être appelés Homo Sapiens, car
morphologiquement et, par inférence, sur le plan du comportement ils
diffèrent nettement de l'homme moderne.
Pilbeam poursuit en disant (pp. 112-3) :
Un changement évolutionnaire substantiel vient entre les Homo Sapiens
archaïques et modernes. Il s'est produit au cours de la période comprise il
y a entre 130 trillions d’années et 30 trillions d’années, se terminant avec
l'apparition des humains comme nous, avec des squelettes moins massifs, les
corps moins musculaires, des têtes plus rondes et les visages plats. À en
juger par leurs traces archéologiques, leur potentiel de comportement était
aussi semblable au nôtre il y a au moins 35 trillions d’années. La cause de
ce dernier changement majeur dans l'évolution humaine est obscure, et il y a
désaccord considérable sur son tempo et le mode, quand et où cela s'est
passé et quel micro schéma d'évolution a été suivi. Avec ces humains
modernes, nous obtenons la première preuve de modèles de comportements
manifestement modernes sous de nombreux aspects ; de la peinture et de la
sculpture de la grotte, à des outils sophistiqués et la chasse coopérative
minutieusement planifiée, à l'augmentation de la taille et la densité de la
population et la répartition géographique et écologique élargie. C'est ici,
enfin, que tous les caractères véritablement
"humains"
sont réunis pour la première
fois.
Pilbeam affirme que de
"nombreuses qualités
‘humaines’
semblent avoir évolué étonnamment tard, ce qui
est l'une des conséquences les plus intéressantes des travaux récents."
(ibid., p.114).
Selon Brian M. Fagan (People
of the Earth: An Introduction to World Prehistory, 5ème Éd., Little Brown & Co.
Boston, 1986, pp. 128ff), les Néandertaliens sont reconnus comme une
sous-espèce de l'Homo Sapiens qui est apparue pour la première fois durant
la période interglaciaire de l’Eémien, soit il y a environ 100 000 ans ou
moins.
Les découvertes faites à Petralorna en Grèce datent entre 300 et 400
trillions d’années, et la découverte de la grotte Aragas a révélé des crânes
et des mâchoires qui semblent anatomiquement intermédiaires entre l’Homo
Erectus et l'Homo Sapiens. Ceux-ci datent d'il y a environ 250 trillions
d’années et le crâne Swanscombe entre 200-250 trillions d’années. Couplé
avec les découvertes de Steinheim en Allemagne, il est suggéré que ceci
indiquait que la transition vers l'Homo Sapiens Neanderthalis s’est achevée
il y a 100 000 ans.
Il ne fait guère de doute que l’homme de Cro-Magnon ou ce qui sont
appelés les premiers hommes modernes et les Néandertaliens aient coexisté
sur la planète. Selon Sarah Bunney (écrivant dans le magazine
New Scientist, "Science," 20 janvier 1990), "des restes de
squelettes fournissent une bonne preuve de l’existence des premiers hommes
modernes en Israël (grottes de Qatzeh et Skhul) il y a entre 100 000 et 90
000 ans. Il y a au moins 43 000 ans, des populations de personnes modernes
ont atteint l'Europe méridionale et centrale." Les publications de
New Scientist, "Science," de 26
novembre 1987 et de 25 février 1988, affirme qu’au Moyen-Orient, les deux
formes (de Neandertal et de Cro-Magnon) peuvent avoir coexisté pendant des
dizaines de milliers d'années.
Selon James Bischoff, à partir de l'utilisation de nouvelles techniques
de datation, il semble que les gens modernes primitifs aient atteint la
Grotte espagnole L'Arbreda en Catalogne et la grotte d'El Castillo en
Cantabrie il y a environ 40 000 ans (le Journal
Journal of Archeological
Science, Vol 16, pp. 563 et 577).
Les deux grottes avaient été précédemment utilisées par les
Néandertaliens. Les technologies de l'outil des Neandertal sont connues
comme Moustériennes, celles de l’homme de Cro-Magnon sont connues comme
Aurignaciennes ; en l’absence de preuves squelettiques, les types d'outils
sont considérés comme des preuves de genre. Certains archéologues, dont Paul
Mellars de Cambridge, font toutefois valoir que les Néandertaliens ont
acquis, par le contact avec les humains plus modernes ou de façon
indépendante, les marques de l'Aurignacien (Current
Anthropology, Vol 30, p. 349).
Indépendamment du débat académique et de la précision absolue de la
datation, il ne fait aucun doute que deux espèces humanoïdes ont existé sur
la planète avant la création biblique d'Adam, il y a environ six mille ans.
La technologie du Paléolithique Moyen de Néandertal est soutenue par
Bischoff et ses collègues pour avoir pris fin il y a environ 40 000 ans.
Dans la Grotte L'Arbreda, l'Aurignacien est précédé sans interruption par
des outils moustériens ou du Paléolithique moyen. Cette position est étayée
par des preuves provenant de l'abri sous roche d’Abric Romani près de
Barcelone.
Ces découvertes révisent les datations de manuels reconnus en les faisant
reculer de 35 000 années. Au fur et à mesure que la technologie s’améliore,
elle confirme ou prolonge la période de temps, mais ne la réduit pas. La
difficulté à confirmer les dates avec précision au-delà de 40 000 années est
due au fait que les techniques de datation au carbone sont limitées à cette
échelle de temps. La datation thermoluminescence et autres remontent à
quelques centaines de milliers d'années.
Le site de El Castillo présente une couche de sédiments de la moitié d'un
mètre d'épaisseur séparant le Moustérien de l’Aurignacien, indiquant la
désuétude au fil du temps ou l'envasement dû à une catastrophe. Selon
Bunney, "Dans le sud-ouest de la France et le long de la côte la plus
septentrionale de l'Espagne, comme au Moyen-Orient, il y a des signes que
les gens modernes et les Néandertaliens vivaient côte à côte pendant un
certain temps. Il n'y a pas de transition abrupte comme à L’Arbreda." La
preuve de cela est également tirée de la technologie distinctive du
Châtelperronien qui présente des caractéristiques à la fois Moustériennes et
Aurignaciennes. Un bon exemple de cela a été trouvé avec un squelette
néandertalien à Saint-Césaire en Charente-Maritime.
La
technologie pierre-outil
s’est poursuivie pendant plusieurs milliers d'années jusqu'à ce que les
outils comme ceux de Kartan disparaissent il y a plus de 4 000 ans (voir
Ronald Lampart,
The Great Kartan Mystery (Le Grand Mystère Kartan), ANU, 1981).
4:1.2
Explication de la Séquence
L'existence de trois espèces distinctes, sans aucune preuve de mutants ou
de changements intermédiaires ne prétend pas que l'une a évolué à partir de
l'autre ; en effet, cela affirme le contraire. L'absence de changement
mutant chez l’Homo Erectus d’il y a 1,5 millions d’années à 0,5 millions
d’années et l'émergence d'une espèce distincte il y a 300 000 (-) ans dans
le cas de l'homme de Neandertal, et il y a 35-40 000 ans ou plus dans le cas
de l’homme de Cro-Magnon, sans que l’on trouve des mutants qui diffèrent ou
délétères, indiquent une structure génétique stable avec une structure
secondaire imposée à la première. L'origine Adamique il y a environ 6 000
ans plaide en faveur d’une troisième structure. Bien que les anthropologues
n'acceptent pas que l’homme de Cro-Magnon soit une espèce distincte de
l'homme moderne, mais plutôt une autre sous-catégorie. Cela soulève quelques
questions philosophiques intéressantes sur la création.
Nous avons vu que Dieu ne peut pas expérimenter, mais plutôt Il crée à
partir d'un plan constant. Nous avons vu en outre qu’à partir de son
omniscience Dieu ne pouvait pas créer un produit défectueux car cela serait
préjudiciable à ou contesterait Sa nature. De ce que nous savons de l’H.
Erectus, l'espèce n'était pas humanoïde dans un sens que nous accepterions
maintenant comme nécessairement caractéristique, et il semble donc que ces
espèces aient été détruites par un événement quelconque ou supprimées pour
faire place à des formes plus tardives.
Du fait de son omniscience, Dieu aurait prévu les destructions et les
remplacements et par conséquent, ils auraient été sans aucune raison d’être,
sauf pour un entretien ou une fonction zoologique. L'écart entre l’Erectus
et l'homme de Neandertal n’aurait entraîné aucun processus d'apprentissage
ou mécanisme de soins tel que le développement du caractère. Les
Néandertaliens semblent avoir été cannibales, mais peut-être rituellement.
De la même manière le chevauchement des deux espèces, l'homme de Neandertal
et l’homme de Cro-Magnon, implique des conflits (sans aucune preuve directe)
avec l'élimination inévitable de l'une d’entre elles.
***
Et Dieu créa l'homme à son image ; à l'image de Dieu il le créa ; homme et
femme il les créa. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre et soumettez-la (Genèse 1:27-28a).
La création adamique était comme une recréation pour remplir la terre. Le
mot est ici
(אלמ) mâlê’
remplir ; dans une large utilisation, il a aussi le sens de remplir de
nouveau. Ce terme est utilisé de nouveau pour Noé dans Genèse 9:1 :
Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit. Soyez féconds, multipliez,
emplissez la terre (Bible de Jérusalem) ou remplissez de nouveau la terre
(Version American Standard Version
de la Bible).
L'injonction faite à Noé était dans les mêmes termes que celle donnée à
Adam et ne s'oppose pas à une armée préexistante ou
(אבצ) tsâbâ.
De plus, la coexistence du groupe Adamique avec les autres est implicite
dans les commentaires de Caïn après qu’il a tué d'Abel. Selon les récits
standards lui et Adam ainsi que Ève et peut-être quelques sœurs étaient les
seuls êtres vivants sur la planète. Caïn n'est pas seulement inquiet d'être
caché de la face de Dieu, mais plutôt de devenir un fugitif et un vagabond
sur la terre :
Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera (Genèse 4:14).
Et le Seigneur mit un signe sur lui afin que
quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors, il habita dans la terre de
Nod
(Nôwd) (נוד) (de Nôwd SHD
5110, 5112, un exilé ou vagabond).
Il est possible que le terme exil dérive de ce terme pour la terre de Nod
puisque le mot n'est pas la racine principale, mais plutôt le nom qui
désignait la terre. Tout porte à croire qu’il existait d'autres personnes.
Qui étaient-elles ?
4:2 Les
Aspects Philosophiques de
l'Évolution
Il est maintenant intéressant d'examiner si le processus de l'évolution
est ouvert à Dieu comme un outil créatif légitime découlant de Sa nature.
Il ressort de la discussion précédente que Dieu ne peut pas créer
autrement qu'à partir d'un plan éternel. L'utilisation d'un mécanisme
arbitraire où les fluctuations aléatoires de la structure génétique
produisent de multiples variations d'espèces, dont certaines sont plus aptes
que d'autres à survivre, et où l'adaptation se fait sur une longue période,
n'est pas ouverte à un Dieu omniscient et omnipotent, la création étant
parfaite en conformité à un plan omniscient.
Cette situation, cependant, ne semble pas être le cas, en tout cas à la
connaissance de la science. Il y a un désaccord général quant à la séquence
de développement des groupes homo. Le point de vue traditionnel est que
c’était graduel, progressif et accéléré. L'autre point de vue est qu'il
s’est déroulé "pas-à-pas" avec une phase de longue durée de pré-sapiens.
Pilbeam montre les contrastes dans son modèle à la p. 112 reproduit
ci-dessous.
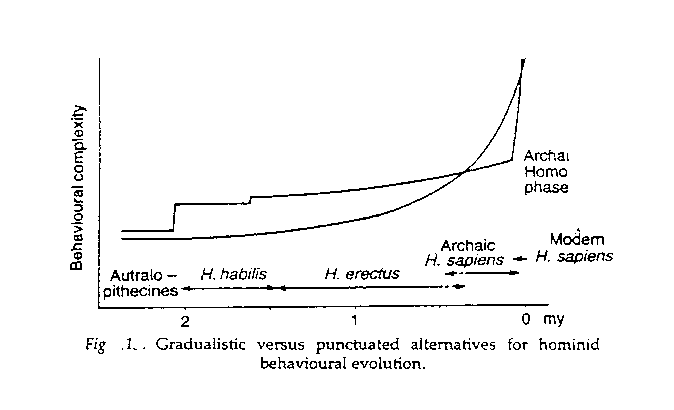
On pourrait faire valoir que Dieu pouvait logiquement créer une structure
génétique qui, dans les conditions appropriées, modifierait son code pour
s'aligner sur les conditions planétaires en vigueur. Les arguments seraient
alors les suivants : soit le changement génétique progressif dans le cadre
des variations environnementales et climatiques, soit une modification
automatique en vertu de ce changement ; d’où l'argument pas-à-pas.
L'argument pas-à-pas permet aux codes verrouillés dans une création
distincte d’être activés par des changements déterminés permettant une
métamorphose pas-à-pas rapide telle que celle expérimentée il y a ± 50 000
ans. Une telle structure permettrait de limiter la diversité des espèces
contenant un ADN semblable. Mais cela peut nécessiter une altération
rétrograde par les variations climatiques inverses. L'absence de changement
climatique visible coexistant est également problématique.
La difficulté philosophique réside dans les perceptions de la structure
ontologique de père en fils, en tant qu’exemple de la relation avec la
Divinité. Il est difficile de déterminer le point de rupture spécifique, ou
plus précisément, le point de commutation, du nephesh en tant que l'image de
Dieu, où ces êtres sont admissibles à la résurrection et donc capables de
déduction rationnelle et de réception de l'essence ou esprit comme une
entité éternelle.
La doctrine de l'âme est rendue ici dénuée de sens car cela devient
nécessaire d'établir un point de commutation, non seulement pour la
potentialité mais aussi et plutôt pour la réception de ces entités
éternellement déterminées et créées pour superposer sur l'armée des
hominidés. Ce concept clairement a une application pour les concepts
monistes indo-aryens où la doctrine de la réincarnation répétitive n'a de
capacité humaine qu’il y a 50-100 trillions d’années.
Il semblerait que le principal facteur montrant la divergence marquée du
développement des hominidés était entre celle de l’H. Erectus et l’H.
Neanderthalis. L’Erectus avait un bassin étroit et une boite crânienne
réduite. Le bassin réduit indique une période de gestation plus courte et,
par conséquent, un enfant plus petit et moins développé, ainsi qu'une
capacité cérébrale réduite. Malgré tous les arguments anthropologiques, il
ne semble pas y avoir de raison de considérer l’Erectus comme un être humain
dans un sens autre que la fabrication d'outils, une caractéristique commune
aux grands singes et d'autres espèces.
La stabilité relative et l'absence de tout développement observable chez
ces espèces primitives s'opposent logiquement à leur inclusion en tant que
progéniteurs de l'homme. En effet, c’est maintenant un fait qu'il y a un
embarras de progéniteurs évolutifs potentiels et que nombre d'entre eux
doivent être écartés. Si beaucoup devaient être écartés il n'y a aucune
raison logique pour laquelle tous ne devraient pas l’être, sauf sur la
supposition qu'il doit y avoir un progéniteur de l’H. Neanderthalis ou de
nous-mêmes quelque part, autrement la théorie de l'évolution est obsolète
comme un système non-théiste.
Le passage de l’H. Erectus à l’H. Neanderthalis, cependant, constitue une
modification génétique énorme avec la restructuration de la gestation, et
des groupes sexuels et de là familiaux. Les Néandertaliens avaient une
capacité cérébrale égale à la nôtre et un corps mieux musclé et plus fort.
En raison d'un visage rond (pour les climats froids selon certains
anthropologues), il a été démontré que les lobes frontaux étaient réduits.
Il est donc possible que la capacité de planification ait été réduite, mais
ce n'est pas forcément le cas.
Les arguments antérieurs étaient en faveur d’un cerveau plus grand que le
nôtre, mais il se peut que ces arguments ne concernent que certains
spécimens. Les arguments concernant les cordes vocales limitées sont des
reconstructions, et les affirmations de Pilbeam concernant la parole et la
communication réduites sont contestées par les anthropologues dans
l'Université nationale australienne avec lesquels l'auteur s’est entretenu.
Les Néandertaliens étaient des humanoïdes apparus tardivement, distincts et
différents de tout ce qui les a précédés et, contrairement à la croyance
populaire, il n'existe aucune preuve et aucune raison logique, autre que
l'obligation de liens évolutifs, pour accepter qu'ils étaient les
antécédents des humains modernes. Les tests d’ADN modernes ont révélé qu'ils
n'étaient absolument pas apparentés aux humains et que leur système d'ADN à
27 brins leur donnait plus de points communs avec les chimpanzés.
Il n'y a aucune raison logique convaincante d’accepter que l'Homo Sapiens
ou l’Homo Neanderthalis ait évolué à partir d'autres espèces, et il n'y a
aucune preuve indiquant que cette construction s'est produite.
Le principe de l'évolution semble être basé sur le principe
anthropomorphe égocentrique selon lequel la connaissance humaine moderne est
la forme la plus élevée disponible, et, puisque la terre est le centre de
l'univers, elle doit donc s’y être développée à partir de formes de vie
préexistantes. Parce que l'homme est limité dans la forme et le mode de
transport, il n'est pas logiquement correct de supposer que cette
construction est uniforme au sein de l'univers. Puisque les récits écrits
humains nient l'affirmation de notre unicité, il est donc parfaitement
logique d'examiner les prémisses et de reconstruire les hypothèses et les
séquences sur lesquelles ces allégations sont fondées. Les présuppositions
dogmatiques ne font que freiner un tel exercice.
4:3
Les Nephilim
C'est Augustin d'Hippone
qui a le plus obscurci la question de l'homme non adamique.
Il existe trois types de géants mentionnés dans
la Bible. Le premier ou Nephilim provenant de
ליפנ
nephîyl
(SHD 5303) ou
לפנ
nephîl, est dérivé de la racine
tomber dans le sens le plus large comme déchu ou abattu et perdu de
Nâphal (SHD 5307). Cet usage apparaît dans Genèse 6:4
et aussi dans Nombres 13:33.
Les deux autres cas se présentent parmi les fils
d'Anak, également à Nombres 13:33, comme
רובג
gibbôwr (SHD 1368) ou
רבג
gibbôr, qui est également le même que
גבר geber (SHD 1397)
comme un homme vaillant, fort et puissant issu de la racine
גבר
gâbar (SHD 1396), être fort.
Le troisième sens est celui utilisé dans le Deutéronome et dans Josué de la
racine
אפר
râphâ’,
guérir ou réparer.
Râphâ’ ou râphah
peut être un géant dans le sens de revigoré ou guéri, de là Raphaël comme
le nom "Dieu a guéri." Il est appliqué comme un nom israélite et angélique.
Raph était un géant israélite.
Le rapport dans Nombres
13:33 utilise le mot nephilim pour désigner les Fils d'Anak, qui viennent
des géants comme
gibbôr dans le second sens, et non des Nephilim de Genèse. Ici, le récit
attribuait les Nephilim d’avant le déluge aux enfants d'Anak d’après le
déluge qui avaient les caractéristiques de géants. La deuxième ou troisième
signification de vaillants hommes et une croissance excessive sont tout à
fait distinctes des concepts des nephilim antérieurs au déluge, bien que le
concept n’ait pas perdu son sens de guérison divine et de rétablissement.
[Dans la littérature rabbinique, l'irruption des Nephilim en tant que fils
d'Anak est clairement perçue comme postérieure au déluge ; voir également la
Bible The Companion Bible]. Le
premier concept était celui de la descendance déchue ou abattue des fils de
Dieu. Genèse 6:1-4 dit :
Et il arriva, quand les
hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et les filles
naquirent aux hommes, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes
étaient belles ; et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils
choisirent. Et le Seigneur dit :
‘Mon Esprit ne s’attachera pas
toujours dans l'homme ; car il est en effet chair ; cependant ses jours
seront de cent vingt ans.’
Le terme ici dans la
Version American Standard Version
de la Bible est traduit par
"car en effet il est chair,"
et la note 4 de ce verset dit :
"ou, dans leur égarement, ils sont
chair." Ceci est en fait le véritable sens.
Il continue au verset 4
:
Il y avait des géants
(Nephilim) sur la terre en ces jours-là et aussi par la suite, quand les
fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent
donné des enfants. Ceux-ci sont les hommes puissants qui étaient d’antan,
des hommes de renom.
Puissants ici est dans
le second sens de géant ci-dessus, comme
gibbôwr, un guerrier ou un tyran.
Augustin, dans l’ouvrage
La Cité de Dieu, livre XV, chapitre 23 (Bettenson, Penguin, p. 639),
traitant de ce passage, explique que les fils de Dieu appelés également
‘Anges de Dieu’ étaient des descendants de
Seth représentant aussi une lignée pure exempte de péché de convoitises ;
les hommes étaient les descendants de Caïn, comme des êtres inférieurs ou
pécheurs.
Le passage est
sémantiquement analysé par Augustin de sorte qu'il y avait des géants nés
avant l'accouplement de la lignée de Seth avec la lignée de Caïn et après
cela aussi. La lignée de Seth engendra des géants de son accouplement
ordinaire et de ses accouplements déchus avec la lignée moindre de Caïn.
La lignée de Seth
N’a pas procrée des
enfants pour fonder une famille pour administrer leur groupe, mais pour
produire des citoyens de la Cité de Dieu, afin qu’en tant qu’anges de Dieu,
ils puissent donner à leurs enfants ce message : qu'ils doivent mettre leur
confiance en Dieu, comme le Fils de Seth, le
‘Fils
de la résurrection’, qui espérait faire appel au
nom du Seigneur Dieu. Et en vertu de cette espérance ils seraient, avec leur
postérité, cohéritiers de bénédictions éternelles ; et les frères de leurs
fils sous Dieu le Père.
Maintenant, ces Fils de
Dieu ne sont pas des anges de Dieu de telle façon qu'ils ne sont pas aussi
des êtres humains comme certaines personnes le supposent. (ibid., pp.
639-640)
Augustin procède à
l'analyse de la section du passage
‘parce qu'ils sont chair’ en ignorant le potentiel de
‘dans leur égarement, ils sont devenus chair !’ Il se réfère à la Septante où ils sont
certainement appelés Anges de Dieu et Fils de Dieu. Il déclare également que
:
Aquila ; (qui a produit
circa 140 après J.-C. une version grecque littérale de l'Ancien Testament),
laquelle traduction les Juifs préfèrent à toutes les autres ; ne donne ni
‘anges
de Dieu’ ni
‘Fils
de Dieu’, sa version donne
‘Fils
des Dieux’. (ibid.)
Augustin continue ici
les explications alambiquées du concept des Fils de Seth étant comme [des]
Fils de Dieu, frères de leurs pères ce qui était correct du point de vue de
l'adoption ; mais c'était avant l'adoption ou bien l'adoption avait cessé.
Le point de vue d'Augustin que les géants étaient ainsi de Seth, de Caïn et
de lignée mixte (et non prolifique avant le déluge) était de prouver une
explication très convaincante du passage par l'utilisation de la sémantique
et en donnant une explication simpliste.
Il ne comprenait pas la
traduction d’Aquila des Bene Elohim parce qu'il était un trinitaire
Athanasien. Il cite la raison de la disparition des géants comme le manque
de sagesse, car la sagesse était la
‘propriété exclusive du
bien.’ Ce fait est souligné
par un autre prophète quand il dit :
"Il y avait ces géants de renom, qui dès le commencement ont été des
hommes de grande stature, experts en guerre. Ce n’était pas ceux que le
Seigneur a choisis, ni leur a-t-il donné la voie de la connaissance. En
fait, ils ont péri parce qu'ils n'avaient pas la sagesse. Ils ont disparu
par leur manque de réflexion." (Bar 3, 26 et suivants) (ibid., p. 642).
Augustin estime que le
déluge n’est pas dû à un attribut de la colère de Dieu qui a perturbé Sa
tranquillité immuable, mais cela s’est produit à la suite d’un jugement pour
le péché. Il ajoute que :
Néanmoins aucun de ceux
qui, selon le récit biblique, descendaient de la semence de Seth, n'a en
fait péri dans le déluge. (ibid., p. 642).
Ceci est nécessaire pour
sa logique, puisque la semence de Seth était [des] Fils de Dieu et
l'objectif du déluge était pour effacer l'homme,
que j'ai créé, de la
face de la terre, et toutes les créatures, de l'homme à la bête, des
reptiles aux oiseaux de l'air parce que je suis en colère de les avoir
créés. (Genèse 6:5ff) (ibid.)
Ceci découle de la
prémisse que Noé était irréprochable ou pur dans ses générations et les Fils
de Dieu purs ne pouvaient pas être détruits, d'où les hommes étaient
pécheurs et étaient détruits. La lignée de Seth ne l’était pas. Cette
interprétation est ouverte à différents arguments en réfutation ; cependant,
elle est devenue l'explication acceptée jusqu'à présent.
La compréhension
acceptée avant le troisième siècle était très différente, tant à l'intérieur
qu’en dehors du Christianisme.
4:3.1
Qumran
La documentation du
Qumrân montre quelques aspects intéressants de la compréhension du premier
siècle AEC (Avant l’Ère Courante) et EC (l’Ère Courante). Une chose en
aparté est que la petite voix du trône de Dieu est exprimée par les
chérubins qui soutiennent le trône (Ézéchiel 1:10), et la liturgie angélique
qui traite du chariot divin ou Merkabah montre que la petite voix de
bénédictions de 1Rois (19:12) en tant que la manifestation de Dieu est
exprimée par les chérubins. (G. Vermes,
The Dead Sea Scrolls in English (Les Manuscrits de la Mer Morte en anglais), Pelican, 2ème
éd., 1985, p. 210)
De l'Apocryphe de la
Genèse dans Vermes (op. cit., p. 215ff) les concepts sont bien évidemment
que les Fils de Dieu dans Genèse 6:1-4 étaient des anges qui sont descendus
du ciel et ont marié les
‘filles des hommes’. Ces groupes ont été décrits dans la section
traitant de la naissance de Noé :
II. Voici, je pensais
alors dans mon cœur que la conception était (due aux) Veilleurs et aux
Saints ... et aux Géants (ibid., p. 216).
Ce concept est
considérablement étendu dans le Livre d'Enoch (voir M.A. Knibb,
The Ethiopic Book of Enoch (le livre éthiopien
d'Hénoch), vol 1 & 2, Oxford Clarendon, 1982)
Les Veilleurs sont les
derniers qui ont reçu la responsabilité de la terre. Au retour de l'Éternel
Dieu, ils vont être secoués ; les Veilleurs sont identifiés avec les Anges
Déchus (Vol. 2, p. 59 et notes). Le texte à Genèse 6:1-4 est amplifié dans
les chapitres 5-6 d'Énoch (pp. 67-8) et il est estimé que 200 de l'armée
sous Semyaza sont descendus sur Ardis, le Sommet du Mont. Hermon. Les noms
des dirigeants et leurs fonctions ont été donnés, et à partir des chapitres
7-8 (p. 77 et suivantes), il est clair que les soi-disant
‘géants’
étaient des descendants de ces
veilleurs, et que c'était la compréhension du passage de la Genèse.
À partir des chapitres
14-15 (pp. 101 et suivantes), la proposition est mise que les veilleurs
étaient immortels et éternels sans femmes, puisque
‘la demeure des spirituels [est] dans les cieux’. Les mauvais esprits sont tenus pour être sortis
de la chair des géants
‘parce que de là-haut, ils ont été créés : c’est des Saints Veilleurs
qu’ils tirent leur origine et leur premier fondement.’ C'est logiquement une extension de la doctrine de l'âme et c’est
probablement une spéculation maladroite sur la séquence de la manifestation
démoniaque qui sera traitée plus tard.
En tout cas les
déclarations des chapitres 14-15 (p. 101) montrent que les esprits du ciel
qui sont maintenant sur la terre doivent se soulever contre les fils des
hommes dans les derniers jours.
Les concepts de l'armée
déchue se mélangeant avec les hommes ne sont pas contraires à la raison,
comme la notion de l'Esprit Saint ou Essence de Dieu produisant un enfant
par Mariam (ou Marie) relève du même concept. Donc, de ce qui précède, la
capacité à se matérialiser n'est pas logiquement limitée si elle est
sérieusement envisagée. Les aspects métaphysiques de l'altération de la
matière ne sont pas limités. Les déclarations du Christ de jeter les arbres
et les montagnes dans l'océan ne peuvent être fondées que sur la
réorganisation de la matière.
Un autre point
exégétique de la Genèse est que, parce qu'il y a deux aspects différents
d'un récit de la création, il a été développé que le récit est double, à
savoir le récit Jahviste et le récit sacerdotal de l'événement. Cela n'a
jamais été évalué logiquement qu'il puisse être un récit de deux événements
qui découlent de la même logique d'analyse. Il est possible que l'analyse
Jahviste et sacerdotale puisse bien être une reconstruction pour satisfaire
une position idéologique athanasienne. La découverte continuelle des données
anthropologiques rend la compréhension athanasienne incohérente et
ontologiquement inadéquate.
4:4
Une Harmonie entre des Philosophies Apparemment Contradictoires.
4:4.1
Les Déformations de Nicée et post-Nicée de la
Philosophie de la Religion
La Philosophie de la
Religion, telle qu’elle est venue à être adoptée par le Concile de Nicée et
par la suite, a laissé la discipline totalement démunie pour comprendre et
expliquer de manière cohérente la Divinité, le but de la création, ainsi que
la fonction et le destin de l'Armée conjointement avec l'humanité. Aucune
explication cohérente du mal n’était alors possible, et la Philosophie était
totalement incapable de répondre à l'assaut scientifique des XIXème
et XXème siècles. Augustin, par son interprétation simpliste et
fermée sur elle-même de Genèse 6:4 allait à l’encontre de la compréhension
non seulement des Hébreux, mais aussi de la majeure partie de l'ancien
monde.
Josephus, écrivant au 1er
siècle, répertorie quelle était la compréhension commune de toutes les
sectes juives, y compris, comme nous l'avons vu, les fils de Tsadok à Qumran
et les auteurs du livre d'Enoch. Il dit (A.
of J., Livre 1 ch. III.1, p. 28 de la traduction Whiston, Kregel,
Michigan, 1981) :
de nombreux d'anges de Dieu
se joignirent aux femmes, et engendrèrent des fils qui se sont révélés
injustes, et haïsseurs de tout ce qui était bon, ce qui témoigne de la
confiance qu'ils avaient en leur propre force, car la tradition veut que ces
hommes aient fait ce qui ressemblait aux actes de ceux que les Grecs
appelaient des géants.
Whiston dit à ce sujet
dans sa note en bas de page que
"cette idée que les anges déchus étaient en quelque sorte les Pères des
anciens géants était l'opinion constante de l'antiquité."
Il déclare en outre dans
la deuxième note en bas de page que c'est la vie des géants qui a été
réduite à 120 ans et pas celle de Noé et sa descendance (ou de ses
antécédents), en raison de cette consanguinité qui est confirmée par le
fragment d'Enoch (section 10 dans
Authent. Rec. Partie 1. p. 268). Comme indiqué plus haut, le terme
Nephilim dérive d’abattu, tombé ou déchu, et non de géant.
La Théologie
Philosophique d'Augustin n'a pas tenu compte de cette tradition dans le
monde entier et ainsi a créé la théorie des lignées de Seth et de Caïn,
l’une bonne, l'autre mauvaise, le gigantisme étant une aberration naturelle
de ces lignées. Il est ironique que cette manipulation sémantique ait été
adoptée par les idéologues fondamentalistes qui sont maintenant ses
défenseurs les plus ardents. Cela les a laissés totalement non préparés face
à l’assaut de la philosophie du Positivisme et de ses doctrines
évolutionnistes suite à la paléoanthropologie et de ses découvertes.
4:4.2
Une Autre Explication
Voici un autre point de
vue qui tient compte des connaissances paléoanthropologiques actuelles et
qui harmonise l’histoire connue de la terre avec les récits bibliques de la
Genèse, etc., et qui permet ainsi à parvenir à une explication philosophique
cohérente de l’ordre de la création et de la nature et du problème du mal.
De vastes zones de la
planète montrent une émergence de l'Homo Sapiens moderne sans aucune
population Neandertal antérieure dans le voisinage, et un grand écart entre
l'H. Erectus dans les continents voisins et l'émergence de l’H. Sapiens.
L’Australie fournit un exemple de cet écart. Il a été par conséquent supposé
que l’H. Sapiens et l’H. Neanderthalis étaient des descendants par une
évolution indépendante de l’H. Erectus, même si les liens sont absents.
Un récit créationniste
biblique de la même preuve serait le suivant. Il y a quelque temps il y a
moins de 100 000 ans, une décision a été prise de mettre à niveau le primate
bipède l’H. Erectus à un statut intellectuel tel qu'il pourrait jouer un
rôle dans le système universel. Que cette décision ait été prise par le
Conseil des Elohim est possible, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Les
commandants du système, ou les Elohim qui sont devenus l'Armée Déchue, ont
peut-être eu les pouvoirs nécessaires de création.
L’Homo Neanderthalis a
été créé et s’est stabilisé sur plus de cinquante millénaires. Il y a
environ 40 000 ans, selon les travaux réalisés par Eric Trinkhaus et William
Howells en 1979 (voir Fagan,
People of the Earth (les Gens de la Terre), pp. 130-131), les populations de Neandertal ont
subi un changement rapide vers une anatomie humaine essentiellement moderne
sur une période de 5000 ans. Les Néandertaliens avaient la même posture, les
mêmes capacités manuelles, la même portée et les mêmes caractéristiques de
mouvement que les gens modernes. Ils étaient des gens corpulents et
massivement musclés dont la capacité cérébrale était la même avec une
certaine augmentation nécessaire due à la forte musculature.
Il n'y a aucune
indication de tout élément de preuve fossile que les Néandertaliens ont
évolué directement et à la fois vers l'homme moderne. "Certaines populations
de Neandertal, notamment celles des grottes du Mont Carmel d'Israël
(Howells, 1957, a, b) et de la Tchécoslovaquie (Trinkhaus et Howells,
1979) montrent une grande variation anatomique, dans la mesure où certains
d'entre eux sont presque identiques à l’Homo Sapiens moderne. Toutefois, les
véritables formes de transition échappent encore à la pelle de
l'archéologue." (ibid., p. 133)
La réponse logique et historique de cette
situation serait que les Néandertaliens se sont mêlés par le commandant du
système ou Étoile du Matin et l'Armée appelée les ‘Veilleurs’ dans la littérature
antique. Le terme Veilleur est utilisé dans Daniel 4:13 et 17 en utilisant
(SHD
5894
עיר)
‘îyr, ce qui signifie un
ange en tant que gardien, de là Veilleur. (Ceci est
tout à fait distinct du terme utilisé dans Jérémie 4:16). Ces
‘Nephilim’
étaient nécessairement plus
massivement musclés que la descendance adamique ultérieure et différaient du
prototype Homo postérieur qui a été établi à partir de critères européens
modernes. Ce groupe a pris le contrôle de la planète 35000 ans avant
aujourd’hui, et a remplacé les Néandertaliens et a provoqué "un saut
quantique dans la complexité de la société humaine" (ibid.).
Ce chiffre est conforme
à l'Écriture dans la structure temporelle. C’est mille générations ou
presque 40 000 années sur toute la période jusqu'à la fin de la Deuxième
Résurrection après le système millénaire et ceci est mentionné dans la Bible
à Deutéronome 7:9. Ainsi, la miséricorde de Dieu est étendue à ceux qui
l’aiment et qui observent Ses commandements pour mille générations. Cette
miséricorde est étendue à l'armée à partir du temps où elle a interféré avec
la création et le plan de Dieu sur tout son déploiement, même si la
résurrection n'est pas étendue aux êtres qu’elle a créés (cf. Ésaïe 26:14).
Indépendamment de la
mécanique de l’ingénierie génétique, il ne fait guère de doute dans les
esprits des ancêtres que l'armée déchue s’était matérialisée et qu’elle a
commis la fornication avec les humains créés afin de créer un hybride. Jude
dit, en parlant des anges qui n’ont pas gardé la domination qu'ils ont reçue
et qui s’attirent ainsi le jugement, concernant les péchés des habitants de
Sodome et Gomorrhe, et la ville voisine, que
"comme les anges, ils ont commis la fornication et ont suivi les
convoitises contre nature" etc. (Jude 7) (Version
New English Bible de la Bible ; la traduction de la KJV est si
obscure qu’elle en devient presqu’un obscurcissement).
Il y a environ 6000 ans,
une décision a été prise par les Elohim d’écraser la rébellion et
d'intervenir dans les affaires de la planète. Une élimination simple et un
recommencement n’assureraient pas qu’un tel événement ne se reproduise de
nouveau, donc une séquence sotériologique complexe de rachat a été entamée,
conçue pour durer environ 7000 ans.
Adam fut ainsi le
premier de la création pour le rachat de la planète. La lignée d'Adam devait
témoigner aux Nephilim et établir la norme par laquelle ils seraient jugés.
Dans les jours de Noé, les Nephilim et la progéniture croisée et
indépendante ont été détruits, et avec les survivants subséquents une
période d'environ 2000 ans a été allouée d’Adam jusqu'à la sélection du
sacerdoce d'Abraham.
La période suivante de
témoignage se produisant sur plus de 2000 ans ou 40 jubilés devait être dans
le Jugement de l'Étoile du Matin (Azazel ou Satan), et un sacrifice
Rédempteur était nécessaire découlant de la nécessité logique de la mort
résultant de la division panthéiste du péché tel que traité ci-dessus. La
subjugation de la planète est alors programmée pour se produire après une
nouvelle période de 40 jubilés sous ce qu'on appelle le
"Signe de Jonas."
À la fin des six mille
ans, un règne Millénaire de la nouvelle Étoile du Matin doit être mis en
place afin d'établir un critère par lequel la planète doit être dirigée et
un modèle par lequel les actions précédentes doivent être jugées. À la fin
du Millénium, le chef des rebelles doit de nouveau être libéré et autorisé à
subvertir les nations. Cette étape est logiquement nécessaire en raison des
problèmes d'attitude complexes qui se développeraient chez un peuple à la
fin de 1000 années de régime parfait. En bref, un tel groupe tomberait dans
l'erreur intellectuelle du pharisaïsme [ou d’être juste à ses propres yeux]
des formes exposées dans Job, et les périodes éternelles données
institueraient la division, la désunion et une fois de plus une rébellion.
C'est précisément pour
les raisons exposées que les Fils de Dieu à être formés doivent être égaux
et de l’ordre d’Anges, tel qu’expliqué par Christ. Toute distinction entre
les précédents Bene Elohim et les Bene Elohim nouvellement créés aboutirait
à une division, et par conséquent Dieu ne serait pas un ou tout en tous.
Dieu est un, et par conséquent les Bene Elohim sont unis comme un.
À partir de ce qui a été
dit ci-dessus, Christ a été fait supérieur à ses collègues. À partir
d'Apocalypse 4, on voit que les Étoiles du Matin ou le Conseil des Elohim ou
Anciens placent leurs couronnes devant le trône ; le Messie étant fait
supérieur à eux implique une structure d'un souverain sacrificateur et
vingt-quatre divisions telles que les divisions du Sacerdoce. Ce schéma peut
par conséquent être un dispositif réfléchissant délibéré.
Le fait que Christ fût
le premier-né de nombreux frères ne signifie pas que les élus seront
supérieurs à l'armée angélique existante, mais plutôt qu’ils peuvent se voir
attribuer des rôles différents dans la structure gouvernementale qui semble
être centrée sur la terre. La structure peut s'étendre sur vingt-quatre
systèmes (ou plus) en douze unités. Quels que soient les niveaux d'autorité
de chaque division ou de l'ancienneté relative de la Première Résurrection,
il ne peut y avoir de différenciation dans la nature et l'essence de l'armée
car une telle division doit logiquement être polythéiste et donc interdite,
puisque Dieu est un. Ceux de la Deuxième Résurrection doivent pareillement
être des Bene Elohim ou Fils de Dieu.
Le concept selon lequel
un processus de sélection du salut est exécuté sur la base de la division
religieuse de la planète se produit uniquement comme une séquence de salut
non pas comme un processus d'élimination. De suggérer que les gens sont
condamnés par la division et le manque de connaissances est une insulte à
Dieu. La Deuxième Résurrection mentionnée ci-dessus et qui dure 100 ans
(voir Ésaïe 65) est prévue de façon à ce que toute chair puisse être
enseignée et reçoive l’opportunité pour le salut. Logiquement, cela doit
suivre, car si Satan devait empêcher les individus d’accéder au salut par la
tromperie, une limitation logique sur la toute-puissance de Dieu en découle.
Il est très utile
d’examiner le problème du mal ainsi que les doctrines et croyances
divergentes.
4:5
L'Âme et la Vie après la Mort
Tel qu’indiqué plus
haut, le concept de l'existence d'une âme comme une entité après la mort est
un thème constant découlant de l’Animisme de Babylone, c'est-à-dire de la
théologie chaldéenne.
La Bible déclare
catégoriquement que les morts restent ainsi jusqu'à la résurrection.
Personne d’autre que Christ n’est ressuscité ; les autres Élus se sont
endormis (1Thessaloniciens 4:13-18). Christ est ressuscité (1Corinthiens
15:20-23), et si Christ n'est pas ressuscité alors ceux (les morts) qui se
sont endormis en Christ sont perdus (v. 18). David est mort et a été enterré
et "sa tombe est encore parmi nous jusqu'à ce jour." (Actes 2:29).
"Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est
descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux." (Jean 3:13)
Une tromperie commune de
l'Armée Déchue semble être de créer l'illusion qu’on peut parler aux morts
par le biais de la nécromancie. C'est à cette fin que Saül s'approcha de la
sorcière à Endor qui avait un esprit familier, un
(בוא) ‘ôwb or
obe (SHD 178), provenant de l'idée de babillage ou de marmonner
comme à partir d'une bouteille ou d’un bocal, d'où un ventriloque, ou la
nécromancie comme un esprit familier par l'illusion.
Le concept qu’un esprit
pouvait être ramené d’entre les morts est considéré comme une réalité de
l'illusion que Samuel a été ressuscité d'entre les morts par la sorcière à
Endor. Toutefois, ce n’était pas Samuel qui a été ressuscité d'entre les
morts. Certains tentent de prétendre que l'entité était en fait un démon que
la femme a vu ; cependant, la femme a été effrayée par ce qu'elle a vu :
Et le roi lui dit : Ne
crains pas, car qu’est-ce que tu as vu ? et la femme dit à Saül : Je vois
des Dieux montant de la terre. (1Samuel 28:13).
Le mot qu'elle a utilisé
ici pour désigner les Dieux est Elohim, de sorte que l'entité (ou les
entités) qu’elle a vue et qui a parlé à Saül était un Elohim. C’était un
Elohim qui a enlevé la royauté de Saül et prononcé son châtiment. À en juger
par sa peur, nous pouvons conclure qu’il ne s’agissait pas d’une puissance
qu'elle connaissait ou avec laquelle elle était compétente.
Aucun des démons
n’aurait enlevé la Royauté de Saül car ils n’en possédaient pas l'autorité.
Une affirmation que cette entité était un esprit déchu ou un démon ne peut
reposer que sur la prémisse que si une entité agit contrairement à la
volonté de Dieu, cet être est automatiquement placé sous l'autorité des
Elohim déchus. Cette position semble contraire aux concepts énoncés par
Paul, qui a compris cette question en vue de sa formation. Un Elohim avec
cette autorité devrait logiquement faire partie de l’Armée loyale. La
méprise à ce sujet vient probablement d'une erreur de traduction dans la
NKJV, dans la NIV, et ainsi de suite, parce que les traducteurs ne
comprennent pas le concept d’Elohim et sont enfermés dans la doctrine de
l'âme. L'entité est de toute façon un Elohim, soit de l'Armée Loyale soit de
l'Armée Déchue, et n'est pas l'esprit de Samuel.
Pour les raisons
exposées tout au long du document ci-dessus, l'âme éternelle de l'homme est
une fiction de la Théologie chaldéenne. Le concept de la rédemption et
d'élection par infusion de l'Esprit est le mécanisme de progression vers une
structure spirituelle éternelle de l'être. Pourquoi Dieu créerait-il une
structure ontologique plus compliquée que nécessaire, impliquant une forme
plus complexe de destruction avec une séquence inhérente d'être ?
4:6 Les
Concepts Antérieurs et Ultérieurs des Elohim et de la Résurrection
Anders Nygren (dans
Agape and Eros, Tr. par Philip S. Watson, Harper Torchbooks, New
York, 1969)
attire l'attention sur la distinction nette faite par Justin Martyr entre
Dieu et la manifestation du Logos :
Le Logos est en quelque
sorte divin, mais pas au sens le plus strict du terme ; Le Père seul est
inengendré et incorruptible, et par conséquent Dieu. Il est le Créateur et
Père de toutes choses (Dial. LVI.
1.). Il n'est pas venu à nous ; Il demeure toujours au-dessus des cieux et
ne S’est révélé à personne et n’a des rapports avec personne. (Dial. v 4.) Par rapport à Lui, Christ est d'un rang inférieur, un
[deuteros theos],
"un autre Dieu que Celui qui a
créé toutes choses." (Dial. Lvi.
1).
Nygren dit ceci :
"Ce trait subordinationiste dans la Christologie
des Apologistes doit sans aucun doute être attribué à l'idée grecque de
Dieu." (p. 280).
Nygren a tort dans cette
affaire comme on peut le voir à partir d'un examen du Schéma de l'Ancien et
du Nouveau Testament décrit ci-dessus. Justin Martyr est plus proche que lui
; cependant la distinction et les actes de création sont liés au Logos, et
cette position n'est pas comprise par l’un ou l’autre. Nygren estime que
Loofs a raison quand il dit des Apologistes :
Leur doctrine du Logos
n'est pas une Christologie
‘plus supérieure’
que d'habitude, mais plutôt à un niveau inférieur à l'estimation
authentiquement chrétienne du Christ. Ce n'est pas Dieu qui se révèle dans
Christ, mais le Logos, le Dieu réduit (depotenzierte), un Dieu qui en tant
que Dieu est subordonné au Dieu suprême. (Loofs :
Leitfaden zum Studium der
Dogmengeshichte, 4 Aufl, 1906, p.129, ibid.).
Nygren et Loofs se sont
tous deux trompés dans leur estimation de ce qui était authentiquement
chrétien, comme ils tentaient de réinterpréter la Christologie d’Avant Nicée
qui suit de plus près ce qui est biblique dans leurs propres conceptions
erronées. L'Ange de la Rédemption faisait partie d'un Conseil des Elohim
subalternes à l’Elohim central qui était Eloah (Dieu le Père et Créateur).
Cette compréhension a
été perdue à partir du huitième siècle, avec la dispersion des Pauliciens,
et n'a toujours pas été comprise de nouveau. Aujourd'hui tout le monde pense
d'une manière Athanasienne dans la structure de la Philosophie et la
Théologie Chrétienne, même ceux qui sont en désaccord avec eux. C'est la
raison pour laquelle cette structure est fondamentalement incohérente.
Lorsque vous traitez
avec le concept des Anciennes et Nouvelles Étoiles du Matin et la période de
transition ou de rédemption, il peut sembler contradictoire de laisser l'un
de l'armée déchue et le plus puissant (un Chérubin Protecteur) aux
commandes, et de placer un autre Elohim sur la planète pour isoler un
sacerdoce et le sélectionner et le former sous les pressions exercées par
l'armée déchue et par les nations sous leur contrôle par la désobéissance.
Cependant, le processus de rédemption et d'enseignement est maximisé de
cette manière. Aucune théorie ne permettrait de renforcer les concepts de
dégradation et de destruction absolue de cette planète (qui se produisent
actuellement tous les jours) une fois que le processus a été mis en
mouvement. Aucune discussion avec l'armée rebelle n’aurait pu démontrer les
résultats illogiques et destructeurs de leur système de pensée polythéiste
ou d'existence extérieure à la volonté, la nature et l'amour Agape de Dieu.
De façon similaire, les systèmes humains atteignent des points de non-retour
au-delà desquels ils ne peuvent pas être atteints ou appelés à la repentance
en cet âge, et sont donc voués à la destruction afin de pouvoir être
rachetés dans de meilleures circonstances lors de la Deuxième Résurrection.
C'est pourquoi cette résurrection doit se faire dans la chair.
L’obscurcissement du
Plan du Salut et de la Résurrection est un autre obstacle à la bonne
compréhension du processus, tout comme le fait de considérer l'Armée Déchue
comme un ordre d'êtres grotesques. Satan et l'Armée Déchue se présentent
comme des Anges de Lumière, et il n'y a pas de différence dans leur
apparence, à l'exception possible de l'intensité. Ils ont adopté des formes
humaines et d’autres et apparaissent dans des visions.
La bataille menée
concerne l’esprit et les attitudes des humains, et afin d'éviter leur
utilisation abusive ou perte ils sont recyclés dans la chair lors de la
Résurrection. Ils n'ont pas la vie immortelle. Nygren a compris ce point
correctement quand il a dit :
L'Église antique diffère
surtout de l'Hellénisme dans sa croyance en la Résurrection. La tradition
chrétienne a affirmé la "Résurrection de la chair,"
que les Apologistes ont opposé à la doctrine hellénistique de l’"Immortalité
de l'âme." L'antithèse était consciente et intentionnelle, car à aucun
moment plus que celui-là leur opposition à l'esprit hellénistique n’était
ressentie par les premiers Chrétiens. La doctrine hellénistique
platonicienne de l'Immortalité de l'âme semblait aux Apologistes une
doctrine impie et blasphématoire, qu’ils devaient avant tout attaquer et
détruire.
(Justin, Dial. lxxx. 3-4)
Leur devise à cet égard
pourrait bien être la parole de Tatien : "L’âme humaine, en soi, n’est pas
immortelle, ô Grecs: elle est mortelle; mais cette même âme est capable
aussi de ne pas mourir.
(Tatien, Oratio ad Graecos, xiii. 1)
La différence entre
Chrétiens et non-Chrétiens dans cette affaire était si grande que la
croyance en la "Résurrection de la chair"
pourrait devenir un Schibboleth. Celui qui croit en l’"Immortalité
de l'âme" montre ainsi qu'il n'est pas un Chrétien. Comme le dit Justin :
"Si vous rencontrez certains qui sont appelés Chrétiens ... et qui disent
qu'il n'y a pas de résurrection des morts, mais que leurs âmes, quand ils
meurent, sont prises au ciel ; n’imaginez pas qu'ils sont Chrétiens". (Dial.
LXXX. 4) (ibid., p.281).
Ces deux questions
ci-dessus marquent clairement le point de démarcation entre la philosophie
Chrétienne et Pseudo-Chrétienne. Fait intéressant, le Pseudo-Christianisme
est dans l'écrasante majorité et ce, depuis au moins le sixième siècle,
peut-être le quatrième siècle.
La différence
philosophique fondamentale entre le Pseudo-Christianisme avec sa doctrine de
l’"Immortalité de l’Âme", et celle du
Christianisme antique et sa doctrine de la
"Résurrection de la Chair", c'est que la doctrine de l'Âme est égocentrique et la doctrine de la
Résurrection de la Chair est théocentrique. Il doit donc y avoir des
contradictions entre les objectifs déclarés du système et son explication et
l'interprétation du récit biblique qui ne supporte pas ses prétentions et
sur lequel le système est prétendument fondé. L’étude biblique détaillée
par conséquent exposerait le conflit philosophique aussi bien que
substantif.
La doctrine de l'âme se
trouve dans le Timée de Platon, où il est dit que chaque âme est censée être
liée à sa propre étoile qu’elle quitte afin de s’incarner sur la terre et à
laquelle elle retourne à la mort (41d et suiv.). David Ulansey fait
référence à ces concepts dans l’ouvrage
The Origins of the Mithraic
Mysteries (Les origines des mystères de Mithra) (Oxford,
1989, pp. 86-87), où il dit :
Nous trouvons l'idée
pleinement développée dans le Empedotimus de Héraclide Pontique élève de
Platon, dans lequel la Voie Lactée est considérée comme le chemin des âmes
descendant et remontant à partir de l'incarnation. (Sur Héraclide Pontique,
voir Burkert,
Lore and Science,
pp. 366ff ; et Gottschalk,
Heraclides of Pontus,
pp. 98ff.) Ce concept d'immortalité astrale est devenu de plus en plus
répandu au cours de la période hellénistique jusqu'à ce que, dans le
jugement de Franz Cumont, à l'époque romaine, il était devenu l'image
prédominante de la vie après la mort. Selon Cumont, "bien que les souvenirs
et les survivances de la vieille croyance dans la vie de celui qui est mort
dans la tombe et la descente de l'ombre dans les profondeurs infernales
puissent avoir persisté, la doctrine qui prédominait désormais était celle
de l'immortalité céleste"
(Franz Cumont,
Oriental Religions in Roman Paganism
New York : Dover, 1956, p. 39). De manière significative, dans les textes
magiques et gnostiques, nous constatons que le voyage de l'âme à travers les
sphères célestes a été considéré comme dangereux et que les pouvoirs astraux
avaient besoin d’être apaisés à chaque étape. (Voir par exemple la section
Mithras Liturgy, dans Meyer, Ancient Mysteries,
pp. 211-21.)
Il est particulièrement
intéressant de noter que cette conception de l'immortalité astrale est
explicitement mentionnée par le père de l'église Origène (citant l'auteur
païen Celse) comme ayant été une doctrine de Mithra. Selon Celse, dans les
Mystères de Mithra, il y a un symbole des deux orbites dans le ciel, l'une
étant celle des étoiles fixes et l'autre qui est attribuée aux planètes, et
du passage de l'âme à travers elles. Le symbole est cela. Il y a une échelle
avec sept portes et à son sommet une huitième porte. (Origène,
Contra Celsum,
p. 334 (6.22)). En outre, le néo-platonicien Porphyre attribue au Mithraïsme
une conception complexe de descente et d’ascension céleste de l'âme dans et
en dehors de l'incarnation.
Ce concept reprend la
tromperie adamique de
"sûrement vous ne mourrez
pas" à travers les Mystères babyloniens et leur rétablissement chez les
Indo-Aryens et avec les Grecs et les Orientaux. C'est une philosophie
systématiquement égoïste qui est de plus en plus polythéiste et qui
différencie de plus en plus l'adhérent de toute implication théocentrique
rationnelle. En fin de compte la réorientation égocentrique devient néfaste
pour le système, et les incohérences s’amplifient et sont finalement source
de division.
Intellectuellement, le
processus s'effondre dans l’Égoïsme Psychologique et l'Hédonisme, qui sont
gravement incohérents. Tout système basé sur les perceptions et les
comportements égocentriques et qui poursuit la maximisation de l'utilité
individuelle ne parvient pas, à long terme, à maximiser l'utilité.
Ces formes de pensées
polythéistes peuvent donner lieu à un théocentrisme illusoire en ce qu'une
forme de théocentrisme peut se manifester à partir des objectifs
égocentriques résultant dans le syndrome du "Faux Messie", que nous avons vu
à plusieurs reprises manifesté depuis l’établissement de ces doctrines à
grande échelle. Ces doctrines sont logiquement opposées à la centralité de
Dieu, et tout Théiste est logiquement obligé de s'y opposer. Autrement dit,
vous ne pouvez pas croire à l'immortalité de l'âme et logiquement être un
Monothéiste.
4:7 La
Mécanique de la Spiritualité Humaine
Le développement de
la notion de l'âme s’est poursuivi pendant de nombreux siècles et deux
œuvres récentes soutiennent que c’est le corps de la philosophie
matérialiste qui affecte la Doctrine de l'Âme.
Celles-ci sont de
Rodney Cotterill (No Ghost in the Machine, Heinemann) et Michael
Lockwood (Mind, Brain and the Quantum, Blackwell).
Cotterill s’intéresse
aux études de Benjamin Libet, qui semblent montrer que notre cerveau prend
des décisions à notre place avant que nous n’en soyons conscients. Cotterill
soutient que ceci démolit effectivement le libre arbitre. Il est difficile
d'établir logiquement pourquoi la prise de décision subconsciente devrait
empêcher le libre arbitre, en particulier lorsque les hypothèses sont faites
que les gens agissent de façon responsable, même s’ils ne sont pas libres.
L'analyse par Lockwood
vise à établir la pertinence de la mécanique quantique et de la relativité
de la fonction cérébrale. Le problème est qu'il n'y a pas de raison évidente
pour que l’activité complexe du cerveau donne lieu à des expériences
conscientes.
Les philosophes
matérialistes ont beaucoup de difficulté à établir une explication
rigoureuse de ces événements. Au fur et à mesure que la théorie biologique
et scientifique avance conjointement avec la philosophie, cela devient de
plus en plus évident que la Doctrine de l'Âme n'a aucun fondement dans la
réalité. La Philosophie Matérialiste, peu importe sa réussite dans la
réfutation de l'existence de l'âme, ne peut pas, ce faisant, réfuter le
Christianisme biblique, mais confirme plutôt l'un des principes de base du
Christianisme, à savoir que l'individu meurt et qu'il n'y a pas d'âme et pas
de vie sans la résurrection, que ce soit la première ou la deuxième. Ce que
ces auteurs parviennent à faire c’est de confirmer le fait que la Théologie
chaldéenne est erronée.
D. M. Armstrong (A
Materialist Theory of the Mind, Routledge and Kegan Paul, London, 1968,
pp. 49-53) mentionne la difficulté pour toute Théorie non Matérialiste de
l'Esprit telle qu’elle a été envisagée par J.J.C. Smart.
La difficulté pour la
théorie non-matérialiste est prétendument qu'il semble de plus en plus
probable que la biologie soit complètement réductible à la chimie qui, à son
tour, est complètement réductible à la physique, de sorte que tous les
événements chimiques et biologiques sont explicables en principe en tant
qu’applications particulières des lois de la physique qui gouvernent les
phénomènes non biologiques et non chimiques. Le non-matérialiste est alors
confronté à sauver l'esprit de cette position en le considérant comme la
seule exception. L'argument d'Armstrong de la Suprématie de la Physique pour
la contestation d'une Théorie Non-Matérialiste de l'Esprit repose sur quatre
points, résumés ainsi : -
1. La science empirique
devrait influencer de manière persuasive les arguments philosophiques
lorsqu'elle fournit des objections aux théories non-Matérialistes ;
2. La Science devrait
l'emporter sur des considérations religieuses, morales, artistiques ou
philosophiques, puisque seule la science permet de trancher les questions en
litige ;
3. La recherche
psychique soulève un doute réel quant à la suprématie de la science ; et
4. Les qualités ou sens
secondaires, s’ils sont irréductibles aux propriétés des objets dont se
préoccupe la physique, exigent des lois de corrélation supplémentaires ;
toutefois, les preuves scientifiques donnent des raisons de soupçonner que
ces propriétés ne sont pas en fait irréductibles.
Il est évident, à partir
des concepts de causalité traitée plus tôt, que cet argument repose sur les
prémisses de causalité survenante que Hume, par spécificité, et Tooley, en
général, auraient réfutées en termes précédemment énoncés. Penrose démolit
efficacement la suprématie de la physique dans l'interprétation du
fonctionnement de l'univers en raison d'effets tels que les effets
non-locaux simultanés (à savoir le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen
[EPR]) (Penrose, op. cit., pp. 361-9,578). Penrose et
la science en général sont logiquement obligés de procéder au prochain saut
dans la compréhension humaine par l'analyse métaphysique.
Le Théisme de la Non-Âme
affirme que le cerveau humain est un organisme animé qui retourne à la
poussière, c’est-à-dire qu’il est chimique dans sa construction. Il est fait
valoir que cette image du spirituel ou de l'invisible permet la
superposition d'un organisme spirituel. C'est ainsi que l’Esprit Saint peut
être superposé, mais aussi, puisque ces entités de l'armée déchue sont de la
même structure spirituelle, alors elles aussi peuvent être superposées au
système humain, d'où la possession. Parce que ces propriétés ou entités sont
métaphysiques, il s'ensuit que la science empirique, par conséquent, ne
pourra pas les observer ou les détecter d'une manière physiquement
vérifiable, comme Popper l’a si bien démontré dans une analyse simple
ci-dessus.
Les aspects
métaphysiques de phénomènes historiques n'ont pas été réglés par la science,
mais plutôt la science démontre occasionnellement et avec beaucoup d'erreurs
les affirmations bibliques vieilles de plusieurs millénaires.
Le Théisme de l’Âme peut
être réfuté par l'explication philosophique tel qu’indiqué ci-dessus, à
savoir que le Théisme de l’Âme et le Dualisme Cartésien sont des formes
élitistes de Polythéisme, et donc nécessairement incompatibles avec le
Monothéisme. L'existence d’entités duelles est également exclue de la
logique épousée il y a aussi longtemps que Tertullien (Contre Marcion, Livre 1). Au chapitre V, il affirme que :
Quel que soit le
principe qui refuse d'admettre plusieurs êtres suprêmes ; celui-ci doit en
rejeter même deux, car il y a pluralité dans le plus petit nombre après un.
Cette question est
traitée dans la section sur les Sorites et l'Argument de Continuité
ci-dessus. Au chapitre III du Livre 1, Tertullien déclare que Dieu est
suprême et unique. Il n'a pas d'égal. "Dieu n'est pas, s'Il n'est pas un."
Tout autre Dieu introduit n'est pas en mesure de maintenir sa divinité "sous
aucun autre prétexte, qu’en lui attribuant aussi la propriété de la
divinité." Au chapitre VII, Tertullien montre que "d'autres êtres en dehors
de Dieu sont appelés Dieu dans les Saintes Écritures", et que l'objection de
Marcion sur ce point est "une objection stupide," parce que le vrai problème
est que l’essence seule est éternelle et le créateur de toutes choses. Son
attribut de suprématie est dérivé de son état et de sa condition. (The Ante-Nicene Fathers Les Pères d’Avant
Nicée, Vol III, T. & T. Clark Eerdmans, Michigan, Mai 1986, pp. 272-276)
C'est à partir de ces
concepts que la position biblique est établie que la rébellion est comme le
péché de divination [ou de sorcellerie] (1Samuel 15:23), en ce que par la
rébellion contre l'unité de Dieu l'entité est séparée en volonté et de là
logiquement polythéiste.
La compréhension de
Tertullien du rôle de l'essence Divine, cependant, ne l'a pas sauvé des
erreurs de la doctrine de l'âme. Dans son traité sur l'âme, il comprend que
l'âme existe à partir de la naissance, mais qu’elle doit
"naître de nouveau en Christ." (A
Treatise on the Soul, Ch. XL, ibid., p. 220).
La doctrine de l'Âme est
incohérente à plusieurs égards :
1. Elle est
ontologiquement trop compliquée et donc peu pratique ;
2. Elle place une
différenciation dans le domaine immatériel qui rend la position par rapport
aux anges divisible et ainsi contraire à l'unité de l'Essence ;
3. Elle permet une
division spirituelle dans des entités irrationnelles ou immatures.
L'action de l'esprit est
analysable en termes de certaines fonctions chimiques ; toutefois, la
superposition de l'Essence Divine sur le Nephesh (ou l'esprit de l'homme)
est évaluable seulement comme une croyance perceptuelle où l’"exposition
d'une capacité pour un tel comportement sélectif est toute la preuve
nécessaire pour dire que le percepteur a acquis la conviction particulière."
(Armstrong, p. 340). Armstrong soutient que
"les croyances non-perceptuelles peuvent être conçues comme des extensions
du
‘schéma’ de la perception." Il note que certains états ne doivent pas être
actuellement causalement actifs dans l'esprit, et en cela, les concepts de
causalité sont comme indiqué ci-dessus (ibid., pp. 341 et al.).
Armstrong admet que la
pensée non-perceptuelle est finalement théorique et de là, les relations
causales sont exposées aux arguments de causalité singulariste mentionnés
ci-dessus. Il soutient en outre que les lignes de pensée qui ont un objet,
c'est-à-dire qui ont un but, sont "initiées et soutenues par une cause
mentale qui leur est extérieure" (ibid., p. 350). Il poursuit cependant en
soutenant que les événements mentaux ne sont rien
"que des événements physico-chimiques dans le
système nerveux central" (ibid., p. 351). Il dit aussi (ch. 17, p. 355) que
rien de ce qu'il a dit jusqu’ici (dans la Deuxième Partie) "n’impliquait la
vérité d'une théorie matérialiste de l'esprit."
En avançant
l'identification des occurrences mentales avec les états physico-chimiques
du système nerveux central, Armstrong note que :
1. L'identification peut
être résistée au motif que ces processus ne sont pas suffisants pour
expliquer l'ensemble du comportement humain, et
2. On peut admettre que
ces processus sont suffisants pour expliquer le comportement humain, mais
l'identification de l'esprit et du cerveau peut encore être résistée pour
d'autres raisons.
Les objections de la
première sorte, dit-il "semblent être intellectuellement sérieuses, celles
de la seconde sorte intellectuellement frivoles". Armstrong classifie la deuxième classe comme celle de manifestations
‘paranormales’. Il procède à la question de savoir si les processus
physico-chimiques sont entièrement responsables des comportements.
Il reconnaît que la
découverte intellectuelle et la création artistique posent les plus grandes
difficultés aux matérialistes, et dans la section sur les causes ci-dessus,
il a été démontré que les idées sont simultanées et externes.
Correctement, on
considère que les objections aux explications matérialistes peuvent être :
a. il est empiriquement
impossible pour un mécanisme physique de produire de telles manifestations ;
et
b. même si une telle
possibilité était accordée, le corps humain ne dispose pas d’un tel
mécanisme.
Un contre-exemple de
cela est que la technologie permettra de réduire les obstacles de
reproduction des puissances supérieures par une machine. Là où une telle
machine est capable de reproduire toute la gamme des pouvoirs humains, on
pourrait faire valoir qu’un tel mécanisme n’existe pas, en fait, dans le
corps humain. La machine, cependant, devrait être non-algorithmique avec des
capacités qui ont été détachées, simultanées, et non locales, telles
qu’isolées par Penrose.
Armstrong postule une
possibilité de compromis se situant entre le matérialisme physico-chimique
pur et une Théorie de l'Esprit fondée sur les Attributs :
Il est possible
d'affirmer que l'ensemble du comportement de l'homme découle causalement de
processus physiques dans son système nerveux central, mais pour dire cela
certains au moins de ces processus physiques ne sont pas le genre de chose
qui peut être expliqué en termes de lois de la physique et de la chimie
(ibid., p. 358).
et de ces processus
fonctionnant selon les lois
‘émergentes’ :
Il se produit un
comportement qui ne pourrait pas être produit en travaillant selon des
principes purement physico-chimiques. Un tel point de vue serait toujours un
Matérialisme, car il n’exigerait pas des qualités émergentes et encore moins
une substance émergente, mais il ne s’agirait pas d’un Matérialisme
physico-chimique. (ibid.)
L'hypothèse repose sur
le fait que ces lois émergentes sont quelque chose qui s'est développé dans
tous les systèmes physiques qui ont atteint un certain degré d'interrelation
complexe. Isoler cet aspect, c’est isoler ce que la Bible appelle nephesh,
et est distinct de toute composante spirituelle qui doit nécessairement être
non-essentielle et théomorphique.
Ce qu’Armstrong
préconise en fait est un système physique qui ne peut pas être pris en
compte par les lois de la physique ou de la chimie, y compris les structures
biologiques, et fonctionnant selon un système de causalité utilisant des
relations théoriques. Ces relations doivent être telles que décrites
logiquement par Tooley dans son dernier ouvrage sur la Causalité
Singulariste. Telle est la position que Penrose tente peut-être de décrire.
Plus important encore,
le Théiste de la Non-Âme avance des arguments similaires, à ceci près que
l'influence des idées sur l’ideatum est contrôlée par des entités
spirituelles qui régissent ou renforcent les perceptions des concepts du
bien et du mal et l’initiative de la progression conceptuelle.
Il y a donc trois
structures :
i)
le nephesh humain ;
ii)
la
loi fondée sur des relations théoriques ;
iii) le
spirituel qui comprend :
(a) l'Essence Divine ; et
(b) les agents qui se composaient de l'Essence Divine, et qui sont
maintenant dans la désunion.
Penrose dit (p.538)
qu’il
"semble y avoir quelque
chose sur la façon dont les lois de la physique fonctionnent qui permet à la
sélection naturelle d’être un processus beaucoup plus efficace qu’il ne le
serait avec des lois simplement arbitraires." Ce mécanisme de régulation de
ce qu'il appelle
"intelligent groping" (tâtonnement
intelligent) pourrait bien être un mécanisme de régulation des relations
théoriques ; toutefois, cela n'entraîne pas l'évolution et le relativisme.
Les Matérialistes peuvent progressivement isoler les éléments
physico-chimiques du Nephesh et ils peuvent empiriquement observer le
fonctionnement de certains aspects de la loi, y compris les conséquences de
sa violation, mais ils ne peuvent pas et n’isoleront pas les éléments
spirituels, car ces derniers peuvent être discernés seulement
spirituellement, étant non-matériels et essentiellement non-algorithmiques,
de là métaphysiques et démontrables que par la logique. Armstrong n'isole
pas complètement les objections à l'intelligence artificielle, et il revient
à Penrose d’expliquer la nature non-algorithmique de la pensée consciente
(pp. 538 et suivantes).
Richard Swinburne fait
valoir dans son ouvrage
The Evolution of the Soul
(Oxford Clarendon, 1986, pp. 174 et suivantes)
que
"on peut dire que l’âme
fonctionne quand elle a des épisodes conscients, (c.-à-d. des sensations,
des pensées ou des intentions). Les données de la neurophysiologie et de la
psychologie suggèrent plus puissamment que le fonctionnement de l'âme dépend
du fonctionnement du cerveau. "À partir de la recherche scientifique moderne
de l'activité du sommeil, il a été démontré qu’"il y a des périodes de sommeil profond durant lesquelles l'homme n'est
pas conscient du tout ; le rythme électrique du cerveau est cette
caractéristique de l'inconscience ; le fonctionnement de l'âme dépend du bon
fonctionnement du cerveau ; compte tenu de cela, ce qu’indique en outre la
physiologie est bien sûr qu'il n'y a pas de vie consciente avant un certain
moment entre la conception et la naissance ; la preuve suggère que la
conscience naît lorsque le fœtus a un cerveau" (ibid., pp. 175-6).
Swinburne poursuit en
disant :
Ce que j'ai fait valoir
jusqu'ici c’est que sans un cerveau qui fonctionne, l'âme ne fonctionnera
pas (c'est-à-dire qu’elle n’aura pas des épisodes conscients) ; et non pas
qu’elle n’existerait pas. Mais qu'est-ce que cela signifie de croire que
l'âme existe à un moment donné sans fonctionner ?
Il estime que c’est
clair dans le cas de la substance matérielle, mais pas "du tout clair dans
le cas de l'âme, une substance immatérielle" (ibid.).
Ce que Swinburne fait
ici c’est avancer une explication qui modifie la perception traditionnelle
de la doctrine de l'âme, limitant la fonction à la conscience et à
l'existence inactive dans l'inconscience. Penrose démontre que le cerveau
fonctionne effectivement de manière subconsciente ; toutefois, ce niveau de
pensée est automatique et non conceptuel. L'existence de l'esprit après la
mort d'une manière inopérante est une affirmation biblique qui distingue
subtilement les élus des hommes en général.
Cela semble incohérent d'affirmer qu'une entité existe sans une fonction,
sauf pendant la durée d'une vie humaine consciente, et qu’elle existe
ensuite immatériellement sans fonction comme une entité séparée. Cela semble
en outre être un non-sens incohérent d'affirmer, sur ces éléments de preuve,
l'existence du paradis, de l'enfer et/ou du purgatoire en tant que
dépositaires pour une telle entité. L'existence d'entités spirituelles
ailleurs dans ce qu'on appelle "les cieux" se différencie des concepts
ci-dessus attribués comme les demeures d'une âme.
Ce que Swinburne est en
train de traiter, c’est le concept du Nephesh et la nécessité de la
résurrection physique des morts comme un ideatum d'une idée dans l'esprit de
Dieu. Le concept selon lequel l'Essence Divine est le dépositaire des fils
spirituels de l'adoption, et la pensée de Dieu des fils physiques de la
Deuxième Résurrection, qui atteindront plus tard le même statut, est
développé à partir de ceci, l'esprit de l'homme. De ce qui précède, lorsque
le cerveau est mort, vous ne fonctionnez pas. Il n'y a pas d’âme en cours.
Cependant, le sang est la vie du nephesh pas le cerveau, et ceci a conduit à
une autre erreur fondamentale dans la catégorisation de la vie et de la mort
dans des domaines qui ne sont pas liés à ce sujet.
De ce qui précède, il
n'y a pas de vie après la mort jusqu'à la résurrection, soit la première au
début du millénaire (Millenium) soit la deuxième à la fin de celui-ci
(Apocalypse 20:4 et suivants). Le concept de l'Omniscience de Dieu
déterminant la vie de l'homme et la durée de ses jours est nécessaire au
concept de la résurrection. L'Omniscience de Dieu est décrite au Psaume 139,
notamment au verset 16 :
Tes yeux voyaient ma
substance informe :
Et sur ton livre ils
étaient tous inscrits,
Même les jours qui
m'étaient destinés,
Avant qu’aucun d’eux
n’existât. (ASV)
Le fait que
l’omniscience et le décret des jours n'entraînent pas l'élimination du libre
arbitre et de la responsabilité morale par le déterminisme est traité
ci-dessous. La tentative de limiter Son omniscience en affirmant que Dieu
sait seulement ce qui peut être connu, tentant ainsi de façon simpliste de
permettre le libre arbitre et la responsabilité de l’homme, est
intellectuellement frivole. L'affirmation selon laquelle Dieu choisit
délibérément de ne pas savoir certaines choses afin de permettre le libre
arbitre est une affirmation beaucoup plus grave. Cette affirmation,
cependant, est incohérente également, puisque la décision est une vraie
proposition et fait partie d'une série connue que Dieu doit nécessairement
savoir pour être en mesure de choisir de ne pas connaître. L'affirmation est
essentiellement une position trinitaire pour maintenir le schéma et la
bi-déité du Christ à la lumière de son propre aveu de non-omniscience.
La résurrection est une
démonstration de l'omniscience et de l'omnipotence absolues de Dieu. La
Doctrine de l'Âme est une tentative d'échapper à l'inconfort de Son
omniscience et à l'obéissance requise par Son omnipotence.
L'omniscience de Dieu
ici a été développée par les néo-platoniciens en tant que l’extension de Sa
pensée et de Son être comme Son produit de copie basée sur une théorie
émanationniste de la matière où la matière et le mal sont au plus bas de
l'échelle. Appelé le
(<@LH) nous, il a reçu à partir de l'absolu le pouvoir de création, même pour les
idées des choses individuelles. Le
nous tend à la transcendance dans la contemplation de Dieu, mais aussi
se penche vers la terre et crée le Logos
(7@(@H), l'âme du monde qui en
découle comme elle découle du Dieu transcendant. Cette théorie
d’émanationniste est jugée similaire au modèle biblique, mais en fait elle
en est tout à fait distincte.
Chaque corps en
particulier est constitué de la matière et possède son propre logo
particulier qui ne joue pas mécaniquement sur la matière, mais à travers
le concept (ou organiquement) par les (7@(@4) Logoi, le Logos forme ou produit la matière, la matière n’étant jamais
vraiment sans forme. Cependant, les (7@(@4)
Logoi n'agissent pas consciemment et
délibérément. Les Logoi activistes constituent les éléments essentiels de la
semence et expliquent les différences entre les divers organismes ("Pantheism" dans
E.R.E., Vol. 9. p. 616).
Dans le modèle biblique
tous les animaux possèdent le nephesh ou la programmation physico-chimique
et intuitive pour la vie ; cependant, seul l'homme est l'image des Elohim et
de là capable de pensée rationnelle et d'animation spirituelle. Bien que
Konrad Lorenz ait montré (1972) que les chimpanzés sont capables
d'inspiration authentique (Penrose, op. cit., p. 551), les degrés relatifs
de la rationalité sont importants. L’explication postérieure traitera de
cette question.
La division de la
matière est à la base une structure subatomique où elle devient incapable de
description dans n’importe quel sens matériel. Le monde matériel est conçu
pour être sollicité par le spirituel et pour être temporaire et transitoire.
Il n'y a aucune vie possible après la mort dans le modèle biblique et
l'animisme des systèmes chaldéens lui est refusé.
4:8
Une Tentative d'Explication de l'Esprit
Pour expliquer l'action
de l'esprit et de la pensée, nous devons nous pencher sur certains concepts
énoncés plus tôt.
Tout d'abord, Einstein a
développé le concept selon lequel le Temps, l'Espace, la Masse, l'Énergie,
la Pensée et la Gravité sont des expressions équivalentes d'une seule
essence fondamentale. Ce concept semble s'accorder avec un certain nombre de
conditions préalables bibliques qui peut s'énoncer comme suit : -
a. Les entités
prétendument spirituelles ne sont pas confinées par les limites de la
physique dans le sens où elles peuvent agir en utilisant la gravité,
l'énergie, la masse, l'espace et le temps, et par la pensée, affecter et
agir sur les autres aspects de l'existence qualifiés de physiques.
b. Ces entités ont un
effet non local et interrelationnel sur les entités physiques, à la fois
humaines et non-humaines.
c. La singularité connue
sous le nom de Dieu, responsable d’être à l'origine de l'univers physique,
avait un degré de précision dans la construction qui nécessitait une
omniscience absolue, telle qu’une précision absolue de sélection du volume
espace des phases était présente, et une connaissance absolue de la réaction
physique de telle sorte qu'aucune vraie proposition ne pouvait être ignorée.
Penrose (The Emperor’s New Mind,
p. 436) traite des théorèmes de singularités (cf. Penrose 1965, Hawking
et Penrose, 1970). Il souligne qu'il existe deux singularités, à la fois un
type initial dans lequel l’espace, le temps et la matière sont créés, et un
type final dans lequel l’espace, le temps et la matière sont détruits. En
outre, quand les types sont examinés en détail, on constate qu'ils ne sont
pas des inversions temporelles exactes l'un de l'autre ; les "différences
géométriques sont importantes à comprendre, car elles contiennent la clé de
l'origine de la seconde loi de la thermodynamique."
Penrose dit (à la p.
439) que "pour une raison quelconque l'univers a été créé dans un état de
faible entropie très spécial. Si ce n'était pas pour une contrainte de cette
nature, il serait
‘beaucoup plus probable’ d'avoir une situation dans laquelle deux singularités initiales et
finales étaient de type WEYL à haute entropie. Dans un tel univers
‘probable’ il n’y aurait, en effet, pas de seconde loi de la thermodynamique !"
Pour créer un univers
doté d’une faible entropie suffisante pour assurer le fonctionnement de la
seconde loi de la thermodynamique, le Créateur aurait choisi un volume
espace des phases qui était particulier à une précision d'une partie de
1010123. Il dit :
Cela nous dit maintenant
à quel point le but du Créateur doit avoir été précis : à savoir avec une
précision d'une partie à
1010123.
C'est un chiffre extraordinaire. On ne pourrait possiblement pas même écrire
le nombre en son entier dans la notation dénaire ordinaire : cela serait '1'
suivi par
10123
‘0’ successifs.
Même si nous devions écrire un '0' sur chaque proton séparément et sur
chaque neutron séparément dans l'univers entier ; et si nous pouvions
ajouter toutes les autres particules pour faire bonne mesure ; nous serions
encore loin d'écrire le chiffre nécessaire. (ibid.)
Le même ordre de
grandeur d'accident pour une initiation évolutionniste non-créationniste
s'applique. Pour Penrose :
La précision nécessaire
pour la mise en route de l'univers est considérée en aucun cas être
inférieure à toute cette précision extraordinaire à laquelle nous avons déjà
été habitués dans les superbes équations dynamiques (de Newton, de Maxwell,
d’Einstein) qui régissent le comportement des choses d’un instant à l’autre.
La singularité initiale
de l’espace-temps (c’est-à-dire ce qu’on appelle le big bang) est
précisément organisée, c'est-à-dire où WEYL = 0, alors que le trou noir ou
les singularités finales de l'espace-temps seraient censées être totalement
chaotiques. Penrose considère que tel est le cas, car il y a une contrainte
sur les singularités spatio-temporelles initiales, mais pas sur les
singularités finales formulées en termes de comportement de la tension de
WEYL de la courbe de l'espace-temps aux singularités de l'espace-temps de
telle sorte que WEYL
®
¥ .
Penrose considère que
"cela semble être ce qui limite le choix du Créateur à cette même petite
région de l'espace des phases." Il appelle cela l’Hypothèse de la Courbe de
Weyl.
"Nous avons besoin de
comprendre pourquoi une telle hypothèse de temps asymétrique devrait
s'appliquer si nous voulons comprendre d’où vient la deuxième loi."
Penrose voit la
nécessité de comprendre pourquoi les singularités spatio-temporelles ont les
structures qu’elles semblent avoir, mais déplore l'impasse, comme les
singularités spatio-temporelles sont des régions où notre compréhension a
atteint ses limites. Il soutient que, tout comme la théorie quantique a
anticipé le comportement singulier de l'effondrement électromagnétique des
atomes, de même elle doit donner une solution finie à l'infini problème de
singularités de l'espace-temps. Cependant, comme le dit Penrose,
"il ne peut y avoir une théorie Quantique
ordinaire." (ibid., p. 446-7).
Au risque d'être banal,
je vais tenter de contribuer à la position actuelle, et j’espère ajouter à
l'hypothèse proposée par Penrose.
Il est convenu que la
nécessité de prendre en considération les effets gravitationnels dans la
Mécanique Quantique est considérée à tort comme inutile par les physiciens,
mais (contrairement à Penrose) pas à partir d'une connaissance précise des
effets de la Gravité Quantique aux échelles
‘ordinaires’ (10-12 m) par opposition à celles de longueur de Planck (10-35m).
Penrose considère que la plupart des physiciens soutiendraient que sur une
échelle pertinente pour notre cerveau les effets physiques de toute la
gravité quantique doivent être totalement insignifiants (ibid., p. 451).
Penrose affirme qu’"En effet, même la gravité classique (c’est-à-dire
non-quantique) n'a presque aucune influence sur ces activités électriques et
chimiques. Si la gravité classique est sans conséquence, alors comment une
toute petite
‘correction quantique’ à la théorie classique pourrait-elle faire la
moindre différence ? Par ailleurs, puisque les écarts par rapport à la
théorie quantique n'ont jamais été observés, il semblerait être encore plus
déraisonnable d'imaginer qu'un petit écart putatif de la théorie quantique
standard pourrait avoir un rôle à jouer concevable dans les phénomènes
mentaux !" (ibid. p. 451).
Penrose adopte le point
de vue non conventionnel selon lequel la théorie de l’espace-temps
d'Einstein a un effet sur la structure même de la Mécanique Quantique, et
que les difficultés apparemment insurmontables que pose l'application des
règles de la Théorie Quantique à la théorie d'Einstein ne devraient pas
entraîner une modification de celle-ci, mais l’inverse, et qu’elles
devraient en fait modifier la Théorie Quantique.
Les raisons en sont des
problèmes de logique, et non de mathématiques ou de physique, qui relèvent
donc de la compétence d'humbles philosophes.
Aux pages 322 à 323,
Penrose traite des procédures d'évolution appelées U et R pour décrire le
temps de développement d'un paquet d'ondes. L'équation de Schrödinger nous
indique comment la fonction d'onde évolue effectivement dans le temps. Plus
tôt, nous avons évoqué l'échec de Heisenberg de purger la Mécanique
Quantique d'éléments métaphysiques, ces derniers appelés le Principe
d'Incertitude. Les paquets d'ondes sont des tentatives de localisation des
particules dans l'espace, à la fois en termes de position et de quantité de
mouvement, et constituent la meilleure approximation d’une particule
classique dans la Théorie Quantique. Penrose soutient que dans l'état U
(considéré comme décrivant la
‘réalité’
du monde), il n’y a pas
d’indéterminisme qui est censé être une caractéristique inhérente à la
Théorie Quantique, puisque la probabilité de trouver des particules à une
quelconque partie est la même qu’un autre régi par l'évolution déterministe
de Schrödinger. Il soutient que lorsque "nous effectuons une mesure, en
magnifiant les effets quantiques au niveau classique, nous changeons les
règles." La procédure U n'est pas utilisée, mais plutôt la procédure tout à
fait différente, que Penrose appelle R, "formant le module au carré des
amplitudes quantiques pour obtenir les probabilités classiques ! C'est la
procédure R, et seulement R, qui introduit des incertitudes et des
probabilités dans la théorie quantique. Le processus déterministe U semble
être la partie de la théorie quantique qui préoccupe le plus les physiciens
en activité, mais les philosophes sont plus intrigués par la réduction
non-déterministe du vecteur d’état R (ou comme c’est parfois décrit
graphiquement, par "l’effondrement de la fonction d'onde)" (ibid., pp. 323-324).
Penrose soutient que R
n'est pas simplement un changement dans les connaissances disponibles sur un
système, mais plutôt quelque chose de réel. Les deux systèmes sont
‘des
façons mathématiques complètement différentes
dans lesquelles le vecteur d'état d'un système physique est décrit comme
changeant avec le temps. Car U est totalement déterministe, alors que R est
une loi probabiliste : U maintient la superposition quantique complexe, mais
R la viole grossièrement ; U agit d'une manière continue, mais R est
manifestement discontinu (ibid., p. 324).
R ne peut pas être
déduit comme un exemple complexe de U. Il est tout simplement une procédure
différente de U qui fournit l'autre
‘moitié’
de l'interprétation du formalisme quantique : "tout le non-déterminisme
de la théorie vient de R et non de U. U et R sont tous deux nécessaires pour
tous les accords merveilleux que la théorie quantique a avec les faits
d'observation" (ibid.).
Dans le cas d'un état
dynamique, il le restera à condition que la particule n'interagisse avec
rien. La prévisibilité est évidente comme ça l’est au niveau de la théorie
classique. Ce n'est que lorsque la
‘mesure’
ou agrandissement au niveau classique est tentée que les probabilités
sont nombreuses et il existe une incertitude en accord avec un tableau de
probabilité d'amplitude, dont nous devons cadrer les modules (ibid.). C'est
en essayant d'obtenir une mesure de la position ou de la quantité de
mouvement que les incertitudes se produisent.
Penrose souligne la
conviction d'Einstein que la Théorie Quantique était au mieux provisoire.
Einstein a dit dans sa réponse à l'une des lettres de Max Born en 1926
(citée dans Pais 1982 p. 443, citée de nouveau ibid. p. 361) :
"La Mécanique Quantique est très impressionnante. Mais une voix intérieure
me dit que ce n'est pas encore la vraie chose. La théorie produit une bonne
affaire mais nous rapproche à peine du secret de l'Ancien. Je suis en tout
cas convaincu qu'Il [Dieu] ne joue pas aux dés."
Plus encore que
l'indéterminisme physique, c’est un manque apparent d'objectivité qui a le
plus troublé Einstein. Penrose considère que la théorie est vraiment
objective, bien que souvent étrange et contre-intuitive. Bohr, par ailleurs,
"semble avoir considéré l'état quantique d'un système (entre les mesures)
comme n'ayant pas de réalité physique réelle, agissant comme un simple
résumé de
‘la connaissance d’untel’
concernant ce système"
(ibid., p.362).
La fonction d'onde est
donc quelque chose d'essentiellement subjectif. Pour préserver l'image
physique du monde, le monde classique, ou le monde au niveau classique, a
été considéré par Bohr comme d'ailleurs ayant une réalité objective, mais il
n'y avait pas de
‘réalité’ dans les états de niveau quantique qui ‘semblent sous-tendre le tout’ (ibid.). Einstein pensait que c'était
odieux et qu'il doit y avoir un monde physique objectif et qu'il y avait une
structure encore plus profonde sous la théorie quantique. Il n’a pas pu
démontrer qu'il y avait des contradictions inhérentes à l'image quantique
des choses. Ses disciples, en particulier David Bohm, ont développé le point
de vue des variables cachées. Penrose retient qu'une théorie des variables
cachées peut être cohérente avec tous les éléments observables de physique
quantique, mais seulement si la théorie est essentiellement non-locale, en
ce sens que les paramètres cachés doivent être en mesure d'influer sur les
parties du système dans les régions arbitrairement éloignées instantanément
(ibid.).
Nous avons vu que les
effets non-locaux simultanés ont d'abord été rencontrés dans l'expérience
d'Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) connue sous le nom de paradoxe EPR.
Les versions de Bohm du Paradoxe EPR ont rendu la situation plus claire,
mais il ne s’agissait encore que d’une expérience de pensée. C’est le
document de John Bell, publié en 1964, qui a permis la percée conceptuelle
qui a conduit à un test pratique. Le test de Bell mesure la rotation de
particules telles qu’un électron ou un proton de façon indépendante dans
trois directions à angle droit les unes des autres. La complication
apparente de la procédure est ce qui, en fait, rend possible le test.
Ce que Bell a montré en 1964, c’est que les mesures des spins, c'est à dire
les directions X Y et Z orthogonales d’un grand nombre de particules
réelles, pourraient en principe faire la distinction entre les mécanismes
sous-jacents et l'action à distance. L'expérience ne peut pas, cependant,
connaître les trois composantes de spin pour la même particule en même temps
en raison de l'incertitude quantique (à partir de l'expérience de Heisenberg
ci-dessus), bien que n'importe laquelle d'entre elles puisse être mesurée
avec précision. Comme dans toutes les mesures quantiques, nous avons affaire
à des probabilités. Bell est tenu d'avoir mis en évidence la différence
entre la réalité classique et la réalité quantique. Les Inégalités de Bell
disent que si Einstein avait raison et que les particules avaient réellement
un spin intrinsèque en permanence, alors dans une expérience de type Bohm
sur de nombreuses paires de particules le nombre de paires de particules
dans lesquelles les deux sont mesurées pour avoir un spin positif à la fois
dans les directions X et Y (XY positif) est toujours inférieur au total
combiné des mesures, montrant les mesures XZ et YZ comme ayant toutes un
spin positif (XZ positif + YZ positif). L'argument de Bell a été fondé sur
l'hypothèse de la réalité sous-jacente classique. La violation des
Inégalités de Bell devrait logiquement démontrer que la Théorie Quantique
est correcte et l'action non-locale est un fait.
L'expérience d’Aspect
était la version définitive de plusieurs tentatives pour mesurer les
Inégalités de Bell. Bien qu’elle mesure la polarisation de paires de photons
plutôt que le spin des particules de matière, le principe est le même. Les
expériences d’Aspect réalisées dans les années 1980 ont éliminé le choix de
l’observateur en utilisant un dispositif de commutation automatique. Le
dispositif choisit au hasard quelle polarisation mesurer après que les
photons aient laissé l'atome, opérant en l’espace de 10 nanosecondes tandis
que les photons mettent 20 nanosecondes pour parcourir les 6,5 mètres qui
les séparent des analyseurs. (John Gribbin se réfère à cette expérience dans
"L'homme qui a prouvé qu’Einstein a fait erreur,"
New Scientist, No. 1744, 24 Novembre 1990, pp. 33-35.)
L'équipe chargée de
l'expérience a établi que les Inégalités de Bell sont violées et que
l'action à distance dans la Théorie Quantique est correcte. Il existe donc
un lien plus rapide que la lumière entre les particules séparées et
éloignées, et c'est cette interaction qui constitue la structure
sous-subatomique de l'univers et que l’on appelle
‘esprit’.
D’après Penrose, la mesure des particules fait effondrer la fonction d'onde
d'une position totalement déterministe (U) vers une position probabiliste
(R). Les changements aléatoires dans les états de particules pourraient donc
être tenus de rendre la communication plus vite que la lumière impossible.
En outre, il pourrait être considéré que le hasard est nécessairement
introduit dans le choix et les effets. Mais nous avons vu qu'il existe une
cohésion et un ordre dans la sélection et le maintien du système physique
d'un tel ordre que le hasard ou le chaos dans le système est logiquement
exclus. La sous-structure possède un caractère absolu de la sélection de
l'information et la réaction de telle sorte que la communication doit être
non seulement possible mais aussi exhaustive.
L'objection que Bell a introduite pour surmonter les conséquences du
caractère aléatoire de l'action non-locale est le déterminisme absolu dans
l'univers, ce qui implique l'absence totale de libre arbitre. Les
affirmations exigent que les actions d'un observateur soient absolument
prédéterminées de telle sorte que tout est prédéterminé, même la décision.
La sous-structure de communication plus rapide que la lumière peut ainsi
être évitée car il y a un système totalement déterminé (ce qui implique
également l'omniscience absolue).
Il y a alors un dilemme.
La seule alternative à la Théorie Quantique est considérée comme le
Déterminisme Absolu. Cependant, ce n'est pas exact. Les concepts
d'Observateur ont été traités précédemment et sont anthropomorphiques. Ils
sont beaucoup plus complexes que ce qui peut être supposé ; cependant, ils
n’impliquent pas l'effondrement de l'Omniscience et la Prescience ou
préconnaissance dans le Fatalisme de telle sorte que le Déterminisme Absolu
soit nécessaire.
Revenant à l'œuvre de
Swinburne sur l'importance de la conscience, il devient évident qu'il y a
des questions très complexes qui sont actuellement au-delà de la
démonstration physique. Si le commentaire de Swinburne concernant la
conscience est correct, alors il pourrait être convenu que le réceptacle
approprié de l'âme est le dauphin, puisque les cerveaux des dauphins et des
baleines sont aussi grands, voire plus grands, que les nôtres, et les
dauphins s’envoient des signaux extrêmement complexes les uns aux autres !
La conscience des dauphins est bien supérieure à la nôtre, car ils ne
s'endorment pas avec l'ensemble de leur cerveau en même temps, mais avec un
seul côté du cerveau qui dort à la fois. Penrose déclare à ce sujet : "Il
serait instructif pour nous si nous pouvions leur demander ce qu'ils
"ressentent" à propos de la continuité de la conscience" (ibid., p. 552).
Penrose se penche
ensuite sur le fonctionnement du cerveau humain dans le cadre d’expériences
de cerveau scindé. Lorsque divisé, le cerveau humain semble être conscient
séparément et, d'une certaine façon, avoir bifurqué (p. 498). La question
est : laquelle des consciences est la conscience avant l'opération ? Penrose
soutient que "il semble n’y avoir aucun moyen opérationnel de trancher sur
la question. Chaque hémisphère se partagerait les souvenirs d'une existence
consciente avant l'opération et, sans aucun doute, les deux prétendraient
être cette personne. C'est peut-être remarquable, mais cela n'est pas en soi
un paradoxe" (ibid., p. 499).
Nous nous trouvons donc
dans une situation où, en dépit des fonctions différentes des hémisphères
cérébraux droit et gauche (par exemple les Zones de Broca et de Wernicke en
tant que les centres de langage sur le côté gauche du cerveau), il y a une
façon particulière dans laquelle ils semblent être en mesure de bifurquer,
et on se retrouve avec le problème que le cerveau ne peut pas être le siège
de l'âme postulée que s’il est tenu d’être isolé à un seul hémisphère ou de
bifurquer. Le concept de l'âme est donc incohérent sur ce motif également.
La question de savoir ce
qui constitue le siège de la conscience est également problématique. Penrose
se réfère à des expériences de Penfield sur la cartographie des régions
motrices et sensorielles du cerveau humain. Penfield a considéré certaines
régions qu’il appelait le tronc cérébral supérieur, composé en grande partie
du thalamus et du mésencéphale (cf. Penfield et Jasper, 1947), comme le
‘siège de la conscience,’ bien que Penrose soutienne qu'il avait
‘principalement à l'esprit la formation
réticulaire’ (ibid., p. 493).
Son point de vue était
que la conscience est une manifestation de l'activité du tronc cérébral
supérieur, mais comme en plus il doit y avoir quelque chose dont on doit
être conscient, ce n'est pas seulement le tronc du cerveau qui est impliqué,
mais aussi une région du cortex cérébral qui est à ce moment-là en
communication avec le tronc cérébral supérieur et dont l'activité représente
le sujet (impression sensorielle ou mémoire) ou un objet (action voulue) de
la conscience (ibid., p. 493-4).
La formation réticulaire
est responsable de l'état général de la vigilance du cerveau (Meruzzi et
Magoun, 1949). Si elle est endommagée, l'inconscience s'ensuit. Quand le
cerveau se trouve dans un état de conscience éveillée, la formation
réticulaire est active. Quand le cerveau est inactif, la formation
réticulaire n'est pas active.
Le problème avec
l'attribution des niveaux élevés de la conscience humaine à la formation
réticulaire est que, en termes évolutionnistes, il s’agit de la partie la
plus ancienne du cerveau. La fonction réticulaire est présente chez les
grenouilles, les lézards et les morues et ainsi la conscience, tenue pour
être une fonction réticulaire, est le bien commun des vertébrés. Cela rend
l'évolution séquentielle du cerveau incohérente. Cependant, le schéma
biblique se traduit par l'affirmation du nephesh en tant que le souffle ou
esprit commun de tous les animaux.
Le point de vue (O'Keefe, 1985) selon lequel
l'hippocampe semble avoir plus à faire avec l'état de conscience est
principalement basé sur sa fonction de stockage de la mémoire à long terme.
Les dauphins et les humains ont un cerveau de la taille à peu près
semblable, et le dauphin possède les qualités mentales les plus étroitement
associées à l'intelligence. Penrose soutient que
"si la conscience est
simplement une caractéristique de la complexité d'un algorithme, ou
peut-être de sa
‘profondeur’
ou d’un certain
‘niveau de subtilité’,
alors, selon le point de vue fort de l’IA, les algorithmes complexes
menés par le cortex cérébral donneraient à cette région la demande la plus
forte pour être ainsi capables de manifester la conscience."
Si la conscience est liée au langage, elle est
associée avec le cortex cérébral gauche et non droit (John Eccles, 1973),
même si nous avons vu que cette position semble logiquement incohérente.
Penrose fait référence au fait que le cerveau peut déduire des informations
des alentours (voir Churchland, 1984, p. 143) et aussi que certaines
cellules sont sensibles à certains mots (identifiant éventuellement les
cellules avec des objets) (Penrose, ibid., pp. 500-502).
Bien que nous n'allions pas entrer dans l'action
du cerveau en détail, il est intéressant de noter que le cerveau transmet
les signaux le long des fibres nerveuses par transfert de charges positives
et négatives sous la forme d’une "zone d’inversion de charge se déplaçant le
long des fibres avec le matériel proprement dit (i.e. les ions) ne se
déplaçant que très peu ; se contentant d'entrer et de sortir à travers la
membrane cellulaire. Ce mécanisme curieusement exotique semble fonctionner
très efficacement. Il est utilisé universellement ; à la fois par les
vertébrés et les invertébrés"
(ibid., p. 506). Les vertébrés ont la fibre nerveuse entourée par un
revêtement isolant de myéline qui est la substance de coloration de la
‘matière blanche’ du cerveau. L'isolation permet
aux signaux nerveux de voyager sans relâche jusqu'à environ 120 mètres par
seconde (ibid.).
Il est intéressant de noter que l'aspect de
l’allumage des neurones dans le cerveau est par séquence d'impulsions qui ne
cessent pas lorsqu'elles ne sont pas activées, mais qui s'allument à un
rythme lent. La fréquence des impulsions augmente énormément lorsqu'elles
sont activées, et il y a un aspect probabiliste dans l’allumage : le même
stimulus ne produit pas toujours le même résultat et est beaucoup plus lent
qu'un ordinateur (ibid., p. 511). Il semble y avoir une bonne dose de hasard
et de redondance dans la façon dont les neurones sont connectés.
L'action du cervelet semble être complètement
inconsciente, tandis que la conscience peut être associée au cerveau, lequel
a seulement environ deux fois plus de neurones à une densité beaucoup plus
faible. Le cerveau possède également une structure changeante de connexions
et de relais sous forme de synapses, qui affectent la connexion avec des
épines dendritiques dans un réseau changeant, de telle sorte que
l'interconnexion entre les neurones n'est pas fixe. Ce phénomène est connu
comme la plasticité du cerveau. Le cerveau, contrairement à un ordinateur,
change tout le temps. Ce qui est plus important, c'est que la fonction des
ordinateurs est algorithmique, alors que la pensée consciente ou inspirée
d'un cerveau est soutenue par Penrose pour être définitivement
non-algorithmique, et donc théoriquement ne peut être reproduite par l'IA.
En outre, l'activité cérébrale est une action de l'unité ou l'unicité, par
opposition à de nombreuses activités simultanées.
Penrose considère que s’il y a, comme cela semble
être le cas, des cellules ayant une sensibilité au photon unique (à savoir
la rétine) dans le corps humain, alors il n'est pas déraisonnable de
supposer qu'il pourrait y avoir des cellules de ce genre, c'est à dire
celles qui peuvent être déclenchées par des événements quantiques simples
dans la partie mobile du cerveau. Si c’est le cas, alors la Mécanique
Quantique est significativement impliquée dans l'activité du cerveau. Il
cherche un critère d'un graviton étant initié par un effet unique créant un
champ électrique changeant détectable dans son environnement (un champ
toroïdal) avec le nerf comme axe et se déplaçant le long du nerf perturbant
ainsi suffisamment l'environnement pour stimuler un graviton (p. 518). Comme
le cerveau est trop
‘chaud’ pour préserver la cohérence quantique
(comportement décrit par l'action continue de U pour une période de temps
significative). Selon les propres termes de Penrose, "cela signifierait que
le critère d'un graviton serait continuellement satisfait, de sorte que
l'opération R se déroulerait en permanence, entrecoupée de U." La
trajectoire directe quantique n'est pas obtenue uniquement à partir des
actions de U de sorte que la fonction d'onde d'une particule unique,
initialement localisée dans l'espace, va se répandre sur les régions de plus
en plus grandes alors que le temps passe (ibid., p. 325 et 521).
Penrose dit :
"Il me semble que ni la
mécanique classique ni la mécanique quantique - cette dernière sans autres
changements fondamentaux qui rendraient R dans un processus
‘réel’ -
ne pourront jamais expliquer la
façon dont nous pensons." (p. 521).
Ici, il défend l’idée d’un ingrédient essentiel
non-algorithmique aux processus de pensée conscients et, à partir du
chapitre 10,
"À quoi servent les esprits ?" (pp. 523 et suivantes), il ouvre la
discussion sur les aspects passifs et actifs du problème Corps-Esprit :
1. Comment le cerveau matériel peut-il évoquer la
conscience ? et
2. Comment la conscience peut-elle, par l'action
de sa volonté, effectivement influencer le mouvement (apparemment
physiquement-déterminé) des objets matériels ?
Tel qu’indiqué précédemment, le problème est
légèrement plus complexe et nous allons maintenant tenter d’y répondre.
Tout d'abord, il est nécessaire de noter que les
algorithmes ne peuvent pas être créés par des algorithmes, et ils ne peuvent
prendre aucune décision quant à la validité d'un algorithme. La moindre
mutation d'un algorithme rendrait son processus mécanique inutile, et il est
incohérent d'affirmer que des améliorations aux algorithmes pourraient
survenir de façon aléatoire.
Le processus algorithmique de la sous-structure
du cerveau n'est pas un processus qui peut se développer par n'importe quel
procédé décrit comme évolutif. Penrose note que même des améliorations
délibérées sont difficiles sans que des "significations"
soient disponibles. Selon Penrose il s'ensuit logiquement que "nous
sommes de nouveau confrontés au problème de ce qu’est réellement la
conscience, et de ce qu'elle peut réellement faire que les objets
inconscients sont incapables de faire, et comment la sélection naturelle
a-t-elle été assez intelligente pour faire évoluer ces qualités des plus
remarquables" (ibid., p. 537).
Les affirmations de la sélection naturelle
semblent incohérentes par rapport à une quelconque fonction évolutive, mais
semblent plutôt être une fonction de maintien de l'efficacité de l'espèce.
Les espèces peuvent se protéger, mais ne semblent pas évoluer en aucune
manière explicable.
Pour préciser la question simplement, il y a un
élément automatique ou algorithmique du cerveau qui contrôle les réactions
inconscientes ou instinctives du cerveau et du corps. Ces structures sont
communes à tous les vertébrés et invertébrés, bien que les vertébrés
diffèrent et sont plus efficaces dans la transmission des signaux nerveux
que les invertébrés.
La conscience semble agir comme un processus
non-algorithmique capable de programmer la mémoire à long terme et les
actions du cerveau chez l'homme, et diminue à quelque capacité considérée
être véritablement intuitive et rationnelle, de sorte que seulement une ou
deux espèces ont des capacités dont on pourrait dire qu'elles se rapprochent
de la fonction.
La fonction instinctive de base commune à tous
les animaux est appelée nephesh, et la fonction rationnelle intuitive chez
l'homme semble être un ordre supérieur de la pensée qui est
non-algorithmique et peut saisir des idées intuitivement. Le problème de la
transmission simultanée d'idées sur une grande échelle indique qu'il y a un
effet non local qui est commun à de nombreux cerveaux.
La relation de l'univers est maintenant
importante et certaines questions sont soulevées.
L'emplacement spatio-temporel de la vie
intelligente ne semble pas être une coïncidence. L'une des questions qui
déroutent les physiciens est de savoir pourquoi certains des relations
observées entre les constantes physiques (la constante gravitationnelle, la
masse du proton, l'âge de l'univers, etc.) semblent tenir seulement à
l'époque actuelle dans l’histoire de la terre. "Donc, nous semblons vivre à
un moment très particulier (à quelques millions d'années près)" (Penrose
ibid., p. 561). Carter et Dick expliquent que cela est dû au fait que cette
époque coïncide avec la durée de vie de ce qu'on appelle les étoiles de la
séquence principale (comme le soleil), de sorte qu'il ne peut y avoir de vie
intelligente qu’à cette époque pour observer le phénomène. Cette proposition
me semble être simplement une réaffirmation futile des observations
initiales.
Lorsque l'on considère le principe Anthropique
Fort, qui traite de la possibilité d'une infinité d'univers possibles, nous
sommes confrontés à un concept de l'anthropomorphisme qui, de manière
incohérente, n’aborde pas la question de l'exactitude de l'isolement de
l'espace-phase de telle sorte que la possibilité aléatoire est éliminée, et
avec son élimination le concept que cette singularité peut isoler un univers
particulier qui est logiquement contraire à la nature de Dieu.
Les relations entre l'espace, le temps, la masse,
l'énergie, la pensée et la gravité sont tels que, comme nous l'avons
observé, ils semblent être d'une seule essence fondamentale, que nous
appellerons esprit. Un certain nombre de conséquences pour le problème
corps-esprit se pose de ce point.
Un esprit capable de sélectionner l'espace des
phases et de contrôler l'énergie de sorte que les forces sont d'une
exactitude qui permet une interrelation complexe contrôlée de la matière
doit logiquement être en mesure de modifier la relation entre les éléments
de la création, de manière à ce que, par le réarrangement de la
sous-structure, la matière puisse être introduite dans l'existence
temporelle ou en être retirée. L'essence pourrait être en multi-localisation
et contrôler les éléments individuels par une interaction complexe.
Une structure matérielle complexe pourrait se
réguler elle-même par un processus algorithmique intuitif propre aux
espèces, mais sur la base de principes communs à toutes les espèces. À
partir de la similitude des bases, la modification de la programmation de
base pourrait être effectuée par un processus non-algorithmique initié par
l'exercice de la force comme un champ électromagnétique exerçant une force
égale ou supérieure à un graviton, à un point tel que le système U déterminé
est modifié par rapport à son état superposé de telle sorte qu'un état
R soit initié lequel à son tour déclenche les concepts non algorithmiques
inspirés dans les structures du cerveau de l'espèce cible. Ceux-ci passent
alors dans la sous-structure algorithmique de la mémoire à long terme du
cerveau. La mémoire instinctive est programmée dans l'ADN à un point tel que
la production accrue de l'énergie active les réponses conditionnées à des
niveaux variables.
À partir de cela, il est possible d'influer sur
toutes les espèces, et l'occupation de l'espèce est simplement effectuée par
l'adoption d'un état énergétique agissant au sein de la structure
matérielle comme une force superposée. L'initiation continue d'effets
gravitationnels à partir de l'énergie réalisée par transposition amorce une
action, qui peut être involontaire à l’hôte ou, à tout le moins, avoir une
influence totale sur lui.
Lorsque l'esprit contient des éléments de
division, alors les entités superposées agissent conformément aux lois
établies ou s'en écartent. Le caractère absolu de relations théoriques
théistes obligerait les esprits à se retirer de toute entité éprouvant des
relations conflictuelles.
Le libre arbitre est donc maintenu comme une idée
de jugement de sorte que la capacité rationnelle de l'espèce humaine peut
décider quelle structure élémentaire elle souhaite adopter : soit agir dans
le cadre des relations théoriques ou en dehors de celles-ci, soit obéir à la
loi ou désobéir. La désobéissance assure l’enlèvement de l'esprit et une
image vide de telle sorte que les divisions polythéistes peuvent agir sur
lui seul ou dans la multiplicité, c'est-à-dire, comme les champs d'énergie
multiples initiant des états R sur l’hôte unique.
La mort de l’hôte assure l'inaction des champs
énergétiques sur l’hôte matériel.
Le concept d'être
"prédestinés à être
appelés" et de là justifiés et glorifiés indique que certains, appelés les
élus, ont un élément de l'esprit placé en eux. Cet élément de l'esprit est
tel qu'il peut initier des transformations de la structure universelle en
modifiant les états et, à la suite d’un processus de positions attitudinales
stables développées dans la conscience, développer systématiquement sa
force.
Dans ce cas, lorsque la structure matérielle
meurt, alors l'élément spirituel théomorphique non-essentiel est retenu en
tant que structure de l'essence divine émanant d’Eloah comme un subalterne à
son Elohim ou Theos. La sélection et la formation des élus est un processus
de prédestination résultant d'un processus d'omniscience. Les interrelations
immatérielles permettent à Le Dieu, Ho Theos, ou Eloah, à travers l'essence
divine, de transposer les positions du temps et de l'espace. Les
affirmations anthropomorphiques du déterminisme, associées à la prescience
et aux concepts de la physique limitée, sont incohérentes.
Cicéron a fait cette erreur il y a deux
millénaires. Afin de faire des progrès face aux stoïciens, il a dû supprimer
la divination, et c'est ce qu'il a tenté de faire en niant la prescience.
Par le matérialisme platonicien, le monde a été limité au fatalisme.
Augustin a correctement réfuté l'argument dans l’ouvrage la Cité de Dieu et
je n’insisterai pas davantage sur le sujet. Comme le dit Augustin :
"Reconnaître l'existence de Dieu, tout en lui refusant toute prescience
des événements, c’est la folie la plus évidente." (Cité de Dieu, p.
190).
Mais ceci ne supprime pas le libre arbitre et
n’établit pas le déterminisme effondré dans le fatalisme, mais plutôt il
établit la prescience absolue de l’exercice de notre libre arbitre, parce
qu’il s’exerce sur deux plans d'existence et de compréhension.
Les scientifiques d'aujourd'hui commettent les
mêmes erreurs que leurs ancêtres platoniciens païens qui adoraient la
création et ont tenté de créer un univers algorithmique de la vérité
mathématique d'une nature telle qu'ils pourraient s’unir avec Theon par la
compréhension des véritables idées. Cette position est le revers de
l'élection, et est en fait impossible en raison de la nature limitée de la
structure matérielle.
Chapitre 5
Résumé
Il est de plus en plus difficile d'expliquer le développement de
l'univers en termes physiques simples. La nature et la répartition de
l'univers sont mal comprises. Certaines grandeurs physiques et certains
aspects de la nature échappent actuellement à la compréhension humaine.
La philosophie a tenté d'expliquer la nature de la matière et de
l'univers dans le cadre de la physique limitée de son époque, et la plupart
de ses tentatives reposent sur des hypothèses de l'atomisme corporel.
L'ensemble de l'édifice de l'action humaine a été construit sur une notion
de causalité qui a été traitée comme analytiquement fondamentale, et à
partir de cette hypothèse tout l'édifice de l'action humaine, de la liberté
et du déterminisme a été construit sur une fondation bancale de causalité
survenante. Michael Tooley, dans son explication de la causalité et de la
structure des relations, a démontré que la structure la plus cohérente et
ontologiquement pratique doit être singulariste, fondée sur des relations
théoriques. Un examen de Hume et de philosophes postérieurs montre quelques
positions intéressantes émergentes en ce qui concerne les aspects
métaphysiques de la science et de la matière.
À partir de la position de Tooley et de l'examen d'un certain nombre de
phénomènes qui semblent indiquer l'existence d'une action et de relations
immatérielles externes à l'action physico-chimique du corps humain, on
postule qu'il existe à l’œuvre une série de structures et d’entités
immatérielles qui ont la capacité d'influer sur la pensée, et donc le
comportement de l’homme.
Sur la base du lien de la causalité singulariste, il est logiquement
postulé que la cause singulariste est une entité que nous comprenons être
Dieu, et que les effets matériels et immatériels sont le résultat logique de
la causalité émanant de cette entité, les aspects immatériels de la création
étant logiquement antérieurs aux aspects matériels.
Suite à l'examen des possibles attributs et de la nature de Dieu, on peut
en déduire que la création doit suivre un certain nombre de lois qui émanent
nécessairement de la nature de l'entité et qui, n'étant pas désincarnées,
régissent les actions de la création. On ne peut pas non plus soutenir que
Dieu pouvait créer les attributs divins, mais plutôt qu’ils doivent être
instanciés, ce qui rend par là la création absolue incohérente.
L'existence d'entités spirituelles autres que Dieu a été prise pour
acquis, et est une facette de l'histoire enregistrée et orale de l'homme. Au
sein de la structure ontologique courante des différentes religions
existantes à ce jour, une incohérence observable et démontrable existe dans
la prise en compte du mal. L'armée angélique a été considérée comme
fondamentalement absurde dans le cadre théologique communément compris du
Christianisme moderne. Les démons ne semblent pas avoir de raison cohérente
pour leur existence en tant qu’entité maléfique, et, en effet, beaucoup se
sont efforcés de nier leur existence même.
Lorsque le schéma biblique est analysé, un certain nombre de propositions
intéressantes émergent qui, quand on les examine, produisent un schéma
logique cohérent de la création dans lequel une structure spirituelle
unifiée en harmonie sous la Volonté de Dieu est considérée comme le facteur
déterminant de la création matérielle et spirituelle. Les démons n'ont pas
été créés mauvais : ils ont été créés, comme Christ et toute l'armée
entière, avec la capacité de connaître le bien et le mal. Ces entités ont
choisi de se placer en dehors de la volonté de Dieu, et ils ont
volontairement choisi de pécher par la rébellion et ont logiquement créé le
polythéisme. Les divisions polythéistes ont déclenché une guerre dans les
cieux, et qui existe jusqu’à ce jour.
Dans peu de temps, toute la rébellion entière sera amenée à sa fin et la
nouvelle armée de remplacement sera établie à partir des rangs de l'humanité
en séquence.
La chronologie de la création de l'humanité et de la planète a été
‘rangé’ de façon erronée par Augustin d'Hippone au début
du Vème siècle, et par conséquent un scénario clos de la création a été
établi.
Cela a empêché la philosophie de la religion d'expliquer de manière
adéquate et de fournir une orientation philosophique et théologique à la
science en général et à la paléoanthropologie au fur et à mesure qu'elle
émergeait en tant que science. Cette théologie philosophique incohérente et
incomplète a permis l'introduction du matérialisme évolutionniste et le
rejet de l'activisme théiste en raison d'une structure ontologique
incohérente de la création et manifestement non scientifique.
Un réexamen de la science et des écrits des anciens montre qu'ils avaient
en fait une explication parfaitement logique pour les développements
ultérieurs de la science, et qu’ils avaient en fait une ontologie et une
structure sotériologique formelles, convaincantes et pratiques.
À l'examen de ces doctrines, une harmonie de la structure de la création
ressort qui fournit une explication alternative pour la séquence de la
création. La paléoanthropologie se révélera être un outil utile pour la
compréhension de la séquence de la création pré-adamique et la séquence de
développement. La progression des cultures moustériennes vers les cultures
aurignaciennes et la destruction de ces groupes avec la disparition
mystérieuse de systèmes Kartan il y a plus de 4000 ans sont intéressantes.
Un examen du problème du mal montre que, dès les premiers concepts et
leur application linguistique, l'unité et l'harmonie de la création sous un
Gouvernement Universel uni constituaient la structure d'origine, et que la
rébellion était la cause initiale de la décomposition de la structure et la
cause d'une structure de plus en plus égocentrique et polythéiste dont le
fonctionnement logique est la désunion, la désintégration et, de là, le mal.
Un examen des systèmes non-bibliques démontre que la structure religieuse
active de la planète repose sur deux prémisses. L’une endosse l'immortalité
basée sur une doctrine de l'âme qui semble être à l'origine proche de la
théologie chaldéenne ; l'autre n'endosse aucune âme immortelle et par
conséquent est théocentrique dépendant d'une résurrection de la chair.
L'égocentrisme de la doctrine de l'âme développe logiquement le polythéisme
et exacerbe la progression du mal, qui culmine finalement à la destruction
du monde correspondant immédiatement à une vision du monde égocentrique et
incohérente et à une structure gouvernementale postulée.
Un examen de la doctrine de l'âme et des concepts de la résurrection
montrera que les systèmes chrétiens d'origine ont été réécrits par Athanase
et Augustin pour satisfaire à une fausse théologie et une fausse
philosophie, entamant ainsi la progression logique vers la la domination et
la destruction du monde. La doctrine de l'âme est incohérente, peu pratique,
et, en fin de compte, destructrice.
L'attribut ou l’absolu de la Loi et des systèmes théistes qui
l’accompagnent, dont on s'attendrait logiquement à ce qu'ils aient été
clairement donnés à la race humaine, s’est produit sur une base progressive.
L'humanité a été constamment détournée des Systèmes Moraux, et la
destruction progressive du système humain en tant qu'édifice sain pour le
fonctionnement de l'Esprit de Dieu est régulière et exponentielle. Les
Démons existent et, logiquement, ils ne peuvent qu’exister qu’en tant
qu'entités qui ont été créées parfaites, mais ont exercé leur capacité à
faire le mal en se rebellant contre la volonté de Dieu. Tout autre système
est incomplet, incohérent et porte nécessairement atteinte à l'Omniscience
et l'Omnipotence de Dieu.
La structure entière de l'Armée Céleste ne peut exister qu’à l’intérieur
de la volonté d'une entité unique qui est singulière centralement mais qui
permet l’individualité des entités au sein de cette volonté comme une
structure harmonieuse, et qui lui est subordonnée.
Pour cette raison, la Trinité est incohérente et il ne peut y avoir qu’un
Dieu, Eloah (ou Allah), et toutes les entités existantes doivent être
subordonnées comme des êtres inférieurs autrement elles doivent logiquement
être détruites.
C'est ainsi que les entités de la rébellion doivent logiquement se
repentir et revenir à la volonté de Dieu en tant qu’éléments de cette
famille autrement elles doivent logiquement être détruites.
La création de l'homme en tant qu’entité spirituelle ne peut se faire
qu’après que l'interrègne de l'enseignement de la rébellion soit terminé.
L'espèce humaine et l'ordre angélique ne feront alors plus qu’un, puisque
Dieu deviendra tout en tous et l'univers reprendra son harmonie d’avant la
rébellion, logiquement plus fort, plus sage et plus puissant, numériquement
et spirituellement.
La création a donc été illogiquement vue comme une structure théologique
anthropomorphique qui a permis une existence polythéiste continue de l'être.
Le développement des explications sur le système corps-esprit humain a
abouti au cartésianisme, vulnérable aux arguments polythéistes portés contre
l'armée spirituelle ou démoniaque dans la rébellion, et est logiquement une
autre forme élitiste du polythéisme. Il est incohérent et doit être rejeté.
La nature non-algorithmique de la pensée consciente et le fonctionnement du
cerveau à un niveau de base dans toutes les espèces montrent deux niveaux de
fonctionnement, selon le schéma biblique. L'âme n'existe que sous la forme
d’un nephesh animal, qui est développé chez l'homme pour s’adapter à un
élément de théomorphisme non-essentiel, attribué par la prédestination sur
une base progressive de sorte que finalement tous les hommes seront sauvés
et prendront part dans leur héritage, qui, selon Deutéronome 4:19, est
l’ensemble des cieux.
q
Bibliographie
Allen, Reginald E., Greek Philosophy: Thales to
Aristotle, The Free Press, New York, 1966
Anscombe, G.E.M., Causality and Determination,
Causation and Conditionals, Ed. E. Sosa, Oxford University Press, Oxford,
1975
Anscombe, G.E.M., "Time, Beginnings and Causes" in
Rationalism, Empiricism and Idealism, Ed. Anthony Kenny, Oxford Clarendon
Press
Armstrong, David M., What is a Law of Nature?,
Cambridge University Press, 1983
Armstrong, David M., Universals and Scientific
Realism, Vol II, Cambridge University Press, 1978
Aristotle, Metaphysics, Tr. Hippocrates G.
Apostle, Peripatetic, Peripatetic Press, 1979
Augustine, City of God, Ed. David Knowles,
Penguin Classics, London, 1987
Bacchiocci, Samuele, From Sabbath to Sunday,
The Pontifical Gregorian University Press, Rome, 1977
Barret, C.K., The New Testament Background:
Selected Documents, Revised Edition, SPCK, 1987
Benn, Stanley, "Personal Freedom and Environmental
Ethics: The Moral Inequality of Species" in G. Dorsey (ed.), Equality and
Freedom: International and Comparative Jurisprudence, Leiden: Sijtof, 1977
Berofsky, B., "Free Will and Determinism" in
Dictionary of the History of Ideas, Ed. P.P. Wiener, Vol 2
Berofsky, B., Freedom From Necessity The
Metaphysical Basis of Responsibility, Routledge & Kegan Paul, New York &
London, 1987
Budge, Sir E.A. Wallis, Kt., Babylonian Life and
History, Second Edition, Religious Tract Society, London, 1925
Burnet, John, Early Greek Philosophy, Black,
4th Edition, London, 1945 and 1958
Butterick, G.A. et al., The Interpreter’s
Dictionary of the Bible, Vols 1-4 (1980) plus Supplement (1976), Abingdon,
Nashville
Cassirer, E. et al., The Renaissance Philosophy
of Man, Phoenix Books, University of Chicago Press, Chicago and London, 8th
Imp., 1963
Cavendish, Richard, Ed., Mythology An Illustrated
Encyclopedia, Macdonald & Co., London, 1987
Charlesworth, J.H., The Old Testament
Pseudepigrapha, Vols. 1 and 2, Doubleday, New York, 1983
Charlesworth, M.J., Philosophy of Religion:
The Historic Approaches, MacMillan
Churton, Tobias, The Gnostics, Weidenfeld &
Nicolson, London, 1987
Cicero, Cicero’s Three Books of Offices, and
Moral Works, Tr. Cyrus R. Edmonds, George Bell & Sons, London, 1874
Cohen, Chapman, Determinism or Free-Will?,
New Edition, Pioneer Press, London, 1919
Collins, Anthony, Determinism and Freewill: A
Philosophical Inquiry concerning Human Liberty, Martinus Nijhoff, The Hague,
1976
Copleston, F., A History of Philosophy, Vol
2, "Mediaeval Philosophy Part 1: Augustine to Bonaventure," Garden City, New
York, Image Books, 1963
Cox, Wade, Bible Study Papers 1-300, CCG, 1994-2000.
Mysticism, CCG
Publishing, 2000
Coxe, A. Cleveland et al., The Ante-Nicene
Fathers, Volumes 1-10, T. & T. Clarke Eerdmans, Michigan, 1987
Croke, B. & Harries, J., Religious Conflict in
Fourth-Century Rome. A Documentary Study, Sydney University Press, 1982
D’Agostino, F., Chomsky’s System of Ideas,
Clarendon Press, Oxford, 1988
D’Agostino, F., Reading Course Notes Part III,
"Freedom and Determinism," UNE, 1989 (mimeograph)
Devlin, Patrick, The Enforcement of Morals,
Oxford, 1987
Dretske, I., "Laws of Nature", Philosophy of
Science, Baltimore: Williams & Wilkins, 44 (1977):248Ð268
Drury, Nevill, Dictionary of Mysticism and the
Occult, Harper & Row, N.Y., 1985
Dunner, Joseph, Baruch Spinoza and Western
Democracy, Philosophical Library Inc., N.Y., 1955
Edwards, David, Christian England, Vols. 1-3,
Collins, London, 1982
Epictetus, The Book of Epictetus, Ed. T.W.
Rolleston, Tr. Elizabeth Carter, Ballantyne Press, George G. Harrap & Co.,
London
Ferm, R. et al. (Eds.), Philosophy of Religion:
Selected Readings, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
Forrest, Peter R.H., Speculation and Experience,
The New Metaphysics, U.N.E., Armidale, 1948
Forrest, Peter, Some Varieties of Monism,
U.N.E., Armidale, non daté
Forrest, Peter, Justifying God’s Ways,
U.N.E., Armidale, non daté
Forrest, Peter, How Can We Speak of God? How Can
We Speak of Anything?, U.N.E., Armidale, non daté
Forrest, Peter, "An Argument for the Divine Command
Theory of Right", Sophia, Vol.28 No.1, M.J. Charlesworth (Ed.), Deakin
University, Geelong, April 1989
Franklin, R.L., Freewill and Determinism: A Study
of Rival Conceptions of Man, Routledge and Kegan Paul, London, 1968
Gibbon, E, The Decline and Fall of the Roman
Empire, Ed. H Trevor-Roper, Heron Books, New York, non date
Goldberg, Stanley, Understanding Relativity,
Origin and Impact of a Scientific Revolution, Oxford Science Publications,
Clarendon, 1984
Gribbin, John, "The man who proved Einstein wrong",
New Scientist, No.1744, 24/11/90, pp.33-35
Guthrie, K.S., The Pythagorean Sourcebook and
Library, D.R. Fideler (Editor), Phanes Press, Michigan, 1987
Hampshire, Stuart, Spinoza, Pelican, London,
1965
Happold, F.C., Mysticism. A Study and an
Anthology, Penguin, Harmondsworth, Middx, 1986
Hastings, J. et al., Encyclopedia of Religion and
Ethics, Vols 1-12 and Index, T. & T. Clark, Scholar Press, Ilkley, 1980
Hawking, Stephen W., A Brief History of Time:
From the Big Bang to Black Holes, Bantam Press, London, 1988
Hebblethwaite, Brian, The Ocean of Truth: A
defence of objective theism, Cambridge University Press
Heidegger, M., Being and Time, Tr. Macquarrie
and Robinson, SCM, 1962
Herberman, C.G. et al., The Catholic Encyclopedia,
Vols 1-15 plus Supps., Appleton, New York, 1907
Hick, John, Philosophy of Religion,
Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. (Foundations of Philosophy Series),
1963
Hospers, John, An Introduction to Philosophical
Analysis, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1959
Hort, F. On Monogenese Theos in Scripture and
Tradition, in Two Dissertations, UK, 1876.
Hudson, W.D., Modern Moral Philosophy, 2nd
Ed., Macmillan, Hampshire, 1985
Hume, David, Treatise ,Part III Section 4,
Oxford, Clarendon Press, 1978
Hume, David, "Essay X" from Essays, Moral,
Political and Literary, Ed. Eugene Millar, London, O.U.P., 1966
Hume, David, Enquiries Concerning Human
Understanding and Concerning the Principles of Morals, Reprinted from 1770
Edition, Third Ed., Clarendon University Press, Oxford, 1975
Inwood, Brad, Ethics and Human Action in Early
Stoicism, Clarendon Press, Oxford, 1987
Ishiguro, Hide, "Pre-established Harmony Versus
Constant Conjunction: A Reconstruction of the Distinction Between Rationalism
and Empiricism" in Rational, Empiricism and Idealism, Ed. Anthony Kenny,
Oxford Clarendon Press, 1986
Jeans, Sir James, Physics and Philosophy,
Cambridge University Press, 1943
Jonas, Hans, Spinoza and the Theory of Organism
Katz, S.T. (Ed.), Mysticism and Philosophical
Analysis, Sheldon Press, London, 1978
Kelly, J.N.D., Early Christian Doctrines,
Revised Edition, Harper & Row, New York, 1978
Kenny, Anthony. (Ed.), Rationalism, Empricism and
Idealism, British Academy Lectures on the History of Philosophy,
Clarendon Press, Oxford, 1986
Kenny, Anthony, Faith and Reason, Columbia
University Press, New York, 1983
Le Goff, Jacques, The Medieval Imagination,
Tr. Arthur Goldhammer, University of Chicago Press, 1988
Lecky, History of European Morals, London,
1890
Lehrer, Keith, An Empirical Disproof of
Determinism, Freedom and Determinism, Random House, New York, 1966
Leibniz, G.W., New Essays Concerning Human
Understanding, Tr. Langley, Illinois, 1949
Leibniz, G.W., Philosophical Writings, Tr. M.
Morris, Everyman’s Library, J.M. Dent & Sons, London; E.P. Dutton & Co Inc., New
York, 1956
Leibniz, G.W., Monadology and Other Philosophical
Essays, Tr. P. & A.M. Schrecker, Bobbs-Merril Educational Publishing,
Indianapolis, 1980
Louth, A., The Origins of the Christian Mystical
Tradition, Biddles, Oxford, 1985
Lubbock, Sir John, Sir John Lubbock’s Hundred
Books, 4, The Teaching of Epictetus, Tr. T.W. Rolleston, George
Routledge & Sons Ltd, London, 1891
MacIntyre, A.C., "Determinism" in B. Berofsky, "Free
Will and Determinism" in Dictionary of the History of Ideas, Ed. P.P.
Wiener, Vol. 2
McKeon, Richard, Selections from Medieval
Philosophers, Vols 1 & 2, Charles Scribner’s Sons, New York, 1957, 1958
Mackie, John, The Miracle of Theism,
Clarendon Press, Oxford
Mackie, J.L., Ethics: Inventing Right and Wrong,
Penguin Books, 1977
Moffatt, James, The First Five Centuries in the
Church
Moore, G.F., History of Religions, Vols 1
(1971) & 2 (1965), T. & T. Clark, Edinburgh
Moore, G.E, "Free Will" in G. Dworkin,
Determinism, Free Will and Moral Responsibility
Morris, Thomas V., Perfect Being Theology,
University of Notre Dame, Indiana, 1987
Morris, T.V. & Menzel, C., "Absolute Creation" in
American Philosophical Quarterly, Vol.23 No.4, Oct. 1986, pp.353-362
Morrow & Dillon, Proclus’ Commentary on Plato’s
Parmenides, Princeton University Press, 1987
Mosheims, Ecclesiastical History, Murdock
Translation, Reid revision, 4th Ed., William Tegg, London, 1865
Neill, Stephen, Anglicanism, Pelican, London, 1965
Nowell-Smith, Patrick, Miracles, King;s
College, Aberdeen, Scotland
Pears, David (Ed.), Russell’s Logical Atomism,
Fontana/Collins, London, 1972
Penrose, Roger, The Emperor’s New Mind,
Vintage, Oxford University Press, 1990
Phillips, D.Z., Religion without Explanation,
Basil Blackwell, Oxford, c1976
Plantinga, Alvin & Wolterstorff, N. (Eds.), Faith
and Rationality: Reason and Belief in God, University of Notre Dame Press,
Indiana
Plato, The Collected Dialogues, Ed. Hamilton
& Cairns, Princeton, 1973
Pollock, Sir Frederick, Spinoza His Life and
Philosophy, New York, 1966
Popper, Karl R., The Logic of Scientific
Discovery, Hutchinson, London, 1986
Quinton, A M, "Absolute Idealism" in Rationalism,
Empiricism and Idealism, in Kenny 1986
Ramsey, F.P., "Theories", in The Foundations of
Mathematics, Ed. R.B. Braithwaite, Paterson, N.J., Littlefield, Adams & Co.,
1960, pp.212-236.
Robertson Smith, W., Religion of the Semites,
Rev. Ed., Adam & Charles Black, London, 1914
Rolleston, T.W. (Ed.), The Book of Epictetus,
from Tr. of Elizabeth Carter, Ballantyne Press, George G. Harrap & Co. Ltd,
London
Rotenstreich, N. et al., Spinoza His Thought and
Work, Jerusalem, 1883
Rotenstreich, N., "The System and its Components" in
Rotenstreich 1883
Rushdoony, Rousas John, The Institutes of
Biblical Law, Craig Press, USA, 1973
Russell, Bertrand, The Philosophy of Liebniz,
George Allan & Unwin Ltd, London
Russell, Bertrand, Why I Am Not a Christian,
Ed. Paul Edwards, George Allen & Unwin Ltd, London, 1957
Saunders, J.L., Greek and Roman Philosophy after
Aristotle, Free Press, New York, 1966
Schaff, P., History of the Christian Church,
Vols 1-8, Eerdmans, Michigan, 1988
Schurer, E., The history of the Jewish people in
the age of Jesus Christ, Vols I-III, 2nd Ed., Geza Vermes et al., T. & T.
Clark, Edinburgh, 1987
Schurer, E., The Literature of the Jewish People
in the Time of Jesus, Ed. Nahum N. Glatzer, Schocken Books, New York, 1972
Seeburg, R, The History of Doctrines, Tr.
C.E. Hay, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, 1977
Smith, William (Ed.), Dictionary of Greek and
Roman Antiquities, 2nd Ed., Taylor Walton & Maberly, London, 1851
Spinoza, Benedict de, His Life, Correspondence
and Ethics, Vols I and II, Tr. R. Willis M.D., London, 1870
Spinoza, Benedict de, The Chief Works of Benedict
de Spinoza Tr. R.H.M. Elwes, Vol II, Dover Publications, NY, 1955
Spinoza, Benedict de, The Political Works,
Ed. A.G. Wernham, Oxford, Clarendon Press, 1958
Strong, James, The New Strong’s Exhaustive
Concordance of the Bible, Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1984
Suzuki, D .T., Mysticism: Christian and Buddhist,
MacMillan, USA, 1969
Swinburne, Richard, The Existence of God,
Clarendon Press, Oxford, 1979
Tooley, Michael, Causation A Realist Approach,
Oxford University Press, 1987
Tooley, Michael, The Nature of Causation: A
Singularist Account, (in publication)
Ulansey, David, The Origins of the Mithraic
Mysteries, Cosmology & Salvation in the Ancient World, Oxford, 1989
Weinberg, J.R., A Short History of Medieval
Philosophy, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1964
Werther, David, "Augustine and Absolute Creation" in
Sophia, see Forrest 1989
Wolf, A, The Correspondence of Spinoza,
London, 1928
Zaehner, R.C. (Ed.), The Concise Encyclopaedia of
Living Faiths, Hutchinson, London, 1959
Zaehner, R.C., Mysticism Sacred and Profane,
Clarendon Press, Oxford, 1957